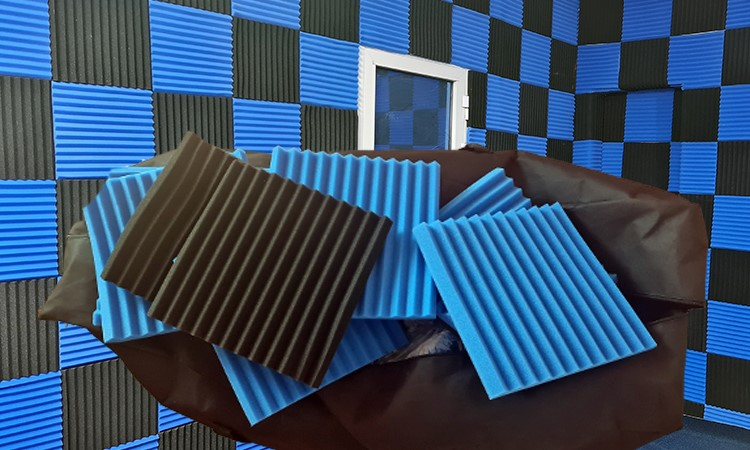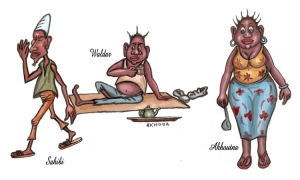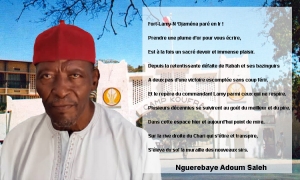A la Une
- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…
- Départ de l’armée française, merci président Mahamat
- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?
- Cérémonie de désengagement des troupes françaises
- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…
- Succès Masra, au bout de l’inconstance
- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…
- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?
- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024
- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection
Le gouvernement du Tchad vient de reconduire le couvre-feu fixé de 21heure à 5heures du matin il y a 48 heures. Les N’Djamenois se disent navrés de cette décision. Mais le gouvernement fait une dérogation spéciale pour le réveillon de Noël ce mercredi 16 décembre 2020. Au lieu 21h comme d’habitude, le couvre-feu va plutôt commencer à 1heure du matin, juste pour la nuit du 24 décembre 2020. Reportage.
Charles, c’est son nom d’emprunt. Il est tenancier d’un bar au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement de la ville de N’Djamena. Il requiert l’anonymat. M. Charles est mécontent de la reconduction du couvre-feu, « Premièrement, nous n’avons pas un autre travail, c’est ce métier qui nous génère de revenu. Il nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. Nous payons un loyer et les propriétaires sont à notre trousse. Nous n’arrivons pas à honorer nos engagements à la fin du mois. Deuxièmement, nous avons des employés qu’il faut les payer. Eux aussi ont des familles à nourrir. Avec ce couvre-feu, nous n’arrivons pas à joindre les deux bouts. » Pour lui, les tenanciers travaillaient, avant le couvre-feu de 14heures à 22heures, les boîtes de nuit sont ouvertes jusqu’à 0heure. D’autres à 1h ou 2h du matin. Il se dit désolé de la décision qui ressemble à du mépris de la population. Il plaide pour que le gouvernement revoie sa décision.
Autre chose : « Les avions qui atterrissent vers 21heure, lorsqu’on va chercher un parent, il arrive, bien qu’il soit dit que pour les Tchadiens de retour de voyage sont exempté de pénalité le temps d’arriver chez eux, la réalité est autre. La patrouille nous arrête au nom du couvre-feu. Il faut débourser 60 000 FCFA pour récupérer sa voiture. » Franchement, certains profitent du couvre-feu pour les poches des citoyens, désole-t-il.
Togyamta clémentine ne cache pas son identité. Pour elle, le gouvernement ne crée pas d’emplois pour les jeunes. Et quand certains créent des emplois, il met des obstacles. « Nous ne sommes pas d’accord. On nous retarde alors qu’on parle d’entrepreneuriat des jeunes et ils nous bloquent avec le couvre-feu », dit-elle l’air remonté. Il faut que durant les fêtes de la Noël et du Nouvel An, l’heure du couvre-feu soit revue afin de permettre aux uns et aux autres de fêter en toute liberté, souhaitent-elle.
Raymond Théophile est « clandoman » (chauffeur de mototaxi), « nous faisons de bonnes affaires pendant les veilles des fêtes. Nous avons cru que le gouvernement allait lever définitivement le couvre-feu ou décaler l’heure le plus tard possible. C’est décevant », déplore-t-il. Pour lui, le gouvernement n’aide pas les autoentrepreneurs. « Franchement, 21heures c’est très tôt. Cela n’est pas à notre avantage ».
Rappelons que le Couvre-feu instauré le 14 décembre 2020 est prorogé. La nouveauté ce qu’il est exceptionnellement repoussé à 1h du matin, mais seulement dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020 sur toute l’étendue du territoire. Un soulagement pour les tenanciers des débits de boissons et les églises pour mieux célébrer la fête de la Nativité.
Moyalbaye Nadjasna
Dans chaque coin des rues de la capitale tchadienne, N’Djamena, les panneaux de signalisation avec de différents signaux en écritures et en dessins pullulent. Mais le respect de ces panneaux est loin d’être observé. Reportage
A N’Djamena, les panneaux de signalisation routiers ne manquent pas. Mais leurs respects démontrent le contraire. Lors des déplacements, les usagers croisent des panneaux de signalisation routiers sans lire ni comprendre l’information indiquée. Pourtant, ces panneaux de signalisation comportent des dessins et même des écritures. Ils ont chacun un sens : avertir, d’informer et signaler. Chaque panneau à sa particularité et son sens.
Les exemples démontrant l’incompréhension des conducteurs sont légion dans la capitale. Un tour devant les établissements scolaires aux heures de sortie de classe suffit de confirmer. Bien qu’il y ait des panneaux qui indiquent la présence d’une école, les surveillants sont obligés de réglementer la circulation à la sortie des classes pour permettre aux élèves de traverser. Pire le passage piéton est ignoré par les conducteurs aux différents carrefours. Alors que le passage clouté figure à grands traits sur l’asphalte.
Pour le directeur d’une auto-école, Betoïnan Richard, les automobilistes et les motocyclistes ne comprennent pas ce qui est écrit sur ces panneaux routiers. Ils ne font pas même un effort pour cela. Selon lui, cela s’explique par le fait que la majorité des conducteurs ne sont pas sortis des auto-écoles. Et n’ont, peut-être, même pas leurs permis de conduire. Portant, « chaque panneau informe, à l’aide d’un symbole, les usagers de la nature du danger, de l’obstacle ou de la zone à risque rencontré », souligne-t-il.
Contrairement aux autres panneaux d’indication ou d’obligation, les panneaux de forme triangulaire aux bordures rouges prévoient les dangers imminents. Mais si l’intérieur du panneau est jaune, il s’agit toujours d’un panneau de danger, mais un danger temporaire. La présence de ces panneaux impose aux conducteurs une vigilance toute particulière, et surtout d'adapter leur conduite à la situation.
Le nombre croissant accidents à N’Djamena sont en grande partie le résultat du non-respect du Code de la route. « Normalement, les conducteurs doivent respecter la distance de sécurité qui varie selon les véhicules et la limitation de vitesse indiquée sur les panneaux. Malheureusement les usagers roulent sans tenir compte de ces règles », déplore Betoinan Richard.
« Dans les villes, les panneaux triangulaires sont placés à 50 mètres du danger. Cela permet aux usagers de disposer d’un délai de 3 secondes, s’ils circulent à 50 km/h, avant d’être confrontés au danger. Dans certains cas, le panneau peut être disposé à 20 mètres, dans d’autres, à 70 mètres du danger et il faudra donc réduire sa vitesse pour anticiper au mieux la situation. Mais en dehors des villes, ils sont placés à 150 mètres du danger », explique-t-il.
Les conducteurs doivent pouvoir anticiper suffisamment le danger pour ralentir, s’arrêter ou contourner l’obstacle et éviter l’accident. Les panneaux de danger peuvent être combinés avec des panonceaux. Cependant, lorsqu’un panonceau est placé entre 2 panneaux, il se réfère seulement au panneau du dessus, alors que le panneau du dessous est indépendant. Pour Betoïnan Richard, la vigilance doit être de mise. « Les usagers doivent redoubler de vigilance et respecter les règles définies dans le Code de la route afin de circuler en toute sécurité », conseille-t-il.
Djilel-tong Djimrangué

Appelées Kitoko, Johnny, Score, Lion d'or, Pastis, l’alcool frelaté inondent les marchés de N’Djamena malgré l’interdiction. Et les jeunes sont de plus en plus accroc avec des conséquences néfastes. Reportage.
Une boisson frelatée est une boisson distillée de façon illégale et par conséquent dans les conditions non particulières, a défini Dr Adama Dar Blague, médecin à la Clinique Melina. Au Tchad, la production et la vente de cette boisson sont interdites. Mais elles sont importées de manière frauduleuse et livrées à la consommation sur les différents marchés, coins et recoins de la capitale, N’Djamena.
Emballées dans des petits sachets, il y a plusieurs marques avec des noms comme Kitoko, Johnny, Lion d’or, Tir, Score etc. Des boissons prisées par les jeunes n’djamenois. Le soir, au carrefour ou dans des endroits spéciaux, des jeunes se livrent à la consommation de ces boissons frelatées. Les prix varient de 50 à 100 francs CFA. Les jeunes les préfèrent à d’autres boissons conventionnellement produites.
Diverses raisons
Alex est un fidèle consommateur de ces boissons alcoolisées. Il justifie son choix, « je préfère consommer cette boisson comparée à la bière. Il est moins cher et plus efficace. Avec deux sachets qui coûtent seulement 300 F, je me saoule, mais la bière je dois utiliser plus de 5 000 f », dit-il.
Modjingar Frédéric, 13 ans seulement, est un grand consommateur de ces produits prohibés. Il a suivi des amis et depuis lors il est accro, « mes amis en consommaient. Moi aussi j’ai essayé et suis devenu consommateur. Aujourd’hui je ne peux pas m’en passer », avoue-t-il.
Pour d’autres, ces boissons leur permettent de surmonter leurs problèmes. Un consommateur qui requiert l'anonymat dit que ces boissons lui font oublier un tant soit peu ses soucis. « Quand j'ai des problèmes que je n’arrive pas à résoudre, je prends 5 sachets et je dors tranquillement », dit-il.
Les ex-consommateurs reconvertis
Après plusieurs années de consommation, certains décident d'arrêter. « Je prenais plus de 5 sachets par jour. Après quelques années de consommation, j'étais tombé gravement malade. J'ai été opéré suite au gastrique. Depuis ma sortie de l'hôpital, je n'ai plus repris mes anciennes habitudes. Je me sens maintenant en bonne forme » témoigne l’ex-consommateur.
« J’étais devenu consommateur des boissons frelatées à mon jeune âge. Mais en grandissant, j'ai compris que ce n'est pas bien pour moi. J'ai décidé arrêter », dit un autre.
Vendeurs malgré l’interdiction
La vente de ces boissons est interdite au pays. Mais les vendeurs arrivent à importer. Mme Solange, une veuve, mère de 4 enfants, exerce ce commerce illégal depuis 6 ans. Elle dit être au courant de l’interdiction d’importer ces produits. « Après la mort de mon mari, c'est le seul moyen que j’ai trouvé pour subvenir aux besoins de mes enfants et de moi-même », affirme-t-elle. Grossiste, elle se ravitaille depuis la ville de Kousseri au Cameroun avec toutes les tracasseries possibles pour livrer aux détaillants. « Le sachet de 100 f, je vends la douzaine à 2 000 f et celui de 50 f à 1 500 f ».
Diplômé en sciences exactes, Elias devient, après plusieurs années de chômage, vendeur des boissons frelatées. Il s’est aménagé un coin spécial avec des bancs disposés dans un kiosque pour accueillir ses clients. Dans une bassine remplie d’eau, il fait diminuer la température de ces boissons frelatées. L’endroit ne désemplit pas en soirée. « Après avoir fini mes études en licence, j'ai cherché du travail pendant 2 ans sans en obtenir. Alors j'ai commencé à vendre ces boissons. Je paie mon loyer et j'arrive à me nourrir, m’habiller et courir mes petits besoins », dit le jeune homme. Malgré l’interdiction, il continue son commerce avec tous ses risques. Il arrive que des agents de la Police municipale fassent de contrôle et les réprimandent sévèrement en confisquant toutes leurs marchandises avec des amendes.
Selon Dr Adama Dar Blagué, médecin généraliste, ces substances exercent un effet analgésique. Elles soulagent temporairement la douleur, mais n'éliminent pas la cause. Elles entraînent aussi un effet anesthésique, elle supprime la sensation de la douleur lors de la consommation. Et masquent ainsi la douleur. Aussi ces produits « stimulent la muqueuse gastrique qui produit davantage de l'acide gastrique et celui-ci entraîne une détérioration de la muqueuse gastrique qui va se manifester plus tard par des douleurs de l'estomac, des nausées et des vomissements ».
Selon Dr Adama, la consommation de ces produits est nuisible. Ils produisent d’autres problèmes de santé publique tel le vagabondage sexuel, qui fini par des grossesses indésirées et des infections au VIH Sida, infections. Et même des maladies mentales.
Pour éviter tous ces maux, elle conseille au pouvoir public de mener une compagne plus agressive d’interdiction. Et de sensibiliser les jeunes sur les conséquences néfastes de ces produits.
Orthom L’Or

Le paludisme est une maladie tropicale qui fait des milliers morts au Tchad. Une campagne de sensibilisation de 4 jours s’est déroulée au Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) dans les 10 arrondissements de N’Djamena capitale tchadienne. Reportage.
Quartier Kabalaye, il est 10h passé. Nous empruntons l’Avenue Bokassa, direction marché à mil. Un groupe de personnes habillé en tee-shirts blanc et pantalon noir fait du porte-à-porte. Ils expliquent aux N’Djamenois les dangers.
Selon Ahmadou Massing, chef d’équipe ils sont déployés sur le terrain suite à la formation qu’ils ont reçue du programme national de lutte contre le paludisme (PNLP). 15 jeunes sont recrutés pour chaque arrondissement de la ville. Selon lui, plusieurs ménages ont été visités déjà. La cible de cette campagne de sensibilisation de proximité, précise-t-il, ce sont les femmes enceintes, allaitantes et les enfants. Ils sont considérés comme des personnes vulnérables. « Le but est d’amener ces personnes cibles à utiliser les moustiquaires imprégnées et que chaque ménage garde son environnement propre », dit M. Massing. Il est aussi question de leur démontrer également le danger que représente le paludisme avec le taux élevé de décès ces derniers temps des femmes enceintes et des enfants selon le chef d’équipe.
Alice Marie, la trentaine révolue allaite son bébé, « le gouvernement a fait bien d’initier cette campagne de sensibilisation contre le paludisme qui vise les mamans », dit la jeune femme. Elle soutient que, ces derniers jours, lorsque les femmes enceintes viennent à la consultation prénatale, les sages-femmes disent qu’elles n’en ont plus des moustiquaires imprégnées. Il faut être chanceuse pour en avoir à la dernière consultation. « Ce que le gouvernement doit faire encore plus c’est de curer les caniveaux. Les eaux usées sont des nids aux moustiques », dit Mme Alice Marie.
Jadis, poursuit-elle, les agents passent par concession pour désinfecter les ménages. C’est la seule méthode efficace pour venir au bout des moustiques. Elle relève, toutefois, que c’est une bonne chose que le gouvernement se soucie de sa population. Selon elle, il y a des agents qui pendant la saison des pluies donnent le chimio prévention saisonnière (CPS), pour les enfants. Ce sont des médicaments pour prévenir le paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans, explique-t-elle. Hélas, ces agents sont incapables de fournir des informations fiables sur le produit et beaucoup de mères ne l’administrent pas à leurs enfants, déplore-t-elle.
Pour Amadou Massing, le terrain est un peu difficile, « certains ménages sont agressifs. Ils se disent fatigués de ses campagnes sensibilisations. D’autres sont disponibles et accueillants ».
Moyalbaye Nadjasna


La Journée des Droits de l'Homme est célébrée chaque année, le 10 décembre. C’est le jour anniversaire de l'adoption, en 1948, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme par l'Assemblée générale des Nations Unies. Au Tchad, comme dans les autres pays, cette journée est l’occasion pour le gouvernement d’insister sur l’importance des Droits de l’Homme en temps de Covid-19. Reportage.
La Journée des Droits de l'Homme marque la célébration de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. C’est un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction. En effet, « le 10 décembre est l'occasion de réaffirmer l'importance des Droits de l'Homme dans la reconstruction du monde auquel nous aspirons », indique la ministre Secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, dans sa déclaration, à l’occasion de célébration.
Le thème du 72e anniversaire est : « Reconstruire en mieux - Défendons les Droits de l’Homme ». Ce thème est lié à la pandémie de Covid-19. Il vise à insister sur la nécessité d'une solidarité aussi bien nationale que mondiale et de rappeler l’interconnexion et l’humanité que partagent les êtres humains. Il s’agit de mettre l'accent sur la nécessité de reconstruire en mieux, en veillant à ce que les Droits de l’Homme soient au cœur des efforts de relèvement.
« Nous n'atteindrons nos objectifs communs que si nous sommes capables de créer l'égalité des chances pour tous, de remédier aux échecs qui ont été mis en lumière par la Covid-19 et qui ont favorisé la crise et d'appliquer les normes relatives aux Droits de l'Homme », dit Mme Nour, au nom de son collègue du département de la Justice, Chargé des Droits humains. Selon elle, la crise sanitaire actuelle a été alimentée par l'aggravation de la pauvreté, l'augmentation des vulnérabilités ainsi que par d'autres lacunes dans la protection des droits humains.
Des individus aux gouvernements, de la société civile et des communautés au secteur privé, chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un monde après la Covid-19 qui soit meilleur. « Nous devons faire en sorte que les voix des personnes les plus touchées et les plus vulnérables soient prises en compte dans les efforts de relèvement ». Pour la ministre, le combat pour la défense des Droits de l'Homme ne doit pas être perçu comme seulement l'apanage des pouvoirs publics, mais il doit être l'affaire de tous.
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme est la première reconnaissance universelle du fait que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain. Ces droits inaliénables et s'appliquent à tous. Les hommes sont tous nés libres et égaux en dignité et en droits. Ce document fondateur, traduit dans plus de 500 langues différentes, continue d'être, pour chacun, une source d'inspiration pour promouvoir l'universalité des droits.
Ngonn Lokar Maurice
Le Tchad comme pays signataire de la convention de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme commémore ce 10 décembre 2020 le 72ème anniversaire de la Journée internationale des Droits de l’Homme. La Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH) et la Ligue tchadienne des Droits de l’Homme (LTDH) font leur bilan relatif aux 30 ans de Démocratie et la Liberté au Tchad. Reportage.
Le Tchad se veut un État de droit et de la liberté depuis 1995. Plusieurs instruments internationaux en matière des droits de l’homme ont été signés et ratifiés. Les jalons d’un État de Droit ont été posés à l’arrivée du président Idriss Deby Itno et de Mouvement patriotique du salut (MPS) au pouvoir en 1990. Selon Djidda Oumar Mahamat, président de la CNDH, le bilan en matière de Droit de l’Homme est moins satisfaisant. Pour lui, avant de parler de 30 ans de Liberté et de Démocratie au Tchad, il faut faire un aperçu sur les années 1980, et même avant, marquées par la terreur et la peur. C’est un moment de turbulence dit-il. « Le régime Hissène Habré arrêtait les gens et les exécutaient en totale violation les droits humains », rappelle-t-il. Le problème des droits de l’Homme concerne tout le monde. Il ne peut se résoudre que par le changement des mentalités, déclare-t-il. « Les violations permanentes de Droit de l’Homme sont multiformes. Il y a par exemple, l’excision des filles, la maltraitance des personnes, les enlèvements des personnes contre rançons, les arrestations abusives des journalistes, les bavures des forces de l’ordre dans les locaux des partis politiques et dans les organes de presse entre autres », explique-t-il.
Sur la question des éleveurs et agriculteurs, Djidda Oumar Mahamat, signifie que ces deux communautés très longtemps sont en tiré couteaux. Il déclare que c’est un conflit qui demande un travail de fond et non une sensibilisation. Il estime pour sa part qu’il faut former les spécialistes, les juges spéciaux à ce sujet. « Aujourd’hui, les grands éleveurs sont les préfets, les sous-préfets et autres responsables militaires. Ils sont souvent armés, or le Sud du pays est toujours une zone d’agriculture », confie le président de la CNDH.
D’autres voies contredisent cette thèse selon laquelle ce sont les agriculteurs qui sont toujours victimes. Ils soutiennent que l’attitude des agriculteurs n’est pas aussi neutre. Ils s’organisent pour dresser ce que les éleveurs appellent des « champs pièges » qui ont pour seul objectif de soutirer de l’argent aux éleveurs. Le problème agriculteurs-éleveurs est trop simplifié, selon les membres des organisations d’éleveurs, par les agriculteurs. Il y a plusieurs choses à dénoncer du côté des agriculteurs. L’exemple survenu il y a quelques jours au Moyo Kebbi Est où un grand éleveur peul a été égorgé par ses amis agriculteurs. Pour les éleveurs tout a été monté de toutes pièces pour assassiner un paisible éleveur. Les enquêtes, si elles sont menées avec justesse, relèveront selon les éleveurs qu’il s’agit d’une affaire d’extorsion, d’escroquerie. Cette histoire a déclenché la colère des éleveurs de la région. Cela a dégénéré faisant des dizaines de morts.
Pour résoudre ce conflit, le président de la CNDH, propose qu’un tribunal spécial et indépendant soit mis sur pied pour faire son travail en toute liberté. Et d’appliquer la loi dans toute sa rigueur pour punir les fauteurs de trouble. « On ne peut pas éteindre le feu par la salive », martèle-t-il.
La démocratie ne se proclame, elle se vit
Pour Me Loalngar Yogangnan Max, président de la Ligue Tchadienne de Droit de l’Homme (LTDH), « le bilan de droit de l’homme au Tchad est catastrophique ». Selon lui, l’année 2020, est marquée par des violations massives des libertés et droits fondamentaux de l’homme. Il cite quelques cas des viols et assassinats des femmes et des filles, les criminalités ordinaires et les conflits intercommunautaires.
Le président de la LTDH déclare qu’il y a des violences imputables à l’État. Ce sont les faits ou agissements des agents publics. « Les cas de maltraitances et des traitements inhumains et dégradants infligés à certains citoyens dans l’exercice de leur fonction. Les arrestations illégales et des détentions arbitraires effectuées par les agents nationaux de la sécurité (ANS) ainsi que certaines tortures infligées aux citoyens », constituent a insisté Me Loalngar, des entorses aux principes de droits humains.
En dehors de ces atteintes aux libertés publiques, les autorités limitent les mouvements des citoyens, dit-il. L’interdiction de certaines associations et partis politiques de se réunir. Ce sont des exemples palpant de ces violations, indique Me Loalngar Yogangnan Max. « Cette démocratie est une dictature pure et simple », martèle le président de la LTDH. Pour lui, les Tchadiens vivent dans une démocratie proclamée, mais elle n’est pas réelle. « Notre liberté naîtra de notre courage », s’exclame-t-il. La république nous appartient tous, il est inadmissible qu’un groupe taille les lois fondamentales à leur mesure, insiste-t-il.
« Quand l’État est fort, il vous écrase, quand il est faible vous disparaissez », conclut Me Loalngar Yogangnan Max sur cette phrase de l’écrivain français de Paul Valery.
Djilel-tong Djimrangué
Orthom l’Or
La question des droits humains intéresse tout le monde. La célébration de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ce 10 décembre 2020. Ialtchad a rencontré des citoyens qui ont accepté de donner leurs avis.
Citoyen : « La déclaration de Droit de l’Homme c’est tous les États du monde se sont mis d’accord pour ne pas violer les droits inhérents à un être humain. Par exemple, le respect de la dignité humaine, de l’opinion de l’autre, la liberté de circuler, etc. Nous sommes dans un pays où la démocratie n’est que théorique. La liberté est restreinte, pas de de droit à la réunion. Or la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
Étudiant : « La constitution du Tchad prône la liberté et l’égalité des citoyens. Nous sommes dans un pays démocratique. Le 4 décembre 1990, le Président de la République dans son discours lorsqu’il a renversé la dictature de Habré a dit : « Je ne vous apporte ni or ni argent, mais la liberté », mais en réalité, il n’y a pas la liberté. Je pense qu’il est temps pour que le président repense notre démocratie. Il faut que les gens se contredisent pour desceller ce qui ne marche pas et mieux orienter notre conscience nationale pour un développement radieux. Voilà mon avis, merci. »
Citoyen : « Le Tchad à l’ère de la Démocratie était bien parti. On voyait que la question des droits de l’Homme est prise au sérieux. Mais la troisième décennie est marquée par de graves violations des droits de l’Homme. C’est vrai certaines choses choquent, mais le jeu de la démocratie l’exige. Il faut que le gouvernement supporte certaines déviances si cela ne trahit pas la nation. Lorsque les gens ne se parlent pas, ils deviennent méfiants les uns les autres et cela n’est pas bon pour un État de droit et pour la démocratie. Le gouvernement doit se ressaisir et poser les choses qui fâchent sur la table pour que les Tchadiens discutent entre eux ».
Étudiant : « Depuis 1990, notre pays a connu une ère nouvelle, celle de la Liberté et la Démocratie. Au temps de la dictature, il n’y avait pas de multipartisme, pas des associations de défense des droits de l’Homme. Certes, c’est une avancée, mais ce n’est pas suffisant pour un pays qui a 30 ans de la démocratie. Beaucoup reste à faire. »
Citoyen : « Le Droit de l’Homme, c’est les libertés fondamentales comme celle de se réunir, de s’exprimer librement, aller et venir, de choisir de sa religion, etc. Au Tchad, ces fondamentaux sont là. L’État doit veiller si telle ou telle déviance est contraire à la constitution. Nous sommes tous égaux devant la loi donc le respect de la dignité de la personne d’autrui est plus que nécessaire ».
Moyalbaye Nadjasna
Kadidja Mahamat Tahi

Ce 10 décembre 2020, le Tchad à l’instar des autres pays du monde va commémorer la journée mondiale des droits de l’Homme. Ialtchad s’est rendu dans les locaux de l’Association des victimes des crimes du régime Hissène Habré (AVCRHH). C’est bientôt 6 ans que les victimes attendent d’être indemnisées. Pourquoi ça bloque ? Reportage.
La joie des victimes des crimes du régime Hissène Habré, après le procès a été éphémère. Confiants d’être indemnisées au lendemain de ce procès, tristesse et frustration semblent peu à peu les envahir. Ce lundi 7 décembre au matin, Ialtchad Presse est allé aux nouvelles dans les locaux de l’Association des victimes des crimes du régime Hissène Habré (AVCRHH) au quartier Chagoua. Quelques victimes étaient présentes. Ils se comptent au bout du doigt. Hommes et femmes sont hantés par une chose : leurs indemnisations.
Selon Abaifouta Ndokhote Clément président de l’AVCRHH, c’est avec beaucoup d’amertume qu’il réalise que le gouvernement tchadien n’a aucune volonté d’indemniser les victimes. Il se dit navré de voir les décisions de justice rendue au nom du peuple tchadien, mais 5 ans plus tard, la décision est inappliquée. D’après lui, le gouvernement brandit la crise financière pour justifier son refus de payer. « Bien que le pays ait connu la crise comme le reste du monde, mais il s’en est déjà sorti. Or le ministre de la Justice semble évoquer encore la crise. Il faut être honnête et dire que le Tchad ne veut pas indemniser les victimes », a-t-il indiqué. M. Abaifouta Ndokhote Clément affirme que c’est une question de droits et non un cadeau ni un avantage social. Il précise que le Tchad a l’obligation en tant que membre de l’Union Africaine (UA) et des Nations- unies de dédommager les victimes. Il se dit désolé et se demande « par quel miracle, des gens jugés et condamnés à perpétuité, 10 ans pour les uns et 15 ans pour les autres sont hors de la prison, sans être inquiétés. Ni les victimes ni leurs avocats ne sont avisés », cela démontre, dit-il, que le Tchad a trompé tout le monde en organisant ce procès, celui de N’Djamena. « En Gambie, Yaya Djamé est en train d’être jugé sur l’exemple du Tchad, même chose en Centrafrique. Dans les universités européennes et américaines, les gens évoquent le procès Habré ce qui constitue déjà une importante jurisprudence, un exemple à suivre », dit le président de l’AVCRHH.
Pour Abaifouta Ndokhote Clément, le Président de la République dit qu’il est victime. « Étant victime, il ne peut pas aider ses concitoyens victimes à entrer dans leurs droits ?», s’interroge-t-il.
Pour le dossier de Dakar, le président de l’AVCRHH indique que jusque-là, l’UA qui a jugé Hissène Habré laisse les choses à la traîne. « C’est un immobilisme insolant », dit-il d’un air agacé. Et pourtant, poursuit-il, l’UA est dirigée par un tchadien qui a connu les affres du régime dictatorial de l’ex-président Habré. Il relève en outre qu’on parle d’un fonds qui a été créé sans plus. « Mais qu’on nous dit au moins quand il démarre », dit-il.
Pour le dossier du procès au Tchad, « on dit qu’il n’y a pas d’argent, c’est de la rigolade ». Selon lui, la commission n’a pas besoin d’argent pour se réunir, la cour spéciale l’a déjà constitué, explique-t-il. « Franchement, ça me fait mal ; à l’heure où je vous parle, j’ai 250 cas de décès. Ces gens auraient pu se faire soigner s’ils avaient reçu leurs indemnisations. Inscrire les enfants ou même se trouver un toit. Une vingtaine des cas des malades. Je ne sais quand ils vont mourir », confie Abaifouta Ndokhote Clément.
Plus choquant encore, « nous avons écrit une demande au ministère de tutelle, particulièrement à l’Office national de la Sécurité alimentaire (ONASA) pour qu’on donne quelques « coros » aux victimes pendant le confinement de la covid-19. Mais aucune de ces institutions n’a répondu », dit le président de l’AVCRHH.
Le Tchad a reculé en matière des droits de l’Homme…
Le président de l’AVCRHH affirme qu’en matière des droits de l’Homme, le Tchad a reculé. Pour lui, les conflits agriculteurs-éleveurs, les filles violées, les stations des radios séquestrées et les journalistes violentés et mis en prison, on est loin de la démocratie. « Nous allons fêter avec beaucoup d’amertume cette journée du 10 décembre 2020. Il faudrait que le gouvernement du Tchad se ressaisisse en matière des droits de l’Homme », dit-il.
Moyalbaye Nadjasna


- Arts & Culture
- Musique
- Mode-Beauté
- Divertissement
- Sports
- Mon Pays