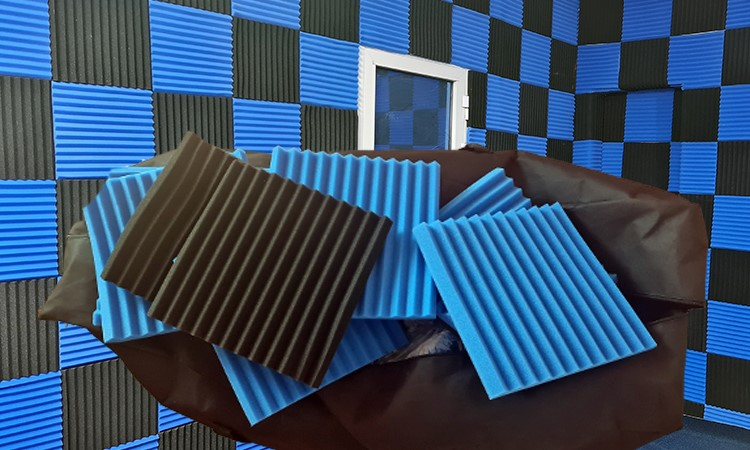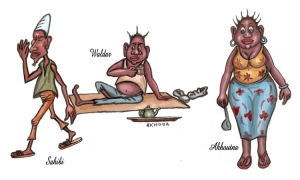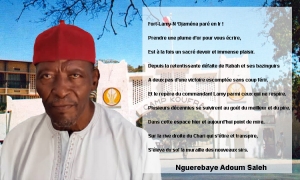A la Une
- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…
- Départ de l’armée française, merci président Mahamat
- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?
- Cérémonie de désengagement des troupes françaises
- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…
- Succès Masra, au bout de l’inconstance
- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…
- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?
- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024
- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection
Le confinement de la ville de N’Djamena suit son cours. L’arrêt des transports interurbains et urbains est un coup dur pour cette industrie. Reportage.
Deux semaines. C’est le temps que dure le confinement de la ville de N’Djamena, capitale du Tchad depuis 31 décembre. Le gouvernement a décidé de mettre en raison de la recrudescence des cas de contamination à la maladie à coronavirus. Non seulement la ville est isolée, mais les mesures sanitaires sont renforcées. Parmi celles-ci l’arrêt du transport interurbain et urbain. Depuis lors, la ville de N’Djamena est paralysée. Et l’impact économique se fait sentir pour les populations, pour les chauffeurs et les propriétaires des minibus et taxis.
Mercredi 13 janvier. A la station des taxis de Dembé, Mahamat Nasradine fait la maintenance de sa voiture, une vieille 504 Peugeot. Il est chauffeur de taxi. « J’exerce ce métier depuis 1979 », dit-il. Avec les mesures édictées par le gouvernement, il ne peut pas exercer son activité pleinement. Cela, depuis deux semaines, « C’est tout ce que nous faisons les matins depuis l’entrée en vigueur des mesures sanitaires », nous fait-il savoir. Après la maintenance, Mahamat Nasradine vient bavarder avec ses collègues devant le siège de leur syndicat. « Comme nous n’avons pas d’activité, nous passons la matinée en papotant entre collègues avant de nous disperser ».
Selon lui, parmi tous les secteurs ciblés par les mesures sanitaires, le secteur le plus touché est celui du transport. « Nous les transporteurs, nous sommes les plus touchés par cette mesure gouvernementale, surtout nous de la commune de N’Djamena », estime-t-il. « Vous le constatez par vous-même. Nous tournons et retournons nos pouces. Il n’y a rien à faire ».
Pour les transporteurs urbains, la santé c’est bien, mais il faut aussi gagner sa vie. « Cette activité nous permet de vivre au jour le jour. Restez sans activité durant 2 semaines, c’est trop pénible », souligne un autre conducteur, rencontré à la gare du marché à mil, sous couvert d’anonymat. Pour le moment, il dit vivre de ses économies. Jusqu’à quand pourrez-vous tenir ? « Pas longtemps ».
Même son de cloche chez Nasradine pour qui le transport urbain est une chaîne. Il permet de nourrir au moins cinq familles. « Un bus ou un taxi alimente le propriétaire, le chauffeur, l’apprenti, le commis de charge, le mécanicien, le laveur », dit-il. Avec l’arrêt du transport, ce sont des milliers de familles qui peinent à se nourrir et le coup économique est important.
Conséquences énormes
Hamat Mahamat est contrôleur général du syndicat national des transporteurs urbains et interurbains du Tchad (SYNAT). Selon lui, ces mesures sanitaires, salutaires, font perdre gros à l’économie nationale. « Imaginez, pour la location d’un minibus, il faut 20 000 à 30 000F CFA par jour. Faites un petit calcul et vous vous rendrez compte ce que les propriétaires des minibus perdent durant cette période de confinement », explique-t-il. Les pertes ne se limitent pas aux transports. Le syndicat dit également payer un coup, « comme il n’y a pas d’activité, les chauffeurs ne versent pas les cotisations journalières pour le fonctionnement de notre sous-bureau », soutien Hamat Mahamat. Il y a aussi les chauffeurs qui subissent les contre coups du Covid-19. « Je faisais une recette de 40 à 60 000F par jour. En défalquant ce que je dois au propriétaire, à l’apprenti et pour le carburant, il me reste 15 à 25 000F. Et maintenant, rien depuis 2 semaines. C’est terrible », dit Nasradine.
Plaidoyer
Pour l’industrie du taxi, il faut un allègement des mesures pour permettre à ses membres d’exercer leur métier. « On sait que c’est pour lutter contre la pandémie. C’est normal que l’État se soucie de la santé de la population, mais on peut alléger les mesures », dit Mahamat Nasradine. Le 14 janvier sera la fin du deuxième confinement de la ville de N’Djamena. Sera-t-il renouvelé ou pas ? Dans tous les cas, le secteur du transport implore la clémence du gouvernement. « Le gouvernement doit alléger un tant soit peu les mesures en nous permettant de reprendre notre activité dans le respect des mesures barrière comme la dernière fois », affirme le contrôleur du SYNAT.
Christian Allahadjim
Djilel-tong Djimrangué
Entre mise en quarantaine des N’Djaménois et le confinement de la ville, la plateforme syndicale revendicative du Tchad (PSRT) lance une grève totale à partir de ce lundi, 11 janvier jusqu’à la satisfaction totale de ses revendications. Ialtchad Presse est allé rencontrer le porte-parole de la plateforme. Reportage.
14h. École du Centre. Sous le gros arbre de la cour de cette école, des membres des syndicats sont assis. Ils discutent dans le respect des mesures barrières. On nous fait attendre quelques minutes. Ensuite, nous sommes reçus par Mahamat Nassaradine Moussa, Secrétaire général de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad (CIST). Il est aussi porte-parole adjoint de la plateforme revendicative.
Notre première question. En cette période difficile de pandémie de la Covid-19, est-il opportun de lancer une grève ? Il racle sa gorge et lâche « Le Tchad est vaste. Il n’y a pas que N’Djamena, bien que ce soit la capitale. Cette grève est lancée après une année de promesse creuse et non-tenues du gouvernement ». Il indique qu’en janvier 2020, la plateforme a signé un protocole d’accord avec le gouvernement. Cela, suite aux douloureuses « 16 mesures » qui ont vu les indemnités des fonctionnaires coupées à 50% ainsi que le gel des leurs avantages de carrière. Malgré cet accord, dit-il, le gouvernement n’a rien fait. « Chaque 3 ans, les travailleurs devraient avoir un salaire supplémentaire à titre de frais de transport. Sur le protocole d’accord, la plateforme a suggéré au gouvernement d’échelonner le paiement si cela va peser sur le budget de l’État », explique le porte-parole. Lors du lancement du recensement biométrique, le ministre des Finances et du Budget a promis de payer les effets des avancements et les transports sur le fonds de covid-19. Même avant cette promesse, dit-il, le gouvernement a promis de payer les transports avant décembre 2020. « Arrivée en fin décembre, le gouvernement n’a pas respecté sa promesse. Il reste les transports de 2017 à 2020. En octobre dernier, promesse a encore été faite de payer les effets des avancements, reclassements et confirmations », note-t-il.
Pour lui, la plateforme syndicale revendicative regrette le non-respect des engagements de l’État. « Même s’il a des difficultés, ceux avec qui nous avons négocié peuvent nous appeler et nous les signifier. Nous pouvons nous entendre. Mais le gouvernement a payé le salaire de décembre sans respecter ses promesses de payer aussi les avantages. Cela n’est pas anormal », dit-il. Et pourtant, le 28 décembre 2020, la plateforme a adressé une correspondance au président du Haut comité, pour l’informer du non-respect de la promesse gouvernementale. La plateforme affirme qu’elle n’est pas responsable de tout ce qui adviendra, affirme M. Mahamat Nassaradine Mahamat pour qui le gouvernement fait la sourde oreille. « C’est pourquoi le 9 janvier, nous avons convoqué une réunion élargie aux responsables des tous les syndicats membres de la plateforme. Nous avons posé le problème et la décision finale était de lancer une grève générale à partir de lundi, 11 janvier jusqu’à satisfaction totale », affirme le SG
Greve confondu au confinement ?
Retour sur la grève en période de pandémie. Le porte-parole adjoint de la plateforme persiste et estime que le Tchad ne s’arrête ni ne se résume à la seule ville de N’Djamena. « Le Tchad c’est 1 284 000km². Et d’autres villes, les autres provinces ne sont pas confinées, c’est la seule ville de N’Djamena qui est confinée. Même si certains services ne fonctionnent pas, il y a les services essentiels ici dans la capitale. A notre avis, ce confinement n’a aucun effet sur notre grève », a confié Mahamat Nassaradine Moussa. Il précise que ce n’est pas une grève sèche, mais une grève avec des services minimums dans les hôpitaux. Cependant, insiste-t-il, la grève ne sera levée qu’à la satisfaction totale. Il a rappelé aussi que le gouvernement a exigé de vérifier les actes des carrières des agents avant toute prises en compte. « A l’heure où je vous parle, plus de 6 lots sont aux finances. Le 1er lot est arrivé depuis le 04 novembre 2020. S’il y avait réellement de la volonté gouvernementale, à cette date déjà, il doit y avoir au moins un début d’exécution », conclut le porte-parole.
Il faut rappeler que la plateforme syndicale regroupe quatre centrales syndicales à savoir, l’Union des Syndicats du Tchad (UST), la Confédération indépendante des syndicats du Tchad (CIST), le syndicat national des Enseignants et Chercheurs du supérieur (SYNECS), le Syndicat des Médecins du Tchad (SYMT).
Moyalbaye Nadjasna
Suite à votre allocution prononcée devant les jeunes de Baktchoro ayant suscité l’émoi et le désarroi d’une partie de la population que vous êtes censé représenter, accentuée par le Communiqué de presse du 03 janvier, je voudrais sortir du silence observé par certains cadres intellectuels du Mayo-Kebbi et de la Tandjilé, pour vous exprimer, sans arrière-pensées ni couleur politique (c’est-à-dire loin du débat MPS/UNDR), et surtout loin de citer vos propos, mes inquiétudes, mon étonnement et vous appeler à plus de persuasion et de justesse afin d’espérer encore vous compter parmi, non pas des hommes politiques, mais tout simplement, des leaders intellectuels de nos deux régions, chantres de paix exemplaire pour tout le Tchad, notre pays.
Inquiétudes parce que la Tandjilé et surtout le Mayo-Kebbi sont constitués d’une population agropastorale vivant en quiétude depuis de nombreuses années, malgré les différends pouvant survenir entre les propriétaires des champs et ceux du bétail. Des conflits souvent réglés à l’amiable auprès des chefs de communautés (communément appelés chefs traditionnels), marginalement avec recours auprès de l’Administration publique, mais toujours sans vengeance privée. Cette quiétude est soutenue par de nombreuses alliances, amitiés, convivialités et habitudes tissées entre les couches sociales, de telle sorte :
- qu’un agriculteur achète ou loue du bétail pour labourer son champ. Et qu’un éleveur se procure jusqu’aujourd’hui du foin de l’agriculteur pour nourrir ses bêtes en période sèche ;
- qu’il n’y a pas ce qu’on appelle « le prix du sang » entre les communautés ;
- et que les promotionnaires d’École, du Collège ou du Lycée gardent leurs souvenirs d’études et leur amitié même pendant leurs carrières professionnelles.
Étonnement parce qu’on comptait toujours sur des intellectuels de la région. Ils sont presque tous, en période de crise, déshabillés de leurs couleurs politiques, de leur appartenance communautaire, de tout parti pris, pour venir calmer les esprits échauffés. Ils raisonnent les protagonistes et préservent par cette approche la paix entre les populations. Des habitants déjà imbriqués et entremêlés par leur mode de vie et leurs vécus quotidiens.
Mais vous avez fait, il me semble, le contraire lors de votre descente dans la zone de conflit.
Plus de persuasion et de justesse parce qu’il n’est jamais trop tard de rattraper ses lapsus et ses erreurs. Et même si erreur il y a, cela ne constitue-t-il pas une édification de l’esprit et des idées pour l’avenir ?
La population des éleveurs des deux régions n’attend pas de vous une réparation sous forme de dommages et intérêts, mais juste un pardon en bon fils du terroir, parent tant des moundang, des peuls, des moussey, des lélés, des massas et autres, et je pense qu’elle le mérite bien, parce que :
- le terroir est à présent répulsif au discours politicien en quête d’électorat et attentif aux actes concrets et positifs de ses fils.
- le terroir est un arbre sur lequel plusieurs oiseaux que nous sommes voleront au-dessus, finiront par nous y poser pour trouver du repos et du réconfort, et finiront par disparaître pour laisser place à d’autres de ses fils.
- le terroir mérite bien qu’on le respecte, le sanctifie et l’honore même pendant les pires des évènements.
Et le nôtre en est un exemple pour le Tchad. Il a montré, hier comme aujourd’hui, qu’il est un havre de paix pour tout le pays. Il est resté en paix même pendant les guerres fratricides qu’il a connues. Et il entend bien le rester dans l’avenir. Jetez, M. Kebzabo, votre orgueil au fleuve Logone. Votre demande de pardon sera un engrais pour la paix. La paix éternelle dans les deux régions.
Mahamoud BOUBAKARY
Ex-TPG et Cadre du Mayo-Kebbi-Est
Le confinement total de la ville de N’Djamena pour cause de recrudescence de la Covid-19 a des effets sur tous les services. Même les services de santé n’échappent pas à cela. Les couloirs de certains centres de santé de N’Djamena sont vides. Ialtchad Presse est allé constater. Reportage.
L’achalandage dans les couloirs des hôpitaux et des centres de santé où se bousculent agents de santé, patients et parents des malades est un souvenir lointain depuis le confinement des N’Djamenois.
A l’Hôpital Sultan Kasser communément appelé « Polyclinique », les couloirs sont vides. Selon le Surveillant général, Hassane Hassaballah, c’était l’hôpital le plus fréquenté à cause de sa position au centre-ville. Et surtout à proximité du grand marché central. En temps normal dit-il, l’hôpital Kasser enregistre en moyenne 150 à 200 consultations par jour. Aujourd’hui dans le contexte du covid-19 et les impacts du confinement, c’est au plus 80 consultations.
Pour lui, même le suivi et le contrôle des patients après consultations, examens et analyses sont inabordables. Le confinement fait grimper les prix. Par exemple, les patients sont incapables de payer leur transport en mototaxi « clando ». Trop cher. « C’est extrêmement difficile, il n’y a pas de transport. Avec ma fille malade, nous sommes venues ce matin en mototaxi « clando » qui nous a coûté 2000FCFA. Nous allons payer le double pour repartir à la maison. Je n’ai que 10 000FCFA, après transport et consultation, il ne me reste pas assez d’argent pour payer l’ordonnance de ma fille », dit une patiente sous couvert de l’anonymat. Elle demande au gouvernement d’alléger les mesures en remettant les minibus en circulation tout en limitant le nombre comme dans le passé pour soulager les patients.
Selon le surveillant général, la plupart des patients sont incapables de payer le transport, la consultation et l’ordonnance en même temps, « nous sommes obligés par moment de les prendre comme des cas sociaux. Ils ne paient pas. Ils sont consultés directement », dit-il. Il indique que l’équipe de l’Hôpital Kasser ainsi que ceux des centres sous tutelle sont toujours disponibles 24heures sur 24 à répondre à leur appel. Selon lui, ils craignent une chose : ceux qui faute de pouvoir payer les frais de transport, risquent de tomber dans l’automédication. « L’autre inquiétude c’est les femmes enceintes dont la plupart accouchent dans ce contexte risque d’accoucher à la maison. C’est dangereux et risqué pour la vie de la mère et de l’enfant en cas de complications », martèle, Hassane Hassaballah.
Il estime que l’État doit faire plus de sensibilisation auprès de la population. Pour lui, c’est la ville de N’Djamena qui est confinée et non la population selon les termes de la décision gouvernementale. « Il est vrai que c’est difficile, mais je demande à la population de venir plutôt dans les hôpitaux ou les centres de santé. Se soigner dans la rue est dangereux », affirme le surveillant. Il demande au gouvernement d’alléger les mesures. Surtout de permettre que le transport urbain reprenne dans le respect strict des mesures de distanciation sociale. « S’il y a le transport, les gens viendront se soigner dans les hôpitaux ».
Moyalbaye Nadjasna

La reconduction du confinement de la ville de N’Djamena suscite des réactions. Beaucoup se disent déçus par cette décision.
Avec la nouvelle vague de contamination de la Covid-19, le gouvernement a pris des mesures drastiques afin de limiter la propagation. Le confinement de la ville de N’Djamena décrété le 31 décembre puis reconduit le 7 janvier, pour une semaine, ne fait pas l’unanimité malgré la virulence de la maladie.
Dans les carrefours (les lieux de regroupement des jeunes) et ailleurs, le sujet de conversation est le confinement de la ville de N’Djamena. À Habbena dans le 7e arrondissement, quelques jeunes conducteurs de moto taxi discutent sur la prorogation du confinement. À notre arrivée, ils nous disent, « vous êtes bien arrivés ».
Parmi ces jeunes, Rondounba Laouroutou, la mine grave, s’emporte « le gouvernement veut nous tuer à petit feu. » Pour lui, ce confinement ne respecte pas les normes. Le gouvernement n’a même pas pris en compte les conséquences de cette décision. « La population a le droit d’être préparée avant qu’une décision la concernant ne soit appliquée », dit-il. Pour Rondounba, c’est un jeu politique, « Ils nous confinent sans les mesures d’accompagnement alors que le Tchadien vit de son quotidien. Les petits métiers sont tous arrêtés et il est difficile de joindre les deux bouts il faudra qu’ils nous trouvent une solution sinon nous sommes prêts pour sortir dans les rues », prévient-il.
Elysée Ngaramadji, lui aussi conducteur de moto taxi est contre ce confinement. Selon lui, c’est une manipulation de la part du gouvernement. « Au Tchad, on vit au jour le jour », dit-il. Les activités génératrices des revenus sont au ralenti les ménages ne peuvent se nourrir puisqu’il y a aucune activité économique, explique-t-il. « Ce confinement est un jeu politique », affirme Elysée. Selon lui, il faut laisser les gens vaguer à leurs occupations. « Je demande au gouvernement de faire preuve d’indulgence », supplie-t-il.
Bien que ce confinement ne soit pas total comme au début, la population souffre selon plusieurs citoyens. Les commerces non essentiels fermés, le transport urbain suspendu, les bars et restaurants fermés, des gens tournent en rond.
Max Loalngar, président de la Ligue tchadienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) dans un communiqué de presse, a exhorté le gouvernement à ne pas renouveler ces mesures. Selon lui, le renouvellement de cette mesure relève pose problème. « Les libertés publiques sont du domaine législatif. Il est inadmissible que le pouvoir exécutif prenne des actes sans en référer au pouvoir législatif et les imposer à la population comme s’il s’agissait des lois », proteste Me Max Loalngar.
Les mesures d’accompagnement mis en place par le gouvernement ne sont pas du goût du président de la LTDH. Pour lui, la distribution des kits alimentaires prévue par le gouvernement n’est que poudre aux yeux, « pendant la première vague, le gouvernement n’a pas été en mesure d’alimenter les vulnérables. Ce n’est pas cette fois-ci qu’il en aura la capacité », dit-il. La seule solution viable est « de permettre aux N’Djamenois d’être libre de toute contrainte à part l’application stricte des mesures barrières pour pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins. »
Djilel-tong Djimrangué

Le décret portant prorogation du confinement de la ville de N’Djamena vient d’être publié. La ville reste encore isolée pour une semaine avec des mesures un peu allégées.
Les N’Djamenois attendaient avec impatience ce jeudi 7 janvier 2021 pour savoir si le confinement de la capitale allait être levé ou prorogé. Ils sont désormais situés. Le décret portant prorogation du confinement de la ville de N’Djamena a été publié ce soir.
Il proroge le confinement de la ville de N’Djamena pour une semaine de plus. Du 7 au 14 janvier. Le décret a repris en totalité les mesures contenues dans le décret du 31 décembre 2020.
Durant une semaine encore, les frontières terrestres et aériennes de la ville de N’Djamena sont fermées ainsi que les lieux de culte, les bars, les restaurants, les établissements scolaires, les services publics non essentiels et les attroupements lors des funérailles, de baptême et de mariage. Les transports interurbains et urbains sont interdits.
Sur le chapitre des dérogations, le nouveau décret a pris en compte quelques éléments nouveaux. Il s’agit de la presse publique et privée autorisée à fonctionner pendant ce temps ainsi que les centres commerciaux et les services de distribution du gaz et des produits pétroliers. Le précédent décret ne les a pas mentionnés. Le couvre-feu, précédemment à 18heures, est repoussé à 19 heures.
Ce qu’il y a lieu de souligner est que le terme « confinement » qui a semé de confusion et contradiction au sein du gouvernement a été repris encore dans ce décret. S’agit-il cette fois-ci d’un confinement de la population ? Le nouveau décret n’a pas plus de précision que l’ancien.


Situé dans les quartiers sud de la ville de N’Djamena, capitale du Tchad, le Centre Don Bosco (CDB) a mis la formation professionnelle au cœur de ses activités. Un grand projet consacré à l’agroalimentaire verra bientôt le jour. C’est le troisième article d’une série sur les lieux de culture et des formations Reportage.
Le Centre Don Bosco, pour mieux exécuter sa mission, a acquis un terrain d’une dizaine d’hectares. Et y a construit des bâtiments. Il est situé à 50 km de N’Djamena, la capitale du Tchad, précisément à Mandalia, une petite bourgade en banlieue sud. Selon le père Jiojo, sur ce site un grand complexe sera bientôt ouvert. Ce nouveau centre aura un internant d’une capacité d’accueil de 50 à 60 d’élèves, des logements pour les formateurs, des magasins, un poulailler, une porcherie, une unité de production d’huile d’arachide, 2 hectares équipés de système d’arrosage de goutte-à-goutte. Tout est fin prêt. D’ici à 2 semaines, la formation des jeunes en agroalimentaire va démarrer. Plusieurs domaines d’enseignement et de programmes agroalimentaires seront lancés.
D’abord, il y aura une formation en production végétale, animale et agroalimentaire. Par exemple, il y aura la culture de la banane, de la pomme de terre, etc. L’ambition du CDB est de tirer à la baisse le prix de la pomme de terre importé du Cameroun. « Il n’est pas normal d’acheter 1 banane à 100 FCFA. A ce prix on devait normalement s’acheter au moins 3 bananes ».
Le centre de Mandalia s’est fixé comme défi de répondre aux besoins de la population de N’Djamena et de ses banlieues. « Nous allons faire de la mécanique agricole, de la mécanique auto. C’est-à-dire fabriquer des outils agricoles et les utiliser. Les tracteurs, les tondeuses électriques ou mécaniques, les semeuses automatiques, etc. Tout cela va entrer dans la formation des jeunes », insiste le père Jiojo. Le CDB voit grand et en perspective, il y a aussi la fabrication des batteuses de mil, d’arachides de haricots, les presses à huile.
Former des fleuristes et des livreurs
Ensuite, le CDB envisage de proposer aux jeunes des métiers comme, par exemple fleuriste. Pour expliquer cette ambition, le religieux affirme, « nos grands hôtels ici en ville ont besoin des fleuristes formés et quand ils font d’appel d’offres, aucun jeune n’a le diplôme requis ». Il a fallu faire appel à un Indien d’origine pakistanaise pour pourvoir le poste. Ainsi pour père Jiojo cette formation répondra aux besoins des grands hôtels de N’Djamena et au-delà aux besoins des particuliers. « Un fleuriste est payé deux fois plus que le SMIG. C’est un plus pour les jeunes tchadiens », dit M. le directeur.
Aussi, le CDB formera des livreurs. Ils seront la courroie de transmission entre le consommateur et les agro businessman. « L’idéal pour Don Bosco c’est de devenir une école qui forme pour le métier et le besoin du marché d’emploi. C’est pourquoi il faut des spécialistes », affirme le directeur.
Autres formations en vue, c’est la formation technique. Le but est d’avoir des techniciens de conception. « Ce pays a besoin de milliers des jeunes formés et qualifiés. Nous avons besoin des appuis multiformes », dit père Jiojo. Le CDB reçoit l’aide de l’État tchadien sous forme d’exemption foncière, et au moins 8 enseignants sont mis à la disposition du Centre. Mais ses ressources proviennent en grande partie des frais de scolarité. D’autres partenaires viennent en appui au Centre. Il y a entre autres : la mairie, l’Ambassade de France, les ONGS HCR, IRC, Handicap International, l’Ambassade de Suisse, Slovaquie, la Conférence épiscopale de l’Italie et les parents qui sont nos meilleurs et fidèles partenaires. Il y a aussi les bienfaiteurs à l’Église et l’Ambassade d’Allemagne qui à travers une ONG a aidé à construire les bâtiments actuellement à Mandalia, etc.
Enfin, le centre est ouvert à tout le monde, protestants, musulmans et animistes. « Nous accueillons tout le monde. Nous avons une maquette des bâtiments scolaires en projets pour une capacité d’accueil de 3000 élèves. Nous comptons sur l’appui des partenaires pour sa réalisation », conclut le père Marius Jiojo ».
Autres précisions : Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né Giovanni Melchior Bosco le 16 août 1815 à Castelnuovo d'Asti (village de la principauté du Piémont faisant alors partie du Royaume de Sardaigne), et mort le 31 janvier 1888 à Turin (Italie). Il est un prêtre italien.
Moyalbaye Nadjasna
Officiellement les N’Djamenois sont en confinement total depuis le 1er janvier. Mais sur le terrain, montre tout le contraire. Les grandes artères de la capitale tchadienne sont bien animées. Ialtchad Presse a fait le tour de la ville. Reportage.
Il s’agit du confinement total, personne ne doit sortir de sa maison sauf force majeure ou pour se ravitailler, a martelé le ministre d’État, ministre secrétaire général à la Présidence M. Kalzeubé Payimi Deubet le 2 janvier dernier. Cependant, depuis l’entrée en vigueur de cette décision, les N’Djamenois défi cette décision et circulent normalement comme si de rien n’était. Est-ce un ras-le-bol ou une désobéissance à la loi ?
10 h. Mercredi 6 janvier. Nous avons parcouru les principaux axes de la ville. Il est difficile de traverser une voie pour une autre. La circulation est dense. Chacun est happé par ses courses du quotidien : vendeurs d’essence à la sauvette, marchands ambulants des paires de lunette, réparateurs des motos, ouvriers sur les chantiers, etc. Sur les artères des marchés, les mamans, jarres sur leurs têtes s’affairent, des jeunes gens s’activent cache-nez au menton, menuisiers et charpentiers ont ouverts leurs ateliers. Tous bravent l’interdiction de sortie décréter par le gouvernement. Les autorités ont tenté d’appliquer la force en déployant l’armée. Mais les N’Djamenois refusent d’obtempérer. « Nous tenons beaucoup à plus à notre survie quotidienne, qu’au risque de contracter le coronavirus », dit un passant sous le couvert de l’anonymat.
En fait, 24h après l’annonce de la mesure, l’ambiance habituelle a repris le dessus. Et la confusion que le gouvernement sème dans l’interprétation du décret portant confinement de la ville de N’Djamena, semble galvaniser les N’Djamenois. Ils en profitent. Sur certaines petites avenues, par exemple au quartier Zongo réputé être celui des mécaniciens par exemple, les gens s’attroupent et se bousculent sans s’inquiéter du coronavirus.
Certes, exception est faite à certaines activités notamment, les centres de santé, les cliniques privées, les boulangeries, les pharmacies, les sapeurs-pompiers, les hôteliers, le personnel de la Société nationale d’électricité et la Société Tchadienne des Eaux, les étals, etc.
Au marché Dombolo, non loin de l’Hippodrome, l’attroupement des clients, vendeurs de tomate et mototaxis (clandoman) inquiètes. « Il est vrai, il s’agit de notre vie et de notre santé, mais le gouvernement exagère. D’ailleurs, ils ne se comprennent pas entre eux », disent-ils.
Selon les N’Djamenois, ils écoutent la radio, regardent la télévision et lisent la presse électronique et traditionnelle. Ils demandent aux autorités de les comprendre. « C’est difficile de rester à la maison. Comment nourrir la maisonnée alors », se plaignent-ils.
Selon plusieurs citoyens, il faut bouger pour trouver de quoi manger. « On sait qu’on prend des risques, mais la vie elle-même est un risque. C’est bien que les autorités se soucient de notre santé, mais la faim est aussi une maladie. Une décision pareille doit être suivie par des mesures d’accompagnement. Et vous verrez que personne ne défiera cette mesure », s’énervent-ils en haussant le ton.
Selon le sociologue Mbété Nangmbatnan Félix, le non-respect du confinement par les N’Djamenois s’explique par la question de subsistance. « Il y a plusieurs facteurs, mais le principal est la difficulté de la population à se nourrir », dit-il. Surtout que les habitants de N’Djamena vivent dans l’informel. À ce moment le confinement est presque impossible. Sinon, dit-il, à court terme c’est la mort « les gens ne pourront pas survivre », ajoute-t-il.
Selon le sociologue, même si le gouvernement a averti la population, le confinement ne pourrait pas être respecté. « Le problème fondamental est la capacité à être confiné. Les gens ne peuvent pas. Ils n’ont pas les moyens », justifie-t-il.
Mbété N. Felix trouve que le couvre-feu de 18h à 5h du matin cause des préjudices à une catégorie de la population. « Il y a des mamans qui tiennent des restaurants de fortune la nuit, les bars qui fonctionnent en grande partie la nuit. Empêcher ces personnes de sortir le jour et d’exercer encore la nuit ne peut que les amener à braver la loi», dit-il.
Mbété N. Felix demande aux autorités d’intensifier la sensibilisation sur les mesures de prévention, « plusieurs citoyens ne se sentent pas concernés. Ils pensent que c’est la maladie des N’Djamenois ».
Moyalbaye Nadjasna
Christian Allahadjim
- Arts & Culture
- Musique
- Mode-Beauté
- Divertissement
- Sports
- Mon Pays