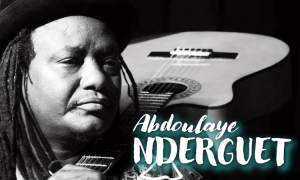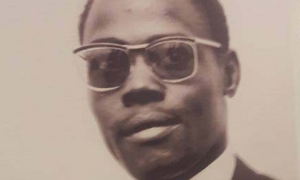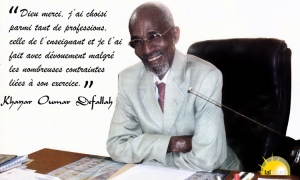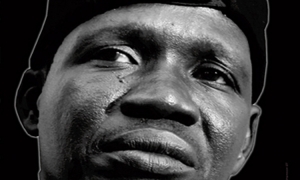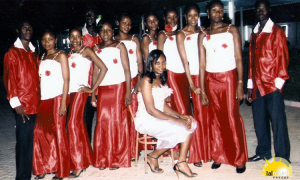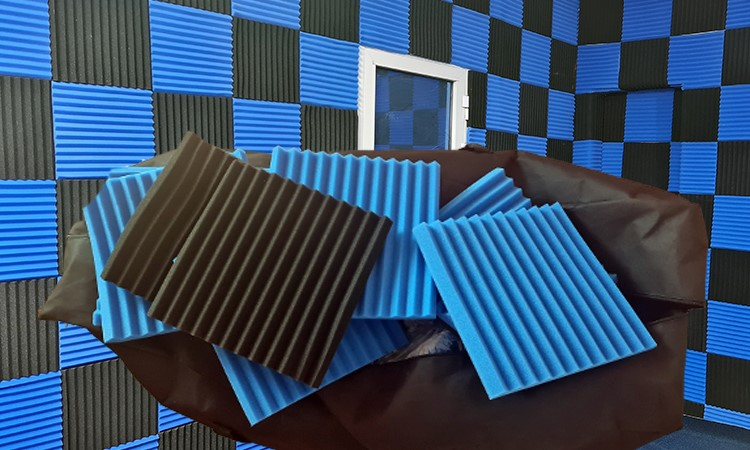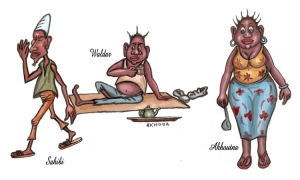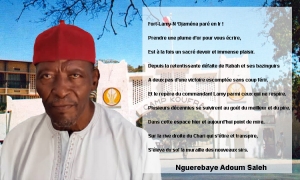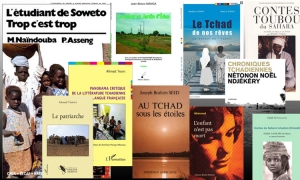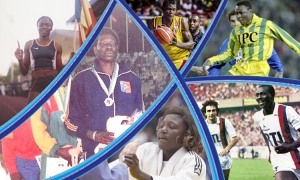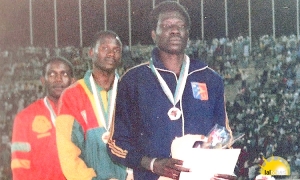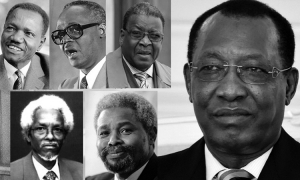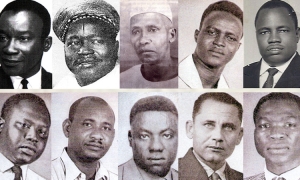A la Une
- La plateforme « Tchad d’abord » dénonce les propos d’un…
- BEAC : Nouvelle gamme de monnaie mise en…
- Kabadi : L’homme qui refusa le pouvoir
- Amdjarass, source d’inspiration présidentielle
- AES-OIF : les enjeux d'une rupture géopolitique
- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…
- Départ de l’armée française, merci président Mahamat
- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?
- Cérémonie de désengagement des troupes françaises
- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…
Les cours sont suspendus ce matin du mardi 25 mai, les salles des classes des établissements scolaires de N’Djamena sont hermétiquement fermées. Ialtchad Presse s’est descendu au bureau du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), province de Ndjamena sis à l’école du centre pour comprendre les raisons de cette suspension. Reportage.
C’est un silence cimetière ce matin dans les établissements scolaires de N’Djamena. Les cours des écoles ressemblent à un village fantôme. Rien ne raisonne dans les cours et les salle de classes. Pas les voix des enseignants ni ceux des écoliers. Quelques enseignants regroupés dans quelques établissements visités condamnent la bavure policière dans les établissements scolaires. Au sujet de la suspension des cours, certains s’inquiètent du retard sur les programmes scolaires. À l’école du centre, quartier général du SET, comme d’habitude, sous l’ombre d’un gros arbre, quelques enseignants échangent amicalement. Nous nous présentons devant le bureau du secrétaire général. Il nous reçoit très cordialement et nous confie volontiers à son Adjoint M. Dion-Nadji Moise pour répondre à nos questions.
M. Dion-Nadji Moise, relève que par un communiqué du 24 mai, le SET, province de Ndjamena a suspendu les cours dans les établissements scolaires pour la commune de Ndjamena, jusqu’à nouvel ordre ce 25 mai 2021. Selon lui, l’arrêt des cours décidé par le syndicat vise à protester contre les bavures policières, répétitives dans les différents établissements scolaires de la capitale. « Les policiers pour une petite altercation entre les enfants interviennent pour jeter des gaz lacrymogènes de manière brutale et disproportionnée. Vous savez, la plupart des policiers ne connaissent pas le droit. Ils doivent comprendre que les établissements scolaires sont des sanctuaires inviolables », dit-il. Pour lui, la bonne procédure voudrait que les responsables de la police s’approchent des directeurs des établissements scolaires pour s’enquérir de la situation. D’après lui, si une telle démarche est respectée, cela permettra à la police d’agir correctement pour circonscrire le problème. Le gaz lacrymogène, dit-il, peut être utilisé en dernier ressort selon la situation.
« Nous allons nous concerter dès demain pour voir ce qu’il y a lieu de faire… »
« Ce qui fait mal ce qu’ils larguent sur leurs engins nocifs sur des enfants. Ce sont nos progénitures. Nous les avons envoyés à l’école pour apprendre. Pas pour être gazés. Surtout que cela se répète et sur plusieurs semaines déjà. Vraiment on en a ras-le- bol », peste M. Dion-Nadji. Le SGA du SET-Ndjamena, affirme que la vie humaine est sacrée et n’a pas de prix. Il renchérit que les enfants ne sont pas envoyés à l’école pour subir de telle maltraitance.
M. Dion-Nadji Moise rappelle que selon les informations qui sont parvenues à leur bureau, les diplômés en instance d’intégration qui seraient allés au lycée d’Amtoukouin demander aux responsables de l’établissement de libérer les enfants. « Après s’être opposés, ils ont sifflé et les bruits des sifflets ont alerté les enfants. Se sentant en insécurité, les élèves sont sortis en catastrophes et la police est venue larguer du gaz lacrymogène dans l’enceinte de l’établissement. Plusieurs élèves étaient mal en inhalant ce gaz toxique », relate-t-il. Le SGA soutient qu’ils sont aussi soucieux de l’avenir des enfants, mais ce qui s’était passé est inadmissible. « Nous comprenons aussi la préoccupation des enseignants qui tiennent à finaliser les programmes avant d’arriver aux examens prévus en août. Nous allons nous concerter au niveau de la province avec les membres du bureau dès demain pour voir ce qu’il y aura lieu de faire ».
Il rajoute que les enseignants veulent finir avec l’année scolaire 2020-2021. Il affirme que les cours reprendront sans préciser quand. Fait notable à signaler, il n’y a pas des cas d’arrestations d’élèves sauf qu’il y eu quelques blessés, conclut-il.
Moyalbaye Nadjasna
Le recyclage des pneus usagés est un secteur d’activité très peu connu. Les artisans tchadiens font un formidable travail de transformation en redonnant une vie utile aux pneus contribuant ainsi à améliorer sans le savoir l’environnement. Ialtchad Presse vous amène à la découverte d’une des activités des artisans qui recyclent ces pneus usés en des pièces de rechange pour moto et véhicule ou en sandalette. Reportage.
Dembé, dans le 6e arrondissement de N’Djamena. Du côté du carré Bulldo, derrière le gouvernorat et la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT), Brahim Abdoulaye est installé dans son atelier. Il est en train de limer une pièce de rechange fabriquée localement. Juste en face de lui, son client l’attend. La livraison faite, Brahim est disponible. Et top chrono le reportage sur son activité démarre.
Le quartier Bulldo, diminutif de bulldozer, est le quartier général des fabricants des pièces de rechange locales à base des pneus usés. Tout le long du mur du gouvernorat et de la CNRT, il n’y a que leurs ateliers.
Il y a deux ans que Brahim Abdoulaye a ouvert cet atelier de fabrique de ces pièces de rechange locales de moto et de véhicule. Plus précisément des pièces qui ne concernent que la roue. « Le plus souvent, j’achète les pneus chez des garagistes », dit-il. Le prix varie selon l’état et la taille des pneus : 7 500, 10 000, 15 000F, etc.
Pour se procurer des pneus, Brahim et son coassocié se permutent à l’atelier. Un jour, l’un va faire le tour des garages pendant que l’autre travaille à la fabrique. Ainsi de suite. Pour éviter des ruptures et faire face à la concurrence, les associés s’approvisionnent en quantité et selon leurs moyens.
Un travail simple, mais méthodique
Pour transformer ces mastodontes de pneus en de petites pièces détachées, Brahim Abdoulaye n’a besoin que des couteaux fabriqués artisanalement, des marteaux, de tournevis et de l’eau mélangée avec du détergent. « Ce n’est qu’avec ces matériels que je travaille », confie-t-il. Et le travail semble être facile pour celui qui redonne vie aux pneus. Il suffit qu’il trempe le bout du couteau dans l’eau composée, et le pneu cède facilement sous son action. Surprenant en le voyant à l’œuvre.
Quand le pneu est acheté, le fabricant enlève d’abord les fers qui s’y trouvent. Ce qui peut être utilisé pour la fabrication des fourneaux. Ensuite, le chef d’œuvre découpe le pneu selon le besoin. Avant de le modeler selon la commande. « On ne fabrique que des joints (sourambloc) pour les roues. Il suffit d’apporter le modèle et on s’y met », fait-il savoir.
D’après cet artisan, ces pièces de rechange locales sont plus sollicitées que celles originales. « Nous vendons moins cher et, en plus elles sont plus durables », vante-t-il la qualité de ses produits. Leurs clients favoris sont des mécaniciens et des vendeurs détaillants des pièces détachées. « On vend quatre joints pour la moto à 750 ou 1 000F ; pour les véhicules, un à 1 000, 1 500F », renseigne-t-il.
À côté des pièces de rechange, Brahim fabrique aussi des chaussures faites à base des pneus. Localement ces babouches sont appelées « moutt khali », littéralement « il te survivra » Ces sandalettes tout terrain se vendent à 750F pièce.
Évoluant dans l’informel, Brahim dit payer régulièrement des droits à la mairie. « Chaque mois je verse des droits à la commune », dit l’artisan à l’agilité enviable. Combien il paie à la mairie ? Il refuse d’en dire plus.
Christian Allahadjim
Allarassem Djimrangar
Donc, la position officielle de l’Union Africaine (UA) est connue. Après moult atermoiements et un long silence gênant. Pas de sanctions, une bonne chose pour le Tchadien lambda. Pas de condamnation du coup d’État, une mauvaise chose. L’UA a choisi d’accompagner la junte avec des conditions. Est-ce le bon remède? L’UA a-t-elle posé le bon diagnostic? Est-elle le bon docteur au chevet du grand corps malade, le Tchad?
D’abord, pour éviter de prononcer ces deux mots « coup d’État », un long communiqué officiel aligne les :
« Prenant note… », « notant les déclarations faites par… », « appelant en outre les dispositions .. », « attirant particulièrement l'attention… », « prenant dûment note du rapport de la Mission d'enquête… », « compte tenu de la complexité de la situation politique et sécuritaire.. » etc.
En fait le docteur UA a dit beaucoup de choses, mais à soigneusement évité de dire le plus important : condamner fermement le coup d’État. Ensuite, le docteur a écrit son ordonnance au malade : un gribouillage en guise des mesures d’accompagnement et ses restrictions. Il aurait fallu condamner pour ensuite faire avaler facilement la pilule. Et pourtant cette condamnation était facile à dire et serait en symbiose avec les principes de l’UA. Elle devrait figurer dans les premières lignes de tous ce jargon bureaucratique. L’UA a démontré qu’elle était incapable de nommer les choses. D’être simplement intelligente. En refusant de condamner, le coup d’État, elle est entraînée par les « spin doctors » de la junte à poser le mauvais diagnostique. En poussant l’analogie médicale plus loin, l’UA ne pourra pas bien administrer son remède à son patient. Elle n’est, peut-être pas, le bon docteur. Tellement pas bon docteur qu’elle n’est obsédée que par la question du terrorisme, de stabilité et de sécurité. Elle a oublié une réalité importante : le. Tchad n’a jamais eu depuis 30 ans une armée nationale et républicaine. C’est plutôt une armée clanique au service des intérêts d’une catégorie de personnes. La majorité des Tchadiens interrogés aurait pu éclairer les experts africains lors de leur séjour au pays au fort moment de la crise. Bref, les recommandations de ce « grand machin africain » se buteront aux réalités têtues de l’exercice clanique du pouvoir.
Ensuite, au sujet des sanctions, très peu de Tchadiens sont pour les sanctions. Ce qui est détestable c’est de stigmatiser tous ceux qui brandissent ou promeuvent les sanctions. Ils sont perçus du coin de l’œil comme des traîtres à la nation alors qu’il s’agit bien d’un coup d’État. Un coup difficilement justifiable sur le court terme et insoutenable pour le long terme au cas où la junte tente de s’accrocher ou de proroger les délais de 18 mois. Contrairement aux discours ambiants, les réalités ne peuvent être au-dessus des textes. Cet étrange argument servi par les tenants du pouvoir pour faire croire que les principes institués dans la Constitution sont des idées hors du réel est irrecevable. Pourtant tout le monde sait que ce sont les principes qui sont la matrice des réalités dans la mesure où les acteurs sont de bonne foi.
Aussi, au jour d’aujourd’hui, personne ne peut justifier en quoi l’imposition du président de la transition Mahamat Kaka est conforme aux réalités. Elle n’est rien d’autre qu’une grosse entorse à la réalité constitutionnelle et institutionnelle. Tous ces agissements, ceux de l’UA et de certains opposants tchadiens, qui ont joué aux « infirmiers soignants » du malade Tchad, peuvent encourager la junte à ne rien céder. En justifiant leur ralliement ou en accompagnant la junte militaire par la « realpolitik », cette opposition fait de la « petite politique » au bénéfice de leurs chapelles politiques. L’écrivain français Voltaire disait que la politique est le moyen des hommes sans principes pour diriger des hommes sans mémoire. Peut-être qu’enfin les Tchadiens auront de la mémoire pour faire payer ces hommes politiques « courts-termistes ». Et qui ont sciemment ou inconsciemment fait rater une occasion unique de rassembler les Tchadiens pour redresser le pays.
Enfin, pour le Tchad les principes sont importants pour changer la réalité, car le pays est à un tournant majeur. Quand on entend ceux de l’opposition qui se sont précipités pour « accompagner » la junte, on y décèle une prétention naïve de croire qu’ils sont réalistes. Et qu’ils arriveront à petite dose à déjouer les ambitions de la junte. Une junte qui se pose en héritière du régime passé. Les opposants qui y participent n’ont aucun plan, aucune stratégie pour contrecarrer la junte qui a tous les leviers du pouvoir entre les mains. Ils n’ont rien fait de positif sinon à contribuer à affaiblir l’opposition. Ils ont par leur précipitation poussé la société civile à jouer leur rôle. Fort probablement, ils reviendront demain, au nom des principes, dirent aux Tchadiens qu’il faudra changer de prince. Alors qu’ils ont tout fait pour rater cette ultime occasion de remettre les compteurs à zéro. Et de donner la chance à ce pays meurtri de renaître de ses cendres.
Bello Bakary Mana
L’œil est une machine optique sophistiquée de grande qualité. Chez l’être humain, le fonctionnement du système visuel est souvent affecté par des nombreuses maladies oculaires. Ces maladies peuvent conduire à la cécité. Pour pallier et prévenir le pire, les spécialistes conseillent la consultation et le port des lunettes correctrices. Ialtchad Presse vous propose un premier reportage d’une série de 2 articles suivie d’une entrevue.
Beaucoup des Tchadiens portent des lunettes correctrices sans une prescription médicale. C’est le cas de Bienvenue Ningatoloum, 50 ans. Il refuse d’être photographié, mais confesse qu’il a l’habitude de se procurer ses lunettes au grand marché chez les vendeurs sans prescription médicale. Pourquoi vous ne consultez pas voir un ophtalmologue ? Il répond : « Je n’ai pas les moyens. Il ne me reste pas longtemps à vivre. Je me débrouille avec celles du marché pour ma lecture. Et ça marche.» Le vendeur, lui, refuse qu’on photographie son étal de lunettes. Mais il accepte de parler, « beaucoup de personnes achètent les verres correcteurs et les lunettes de soleil au marché. Ils les essaient sur place, si le produit leur convient, ils concluent le marché », dit-il.
Nous sommes à la clinique Espoir de Vue, au Nord de la capitale tchadienne, N’Djamena, dans le 3e arrondissement, sur l’avenue Maldoum Bada Abbass. Dr Mahamat Adam Diko, médecin ophtalmologiste à l’Hôpital Général de Référence nationale (HGRN) nous accueille dans son Cabinet. Nous engageons les échanges sur les maladies de vue et sur la nécessité du port des lunettes correctrices, Dr Dicko campe le décor, « en sciences, pour aborder un sujet, il faut les statistiques.» Les différentes maladies imputables aux corrections de vue, dit-il, sont nombreuses, les principales sont les amétropies sphériques, la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie. Selon lui, 80% de la population mondiale est porteuse de l’amétropie. « Je parle de mondiale parce qu’on n’a pas de statistique au Tchad. Aucune étude n’a été menée concernant le problème de la vue ici au pays ». D’après lui, une étude démontre que d’ici l’an 2050, 50% de la population mondiale sera myope.
À propos du port des verres correcteurs sans une consultation médicale, l’ophtalmologue se dit écœuré par le comportement de la population. « Aller se procurer les verres dans la rue est très dangereux. Il faut d’abord consulter un médecin ophtalmologue. Après examen, il doit prescrire une ordonnance de lunette avec toutes les informations. C’est la consultation qui détermine le degré du verre. C’est à l’opticien de les confectionner », affirme Dr Mahamat Adam Dicko. Pour l’ophtalmologue, les Tchadiens n’ont pas une culture de port de lunettes. Il donne un exemple en estimant que la majorité des femmes ont des problèmes de vision, mais elles refusent de porter les lunettes. « Les problèmes profonds de la vision ne peuvent être corrigés que par des lunettes médicales adaptées ».
Un opticien pour adapter l’équipement visuel
Avenue Goukouni Wedeye, non loin du grand marché. Nous sommes chez un opticien. Il s’appelle Mahamat Adoum Maïna. Nous essayons de comprendre le mécanisme d’adaptation d’équipements visuels. Il exerce ce métier d’opticien depuis longtemps. « Je monte les verres sur place. Nous ne fabriquons pas les lunettes correctrices, mais nous les importons. Elles viennent en pièces détachées et nous les montons et l’adaptons aux clients en fonction de leurs ordonnances délivrées par un ophtalmologue ». Il rajoute qu’il a des machines qui lui permettent de monter plusieurs qualités des verres. Les clients choisissent les cadres qui leur conviennent. Et on leur fait le travail, dit-il. « Il y a les verres médicaux qui viennent avec une photo antireflet, pour ceux qui ne supportent pas le vent, la lumière des ordinateurs, la lumière du soleil. Il y a aussi les verres pour la lecture pour ceux qui ont un problème de vue de près. Les verres progressifs sont combinés pour corriger les problèmes de vue de loin et de près en même temps», dit l’opticien. M. Maïna, affirme qu’il y a des personnes qui achètent les lunettes correctrices dans les rues. Après, ils viennent faire le test de degré. D’après lui, ils ne reçoivent que les personnes qui se sont fait consulter et possèdent des ordonnances délivrées par des ophtalmologues. « Nos verres sont testées et avec des numéros. Lorsqu’on les monte, on demande aux clients d’aller les confirmer auprès de leur ophtalmologue avant de les porter».
En conclusion, Dr Mahamat Adam Dicko, réclame des pouvoirs publics plus de sensibilisation sur les problèmes liés à la vue.
Moyalbaye Nadjasna
La vente du pain à la sauvette aux abords des différentes artères de la capitale tchadienne, N’Djamena, offre aux jeunes désœuvrés des revenus d’appoint. Cette activité pratiquée à la criée depuis belle lurette a le vent en poupe malgré les risques encourus. Reportage.
Chaque matin, dès les premières heures de la journée, les jeunes vendeurs de pain à la sauvette se placent aux carrefours stratégiques à grande circulation comme les ronds-points pour écouler leurs produits. Plastique en main contenant un tas de cinq pains, ils faufilent entre la circulation pour dénicher les clients. La présence d’un client les attire on dirait un essaim d’abeilles ou des mouches. Chacun cherche à brandir et faire valoir la qualité de son pain. Parmi ces vendeurs à la sauvette, il y a des pères de famille qui se battent à tout prix pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce métier n’est pas sans conséquence. Ceux qui le pratiquent sont souvent victimes d’accident de voitures ou de motocyclistes. Ils perturbent aussi la circulation, et créent des embouteillages surtout aux ronds-points aux heures de pointe.
En cette matinée du 11 mai au rond-point double voie, les vendeurs ambulants du pain ne sont nombreux. Seulement quelques têtes se servent des tables, juste derrière la chaussée pour vendre leurs pains. Malgré la température très élevée ces derniers temps à N’Djamena, ces vendeurs sont courageux, et endurants. Les vendeurs accostent les clients dans les différentes langues parlées en ville. Cela va du Sara au Ngambaye en passant par l’arabe et le français.
Interrogés, des vendeurs affirment que plusieurs Tchadiens trouvent ridicule ce métier alors qu’il assure la ration familiale. « J’exerce cette activité non pas par suivisme ou encore par désir. C’est par contrainte. Car, après mes études en histoire, je n’avais personne pour m’appuyer. Et de surcroît, j’ai une famille. C’est la raison pour laquelle, depuis 2012, je me suis lancé dans cette activité pour subvenir aux besoins vitaux de ma famille», dit Ngarassem, un diplômé sans emploi rencontré au rond-point double voie. D’après lui, il achète un pain à 75 francs CFA, à la boulangerie Hanana d’Atrone pour les revendre à 100 francs CFA. « Dans le passé, je vendais plus de 200 pains par jour. Mais ces derniers temps, il y a une baisse notable de nos chiffres de vente. Sauf le samedi et le dimanche que j’arrive à vendre 100 pains ».
Ngardjim, est aussi vendeur du pain. Je me débrouille, dit-il. Il rajoute, la vie est difficile. Et tout le monde n’est pas appelé à travailler dans les bureaux. « Débrouiller n’est pas volé, dit-on. Je suis fier de cette activité, elle assure mon quotidien. Il faut créer, lutter par tous les moyens pour se prendre en charge», dit M. Ngardjim en guise de conseil à ceux qui sont oisifs. Selon lui, cette activité lui permet de faire beaucoup de recettes. « Je prends à la boulangerie Hybah d’Atrone, 100 pains à raison de 7000 francs CFA. Sur les 100 pains, j’ai un bénéfice de 3.000 francs CFA. Si c’est 50 pains, j’ai 1.500 franc CFA de bénéfice. C’est mieux que rien », conclut Ngardjim.
Allarassem Djimrangar
Mahamat Nour Ibedou Secrétaire Général de la Convention tchadienne de défense des droits de l’homme (CTDDH), est réhabilité dans ses fonctions, par une décision de la Cour d’Appel de N’Djamena, ce 21 mai. Qu’est-ce qui a motivé cette suspension?
Mahamat Nour Ibedou dans un échange téléphonique a relevé à la rédaction qu’il n’a pas été suspendu pour cause de malversation financière. « L’organisation n’a même pas d’argent. Il y a de cela une année, M le défunt président Idriss Deby a demandé à son ministre de la justice de m’arrêter. Pour qu’il arrive à organiser ses élections, il faut que je sois destituée de la CTDH. Le ministre ne sachant que faire a demandé au juge de me suspendre sans raison », explique-t-il. Selon le SG de la CTDDH, l’ancien Garde de Sceaux M Djimet Arabi s’est décarcassé pour monter un membre de la CTDDH, « détourneur » du fonds la CTDDH contre lui. « Ce monsieur a porté plainte contre moi à la justice, un prétexte. En principe quelqu’un qui a été chassé d’une organisation ne peut pas porter plainte. Et les juges du Tribunal de la grande Instance ont pris une ordonnance, nous avons fait opposition d’appel avec notre avocat, mais l’ordonnance a été encore confirmé et nos avocats ont interjeté l’appel de la Cour d’Appel », dit M. Ibedou. Il rajoute, comme le système judiciaire est dans la poche de feu Deby Itno, le président de la Cour d’Appel M. Timothée a préféré retarder le dossier pour ne pas se prononcer jusqu’à ce que la décision de réhabilitation soit prise ce 21 mai 2021.
« Pour ma réhabilitation, disons que le premier argument, c’est d’abord le fait que les gens qui donnent de l’ordre n’existent plus. Donc le juge avec l’arrivée de M. Ahmat Mahamat Alabo, qui a dit que les juges sont libres de dire le droit, le juge de la Cour d’appel a dit le droit sans crainte et sans un ordre quelconque », affirme le SG de la CTDDH. Selon lui, sa réhabilitation n’est pas un évènement, car il travaillait toujours comme SG de la CTDDH malgré sa suspension. « Je n’avais pas accordé de la considération à quoi que ce soit. Pour moi, ils ont réparé la bêtise de ceux qui ont fait ça », confie Ibedou.
Autre sujet, autre position. D’après lui, dans leur nouvelle organisation Wakim Tama, ils ne reconnaissent pas le Conseil militaire de transition CMT. Pour lui, le système Deby est toujours-la. « Je suis sûr qu’il va y avoir une reprise en main de la Justice. Il faut vraiment du temps pour que les choses se remettent au niveau de la justice. A mon avis, les membres de gouvernement n’ont pas assez de pouvoir avec ce CMT-là. M. Alhabbo avait dit qu’il faille libéré les manifestants arrêtés, mais jusque-là ils ne les ont pas été libérés, ce qui prouve que le CMT est tout puissant », martèle-t-il. Espère que les juges vont respirer, poursuit-il.
De la politique à la société civile
Mahamat Nour Ibedou est né en décembre 1956 à Mongo dans la province du Guera au centre du pays. Du mouvement politico-militaire à la défense des droits humains. Préoccupé par la dictature d’Hissène Habré, Ibedou intègre alors le Mouvement politico-militaire Mosanat, le Mouvement pour le salut national du Tchad qui s’est opposé au régime de Habré.
Huit mois plus tard, Mosanat signe un accord avec un groupe rebelle dirigé par le colonel Idriss Deby Itno pour former le Mouvement patriotique du salut (MPS). Ensemble ils chassent Hissène Habré du pouvoir un jour du 1er décembre 1990. Mahamat Nour Ibedou sera le tout premier chef de mission du président Deby. Mais deux ans plus tard, en 1992, Bledou n’aperçoit aucun changement. Il claque la porte du MPS.
En 2011, il décide d’abandonner la politique pour militer dans la société civile en créant avec quelques autres personnes la CTDDH, une organisation de défense des droits humains. Il milite et préside à sa destinée depuis plus de 10 ans.
Moyalbaye Nadjasna
Toukra, banlieue sud de la capitale tchadienne, N’Djamena. Sur le site des sinistrés du 9e arrondissement, les victimes d’inondations et du débordement des eaux des fleuves Chari de 2020 sont encore présents sous quelques tentes de fortunes. Et pourtant, le gouvernement avait demandé à la mi-janvier 2021, à chaque sinistré de regagner son domicile. Que disent ceux qui sont encore sur ce site et qui disent être des sinistrés? Que répondent les autorités responsables du dossier? Ialtchad Presse est allé rencontrer les deux parties. Reportage.
Ici c’est Toukra, un des quartiers du 9e arrondissement de N’Djamena, capitale tchadienne. Ce 21 mai, l’horloge indique 10 heures passées d’une trentaine de minutes. Une brume de poussière enrobe la ville alors qu’on roule vers le site des sinistrés. Non loin se trouve une station de pompage. Tout autour, c’est calme. Sur place, pas de doute qu’un nombre important de personnes sont présents. Sont-ils de vrais sinistrés? En effet, la plupart des sinistrés après un périple dû à l’inondation et au débordement des eaux des fleuves Chari en 2020 ont quitté le site pour retourner chez eux.
Mais le calvaire des infortunés n’est pas totalement tourné. Des tentes de fortunes sont toujours visibles. Des familles y vivent. Ils reconnaissent la décision des autorités leur demandant de quitter le site, mais disent-ils, « nous ne savons où aller. Et à quel Saint nous vouer. » Ce séjour prolongé met les sinistrés dans des réelles difficultés. Ils s’organisent tant bien que mal pour trouver de quoi manger pendant la journée, affirment-ils. « Nous vendons des produits variés tels que l’arachide, les gâteaux, le carburant, juste pour notre quotidien. » Désespérés et désemparés, d’autres sont pliés en deux sous leurs tentes ou allongés à la longueur de la journée sous l’ombre des arbres. « Ce n’est pas un plaisir pour nous de continuer à y rester, nous sommes dépourvus de moyens financiers. C’est vraiment difficile comme vous le constatez. Nous sommes peut-être même abandonnés », se lamente un sinistré. D’après lui, ils attendent toujours les autorités municipales de la commune du 9e arrondissement qui ont promis leur trouver où les loger. Denis Kaigo, un sinistré soutient pour sa part qu’ils ont eu la semaine dernière, la visite du maire de la commune du 9e arrondissement. « Lors de sa visite, les agents communaux ont fait le recensement de tous les ménages qui sont restés encore sur le site. Mais depuis ce jour, il n’est plus revenu », confie-t-il.
« Ce ne sont pas de vrais sinistrés… »
Selon le maire du 9e arrondissement, M. Mahamat Saleh Kerima, la plupart de ces personnes soient disant sinistrés, ne sont pas de vrais sinistrés. « Ce sont des personnes sans-abri, des locataires qui ont profité de la situation pour bénéficier avec les sinistrés de plusieurs dons, vivres et autres aides octroyés par le gouvernement et les ONG. La dernière fois, une ONG de la place leur a fait un don des matériels de construction pour les accompagner, mais ces personnes sont toujours là », dit-il. D’après lui, cette situation peut être une source d’insécurité. « Au niveau de la commune du 9èmearrondissement, en commun accord avec notre département sous tutelle, nous avons recensé 237 ménages. À l’issue de ce récemment, nous avons décidé d’accompagner ces personnes, mêmes si elles ne sont pas des sinistrés afin qu’ils quittent ce site », conclut-il.
Allarassem Djimrangar
La vente du carburant à la sauvette est très répandue à travers les grandes artères de la ville de Ndjamena, capitale tchadienne. Fait nouveau : une activité génératrice des revenus investie de plus en plus par les femmes. Reportage
Le nombre des femmes vendeuses du carburant dans la ville de N’Djamena va croissant depuis un temps. Elles ne sont pas cachées. Elles sont très visibles aux abords de grandes voies publiques. Il n’y a pas de critère d’âge. Elles sont de toutes les catégories d’âges. C’est avec détermination et courage qu’elles se livrent à cette activité risquée sous un soleil très accablant. Certaines vendeuses s’approvisionnent à Kousserie, dans la ville camerounaise voisine, d’autres s’approvisionnent aux stations en ville. Le prix de la bouteille vari proportionnellement au prix d’achat. Un litre et demi est vendu entre 750, 800 et 900 FCFA, et le litre à 600FCFA.
Khadîdja Acheik, la vingtaine révolue, a plus de 4 ans dans la vente du carburant notamment l’essence. Elle prend le risque pour s’approvisionner depuis Kousserie, dit-elle. « Là-bas, nous prenons le litre et demi à 750 et nous le revendons à 800 FCFA pour un bénéfice de 50 FCFA par litre. Je vends par jours 10 à 20 bouteilles. Je le fais tout pour assurer la ration de ma maisonnée ». Une autre vendeuse qui requiert l’anonymat, affirme qu’elle n’a jamais pris le carburant de Kousserie. Elle souhaite que le prix à la pompe soit revu à la baisse comme celui de Kousserie, « les clients cherchent toujours le moins cher ».
Bebi Dassou exerce ce métier depuis trois ans. Elle habite au quartier Abena, dans le 7e arrondissement. Selon elle, son mari est malade, elle s’adonne à cette activité ici à Farcha pour pouvoir joindre les deux bouts. « Ce qui me fait mal, c’est la mairie qui n’a pas pitié de nous. Leurs agents viennent ramasser parfois toutes nos bouteilles. C’est difficile, mais on se remet entre les mains de Dieu, car nos vies dépendent de lui seul.» Addjidé, la plus expérimentée a commencé à vendre le carburant depuis 17 ans. Pour elle, c’est difficile d’amener le carburant de Kousserie, les douaniers sont toujours à leurs trousses. Depuis lors dit-elle, elle préfère s’approvisionner sur place dans les stations. Elle gagne 50 à 100 FCFA pour assurer la survie de sa famille.
Nous redescendons à l’avenue Charles de Gaule, nous rencontrons une dame d’environ 60 ans, elle s’appelle Denise. « Cela fait presque deux ans que je vends les carburants. Si c’est cher ou pas, nous cherchons les bénéfices pour répondre à nos besoins. Je gagne 1000 ou 2000 par jour c’est l’essentiel » explique-t-elle. Pourquoi ce dernier temps les femmes semblent plus nombreuses que les hommes dans cette activité. Denise affirme que les agents de la mairie voire la douane lorsqu’ils voient les hommes avec le carburant c’est de la fraude et ils arrachent systématiquement. Les femmes au moins sont un peu favorisées, c’est pour cette raison peut-être que certains hommes se sont retirés.
À en croire ces femmes, il n’y a pas de sot métier pourvu qu’il nourrisse son homme ou sa femme. « C’est pénible avec la chaleur, mais nous n’avons d’autre choix que de nous battre pour nourrir nos familles », disent-elles.
Younous Sidick Abakar
- Arts & Culture
- Musique
- Mode-Beauté
- Divertissement
- Sports
- Mon Pays