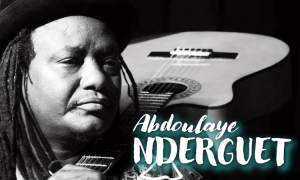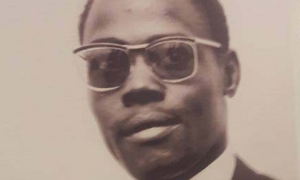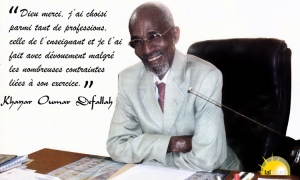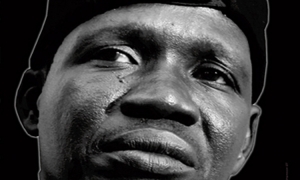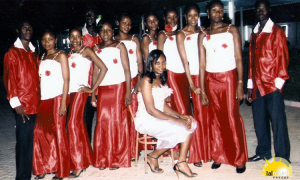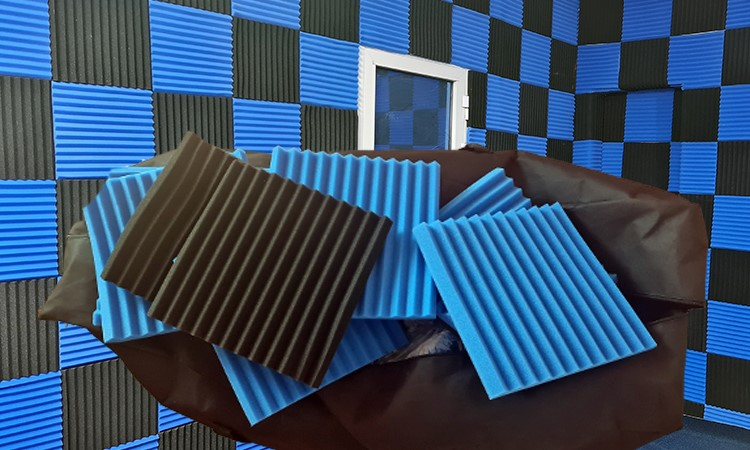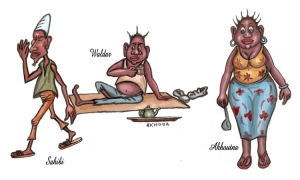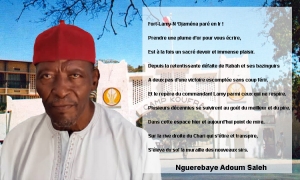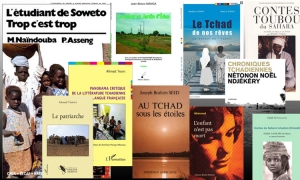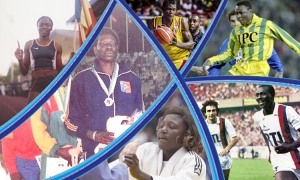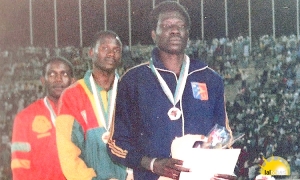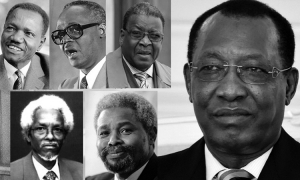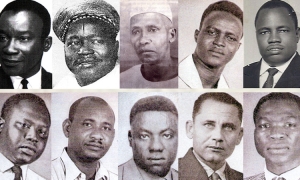A la Une
- La plateforme « Tchad d’abord » dénonce les propos d’un…
- BEAC : Nouvelle gamme de monnaie mise en…
- Kabadi : L’homme qui refusa le pouvoir
- Amdjarass, source d’inspiration présidentielle
- AES-OIF : les enjeux d'une rupture géopolitique
- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…
- Départ de l’armée française, merci président Mahamat
- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?
- Cérémonie de désengagement des troupes françaises
- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…
Certains étudiants de l’Université de N’Djamena, capitale tchadienne ont, depuis quelques années, adoptés l’auto-stop comme mode de déplacement. Ils se tiennent debout le long des principales artères de la capitale en direction de Farcha et de Toukra (9e et 1er arrondissements). Cette pratique est risquée, mais pour les étudiants l’essentiel est d’arriver à destination. Reportage.
Auto-stop est une pratique qui consiste à arrêter un automobiliste ou motocycliste et lui demander gentiment de se faire conduire à une destination ou de se faire déposer le plus loin possible. Nous sommes en face de l’axe principal qui mène à Farcha, 1er arrondissement de N’Djamena, ce 12 décembre 2021. Un bus universitaire est stationné non loin de l’entrée principale de la faculté des sciences exactes de l’Université de N’Djamena. Les étudiants se bousculent dans les rangs pour ne pas rater l’embarquement. Au bord de la même voie, d’autres étudiants font de l’auto-stop !
Benjamin Urbain en faisait partie. Il est en 3e année de la médecine vétérinaire. Il pratique l’auto-stop depuis 3 ans auprès des automobilistes ou des motocyclistes. « Tant que le problème de transport des étudiants demeure, je ferai de l’auto-stop. J’ai déjà 3 ans à la faculté donc 3 ans d’auto-stop », dit le futur médecin vétérinaire. Benjamin affirme que cette pratique a des risques, mais, dit-il, les étudiants sont obligés de le faire. « Le gouvernement nous a retiré la bourse. Il faudrait par conséquent garantir notre déplacement. Il faut que les nouveaux bus soient rapidement mis en circulation. Nous insistons sur le facteur temps, ces bus nous retardent beaucoup et nous perdons en plus », dit l’étudiant.
Un autre étudiant Tissibé Moursac donne son opinion en affirmant que les difficultés de transports des étudiants de l’université de N’Djamena sont réelles. « Nous qui sommes loin par exemple, il faut quitter la maison à 5h. Nous ratons souvent les cours des 1res heures. Je fais du vélo par moment sinon la plupart de temps, c’est l’auto-stop qui me rend service », dit l’étudiant. Pour Tissibé le risque est lié à la vie, « qui ne risque rien n’a rien »,
Un troisième étudiant intervient. Il s’appelle René. Il est en 2e année de mathématique appliquée à l’informatique. René se félicite de l’achat des nouveaux bus par le gouvernement. Seulement le jeune étudiant se plaint du fait que la mise en circulation tarde à être effective. « Comme vous le voyez, dans cet unique bus nos camarades sont entassés comme des poissons dans une boîte de sardines. Les risques encourus sont énormes », constate René.
Selon ces jeunes étudiants, la pratique de l’auto-stop est risquée, mais ils le font pour ne pas rater les 1eres heures des cours. Et les conditions d’embarquement dans un seul bus est en elle-même un risque. Les nouveaux bus mis récemment à la disposition du Centre national des œuvres universitaires (CNOU) pourraient aider à désengorger l’épineux problème de transport des étudiants.
Moyalbaye Nadjasna
Les étudiants de l’université de N’Djamena ont tenu une Assemblée Générale le 13 décembre 2021 au sein de la faculté d’Ardepdjoumal. Au cours de cette AG, ils ont décidé unanimement d’observer une grève sèche et illimitée avec effet immédiat. Raison de cette grève : la réhabilitation de leurs trois camarades exclus, le départ sans condition du président de l’université de N’Djamena et les meilleures conditions d’études. Reportage
Tout est à l’arrêt dans les facultés de l’université de N’Djamena ce 14 décembre. Les bus sont garés, les portes des amphithéâtres fermées, la cour de l’université déserte. Les étudiants des trois sites de l’université de N’Djamena à savoir Farcha, Toukra et Ardepdjoumal sont remontés contre les autorités en charge de l’enseignement supérieur. Ils réclament trois points. La réhabilitation de leurs 3 camarades exclus, le départ sans condition du président de l’université et enfin l’amélioration leurs conditions d’études. Selon le secrétaire général des étudiants de l’université de N’Djamena, Yaya Barkaï Mahamat, les 3 étudiants ont été exclus juste parce qu’ils sont influents. Il souligne qu’il est inadmissible de voir trois étudiants exclus de l’université juste parce qu’ils ont demandé qu’on leur restitue leur carte d’étudiants confisquées suite à la manifestation le ministre de l’enseignement supérieur le 20 mai dernier. Pour lui, c’est une injustice que les étudiants ne peuvent pas admettre. « Si les autorités universitaires nous présentent une preuve tangible qui les inculpe par rapport à l’incident du 20 mai, nous allons arrêter avec la lutte. Mais comme c’est un règlement de compte, nous n’allons pas céder », affirme-t-il.
Concernant le deuxième point de leur revendication, le secrétaire général déplore le comportement du président de l’université de N’Djamena Mahamat Saleh Daoussa Haggar. Il indique que ce dernier est resté insensible aux problèmes des étudiants. A l’en croire, le président refuse de répondre aux correspondances des responsables des étudiants. S
Selon le secrétaire général de l’UNET, section N’Djamena, le président de l’université de N’Djamena refuse même dialoguer avec ses étudiants pour trouver des solutions pour sortir de l’impasse. « Nous demandons son départ parce qu’il n’a réglé aucun problème des étudiants. Il ferme toutes les portes qui mènent à lui. Alors à qui nous allons nous adresser en cas de difficultés ? Les étudiants demandent son départ », martèle-t-il.
Le dernier point, les étudiants revendiquent les meilleures conditions d’études. Pour le SG, les 11 bus qui ont été réceptionnés par le centre national des œuvres universitaires le 08 décembre dernier ne sont pas encore mis en circulation. Il déplore le comportement de certaines autorités rectorales qui tardent à mettre en circulation les bus. Il estime que ce comportement ressemble à une vengeance liée aux manifestations du 20 qui ont failli emporté le ministre de tutelle au campus universitaire de Toukra. Le secrétaire général de l’UNET, section N’Djamena met en garde les étudiants traitres qui fournissent des fausses informations aux autorités en charge de la sécurité, rectorales ou décanales.
Kouladoum Mireille Modestine
La forêt de Farcha Milézi est un site provisoire accueille des milliers de réfugiés camerounais composés essentiellement des femmes et des enfants. Traumatisées, plusieurs d’entre elles racontent les violentes scènes de conflits intercommunautaires qui ont eu lieu le 5 décembre dernier dans la ville camerounaise Kousserie voisine de la capitale tchadienne, N’Djamena. Reportage.
Plusieurs réfugiés camerounais qui ont fui les violents conflits intercommunautaires. Ils sont accueillis dans la forêt de Farcha Milézi, dans le 1er arrondissement de la ville de N’Djamena. Ces milliers de réfugiés y sont installés provisoirement dans cette petite forêt. Ici est là les familles sont sous l’ombre des arbres. La plupart des réfugiés sont des femmes et des enfants non-accompagnés. Ils sont traumatisés par les violents affrontements entre les éleveurs arabes Choa et les cultivateurs et pêcheurs Mousgoum. Ces femmes racontent chacune à sa manière les scènes de violences qu’elles ont été témoins. Malgré les premières assistances données par les autorités tchadiennes et leurs partenaires, beaucoup de ces femmes et surtout ces enfants peinent toujours à s’exprimer sur ces violences.
Hadjé Tom Hisseini, une femme de 60 ans est assise sous un arbre. Elle raconte dans une voix tremblante les violents affrontements qu’elle a vus. Selon elle, dans son village, les agriculteurs Mousgoum les ont attaqués vers 7h du matin. Elle affirme que beaucoup de femmes et des enfants ont été brulés vif. « Nous n’avons pas eu le temps de nous organiser, ils étaient venus nombreux avec les sagaies et de machettes en criant. Et puis ils ont mis de feu dans nos cases », dit-elle avec émotion. Hadjié Tom Hisseini souligne qu’elle a la chance d’échapper à la mort. Elle a perdu plusieurs membres de sa famille. Accompagnée de ses deux filles, elle dit n’avoir pas eu de nouvelles de ses 3 garçons et certains de ses petits-enfants. Mme Tom affirme aussi qu’elle et ses filles sont arrivées sur ce site, il y a 3 jours. Elles peinent à dormir dehors, sans moustiquaire, mangent difficilement. Entourées d’autres femmes, ces réfugiées menacent de retourner dans leurs villages, si les autorités tchadiennes et leurs partenaires ne s’occupent pas correctement d’elles.
Même récit d’une autre jeune femme d’une trentaine d’années qui donne de l’eau à son nourrisson. Elle s’appelle Fanné Abakar. Elle habite dans un hameau d’environ 7 km de Kousseri, elle dit avoir quitté son village les cases en fumée. Dans sa fuite, elle a vu les corps sans vie jonchés tout au long de son chemin. Elle raconte les scènes de violences inouïes. Elle s’est subitement tue, s’est retournée pour cacher ses émotions avant de reprendre son souffle. Elle passe son pagne sur la tête à son visage et lâche la gorge serrée, « depuis ma naissance, je n’ai jamais vu des violences pareilles ». Elle affirme n’avoir pas retrouvé son mari et de ses deux enfants. Selon elle, ce sont les pécheurs Mousgoum qui les ont attaqués et ont brûlé les cases, les mosquées et les boutiques. Fanné Abakar a toutefois reconnu le soutien des autorités tchadiennes qui n’ont ménagé aucun effort pour leur porter assistance. Elle reconnaît avoir reçu des mains des volontaires de la croix rouge tchadienne des couvertures, de moustiquaires et des vivres.
Germaine Nadjibé, épouse d’un pêcheur a aussi fui le conflit avec ses voisines et leurs enfants lorsqu’elles ont vu les agriculteurs brûler un village voisin. De peur d’être réprimées, plusieurs familles d’autres communautés ont décidé de quitter leurs villages pour se mettre à l’abri de la colère des deux communautés qui s’affrontent. Germaine Nadjibé dit que depuis leur arrivée sur le site, ils ne sont pas pris en charge. Selon elle, les autorités qui distribuent des vivres les ont discriminés. Elle estime que celles-ci accordent plus de compassions aux réfugiées arabes que d’autres communautés.
Certains volontaires de la croix rouge tchadienne rencontrés dans le site de Farcha Milézi affirment qu’ils ont recensé plus 865 ménages. Et ont donné à chaque ménage de tickets leur permettant de se nourrir en attendant de leur trouver un local fixe.
Pour le président de la sous-commission d’accueil des réfugiés de la Mairie de N’Djamena, Mahamat Hassan, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a fait un don de 800 couvertures, 800 seaux, 800 sacs de riz de 50kg, 80 cartons de dattes et 80 cartons de savons. Il affirme aussi que le ministère de la Santé publique a donné 50 bœufs. 3 têtes par jour pour distribuer aux réfugiés accueillis sur les sites du 1er arrondissement. Il précise que toutes les 865 familles recensées ont reçu des vivres. Le président de la sous-commission d’accueil reconnaît toutefois des difficultés dans la distribution de ces vivres. Il évoque que l’afflux des nouveaux réfugiés rend difficile le travail.
Les autorités tchadiennes annoncent qu’elles vont relocaliser ces milliers de réfugiés camerounais accueillis dans les 6 sites provisoires, à la sortie nord de la ville de N’Djamena.
Jules Doukoundjé
Le Think Thank Tchad Notre Patrimoine a organisé une conférence-débat ce samedi 11 décembre au Centre d’étude et de formation pour le développement (CEFOD). Le thème de la conférence a porté sur « l’État unitaire décentralisé au Tchad est-il un échec et le fédéralisme est-ce la solution » ? Le panel était constitué de : Professeur Ahmat Mahamat Hassane juriste, ancien ministre de la Justice, Emmanuel Nadingar homme politique, ancien premier ministre, Kebir Mahamat Abdoulaye économiste et spécialiste des politiques publiques et Énoch Djondang expert, juriste en développement. Reportage.
Ce débat public est un souhait des internautes tchadiens selon le modérateur. Il précise qu’ils aspirent à un État fédéral au Tchad. Un grand public majoritairement jeune envahit la salle multimédia du CEFOD. L’histoire politique du Tchad est le premier point exposé par le Pr. Ahmat Mahamat Hassane. Le pays selon lui est fondé sur les chefferies traditionnelles avant l’arrivée des colons. Il rappelle que le préambule de la Constitution de 1996 affirme que le Tchad est un État unitaire centralisé. Les autorités locales reçoivent des ordres du pouvoir central, dit-il. « L’État unitaire fortement décentralisé qu’on entend tous les jours est un terme qui n’existe nulle part dans le droit administratif. Le Tchad n’a jamais été un État décentralisé », dit-il. Pr. Ahmat affirme qu’il faut parler des problèmes réels des Tchadiens. L’ancien Garde des Sceaux estime que la forme de l’État importe plus le peuple actuellement conséquence de la dévotion du pouvoir par la violence. Et son résultat : l’éducation à terre, l’injustice sociale, la mauvaise gouvernance et l’impunité généralisée sont les vrais soucis de l’heure, dit-il. « Tous ces problèmes précités frustrent certains Tchadiens qui pensent que la fédération serait une solution ».
Emmanuel Nadingar prend la parole. Il affirme que le concept de fédération ne date pas d’aujourd’hui. C’est une émanation de la Conférence Nationale Souveraine(CNS) de 1996, a dit l’ancien chef du gouvernement. À son avis, la CNS a accouché des grandes solutions aux problèmes des Tchadiens, mais elles n’ont jamais été mises en pratique, regrette-t-il. « Dernièrement, les débats politiques sont accentués sur la limitation des mandats présidentiels. Certains partis politiques se sont retirés de la présidentielle de 2016 ». Pour l’ex Premier ministre, l’organisation des élections non transparentes est un problème. Il demande à l’État d’offrir la possibilité aux Tchadiens la mise en place des structures crédibles et transparentes. M. Nadingar cite en exemple, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). La décentralisation n’est pas encore expérimentée au Tchad sous-tend-il, le Pr. Ahmat. Pour lui, il faut plutôt regarder les questions de base qui sont des réalités qui divisent les Tchadiens. La dia en est une illustration note M. Nadingar et non la forme de l’État.
Au tour de M. Enoch Djondang expert, juriste en développement, d’intervenir. « L’histoire d’un pays ça s’écrit, ça ne se décrète pas », dit-il. Le juriste affirme que dans les années 1960 à l’indépendance du Tchad, les cadres se comptaient sur les bouts des doigts. « On a mal commencé ! Les colons ont fait signer au premier président, Ngarta Tombalbaye un document qui leur permet d’exploiter les ressources minières. Le document indique que les 20 km de routes bitumées et l’aéroport sont des propriétés de la France. C’est lamentable », dit-il. Il affirme que les fondements de l’État sont la citoyenneté, la représentation du citoyen, le respect des lois, l’économie et la diplomatie. M. Enoch indique que ces fondements malheureusement, piliers d’un État de droit ont été faussés dès le départ. Les Tchadiens en souffrent les conséquences en ce moment. Il souhaite que les Tchadiens ne s’attardent pas sur la forme de l’État. L’indispensable selon lui, c’est de créer « un Tchad juste ou chacun se sent à l’aise dans son environnement. »
L’Économiste M. Kebir Mahamat Abdoulaye est le dernier intervenant. Il affirme que le Produit Intérieur Brut PIB du Tchad en 1960 était à 1 milliard. En 2018, le PIB est passé à 12 milliards de FCFA. Pour lui, le PIB n’a pas évolué. Il estime que la croissance démographique est plus élevée que la croissance économique. M. Kebir prend l’exemple de quelques pays qui sont dans le fédéralisme pour appuyer son argumentation. Pour lui, ce n’est pas la forme de l’État qui fait la puissance d’un pays, mais plutôt la bonne gouvernance et la gestion du pouvoir. L’économiste dit être contre l’instauration du fédéralisme au Tchad. Selon lui, cette forme de l’État risque d’inciter le tribalisme, l’ethnicité, la désignation des capitales des États fédérés et le coût économique. Il reconnaît qu’il existe un problème d’injustice, mais que la fédération ne sera pas la solution.
Le public a plus alimenté le débat par sa contribution que de poser des questions. Pour les participants, le fédéralisme est compris au Tchad profond comme une solution au mal vivre ensemble. Le public reconnaît qu’il faut des préalables pour instaurer la fédération au Tchad.
Kouladoum Mireille Modestine
Les pavillons du Musée du village Gaoui, a environ 20 kilomètres de N’Djamena, capitale tchadienne sont fascinants. Une visite guidée nous a permis de découvrir l’histoire du peuple Sao, mais aussi du peuple Kotoko. Reportage.
Dans le premier pavillon en salle 1 on y trouve, de vases à eau de différents volumes avec une décoration identique. Un bas décoré par incision et le haut, lisse avec des bordures épaisses. Il y a aussi de statuts humains découverts par l’archéologue française Mme Claustre, fait prisonnier par le défunt président Hissène Habré.
Le 2e pavillon, salle 2, il y a des harpons à bout pointu avec une manche. Un outil de pêchedu peuple kotoko. Il y aussi le Malane ou pièges pour capturer les poissons. Ces matériels permettent d’organiser la pêche collective. La prochaine porte c’est la salle 3. Ce pavillon est réservé à la promotion des œuvres des célèbres potières de Gaoui. Des articles disponibles chez les fabricantes et les visiteurs peuvent faire des commandes si jamais ils veulent en acquérir un ou plusieurs produits. Dans la même salle, on peut voir les « ganounes » ou foyer en poterie, des mouloumi ou grenier en miniature.
Plus loin, c’est la salle de la légende Sao où est décrit ce peuple mythique, ancêtre du Tchadien d’aujourd’hui. L’auteur Marcel Griaule a décrit en 1944 les Sao comme des hommes de grandes tailles qui vivent des pêches, de chasse et de cueillettes. Leur génie créatif tourne autour de la poterie. Leurs gobelets sont immenses. Ils ont un rite funéraire original dans des jarres pouvant contenir deux hommes. Ils pratiquent selon lui, la pêche sans filet en barrant de leurs mains les rivières. Ils chassaient des hippopotames. Le timbre de leur voix porte à de kilomètres des lieux. Et qui sème la panique chez les animaux de la savane.
Un autre pavillon, la case du nouveau marié. À l’intérieur on trouve un lit en terre battue avec un oreiller à côté d’une pierre de massage. Sur le lit est étalée une peau d’un bélier servant de couverture au nouveau-né. Dans la même case, il y a un grenier moyen pour la femme pour faire le tika, ou poisson en poudre. Histoire des Hommes, histoire des conflits conjugaux, il y a dans le pavillon même un lieu dédié aux mésententes des jeunes couples.
Il y a ensuite, la salle des dignitaires composée d’une chambre du sultan ou le Mey comme est désigné le sultan en langue Kotoko. Il y a aussi des salles des retrouvailles des notables, d’attentes et les accoutrements des sultans et des reines qui datent de plus de 100 ans. Sont exposés également la photo du cheval de sultan Afade, don du président mauritanien Ould Dada, etc. Il y a des salles où on peut voir des armes blanches et des pierres mystiques d’affronts pour la légitime défense en cas d’agressions extérieures. Une dernière salle contient des masques et des photos des lieux sacrés pour les rites d’intronisation des sultans. Au dernier niveau du bâtiment, c’est la demeure du sultan et de son épouse, la reine mère appelée « la goumsou ». Les autres épouses du Mey sont installées au rez-de-chaussée du bâtiment.
Moyalbaye Nadjasna
C’est le troisième article sur notre série sur l’Éducation. Les établissements scolaires privés poussent comme des champignons dans la capitale tchadienne. C’est devenu presque une anarchie, mais les partisans de ces écoles soutiennent que leur présence se justifie par le fait qu’ils aident l’État dans sa tâche d’assurer l’éducation pour tous. Est-ce vraiment le cas ? Répondent-ils aux normes ? Plusieurs de ces établissements scolaires privés ne possèdent ni bibliothèque, ni de toilettes acceptables, ni de l’espace pour les activités sportives (éducation physique). Reportage
Les établissements scolaires privés dépassent le nombre des établissements publics. À N’Djamena, capitale tchadienne, ils sont partout, presque à chaque coin de rue. Ces établissements privés sont créés dans le but d’appuyer l’État à répondre au besoin de l’éducation. Seulement, certaines de ces structures éducatives ne répondent pas aux normes fixées par l’État. Ces écoles privées ne possèdent pas de bibliothèques ni de toilettes et moins encore de l’espace pour l’épanouissement des élèves.
Sur les quatre lycées privés visités, aucun d’entre eux ne possède une bibliothèque. Certains élèves utilisent leurs téléphones portables pour faire des recherches. « Nous demandons parfois à nos aînés de l’aide pour traiter nos exercices. Par exemple les exposés sur les œuvres littéraires ou les exercices scientifiques. Sinon notre lycée n’a pas une bibliothèque. », disent unanimes les élèves. Ces manquements ont amené le ministère de l’Éducation nationale à procéder à la fermeture des 167 établissements scolaires privés en septembre 2019.
Contrairement aux établissements privés, les lycées de confession religieuse disposent des bibliothèques bien garnies. Au lycée Sacré-Cœur, situé à Chagoua, dans le 7e arrondissement, il existe une bibliothèque pour les enseignants et les élèves de la 6e jusqu’en classe de terminale. Cette bibliothèque existe depuis 1964. Elle a plus de 5000 livres et manuels scolaires. Pour le bibliothécaire Palou Étienne, ce sont les enseignants qui proposent les livres qui sont dans le programme d’enseignement et l’établissement les mettre à leur disposition. Il explique que la bibliothèque est divisée en deux parties. Une partie pour les élèves de 6e et 5e, et l’autre partie va des 4es en terminale. « À cause de l’étroitesse de la salle de lecture, les élèves emportent les livres et les ramènent deux semaines plus tard », dit le bibliothécaire.
C’est aussi le cas au lycée et collège évangélique qui dispose d’une bibliothèque avec de la documentation riche et variée. Sur les rayons il y a des documents de culture générale, science sociale, théologie, encyclopédie, des œuvres littéraires et scientifiques, mais aussi des journaux. L’établissement possède aussi une grande salle de lecture.
Pour Madame Mallouma Taopili Chantal, gérante de la bibliothèque, tout élève du lycée évangélique entre à la bibliothèque sous présentation de sa carte scolaire et consulte gratuitement les ouvrages. Selon elle, la bibliothèque est fournie par les anciens élèves, l’administration et le comité de gestion. La gérante ajoute qu’en plus de la bibliothèque classique, il y a aussi une bibliothèque numérique. « Les élèves et les enseignants font la liste des livres dont ils ont besoin et l’administration s’en occupe. Le Centre National de Curricula nous envoie aussi des ouvrages à la demande de l’administration », ajoute-t-elle.
Le vice-président de l’association des fondateurs des établissements privés laïcs secondaires et professionnels du Tchad, Djékorodé Thomas, précise que c’est un décret de 2015, qui donne les conditions de création des établissements scolaires privés. Selon lui, c’est l’État qui a délégué une partie de son pouvoir aux personnes de bonne volonté pour l’appuyer. À son avis, il revient à l’État de mettre de l’ordre. « Plusieurs fondateurs ont créé ces établissements avec leurs propres moyens. Certains établissements font un bon travail, mais d’autres sont très limités », dit-il.
Une convention a été signée entre l’État et l’association depuis le 22 janvier 2021. Cette convention permet à l’État d’avoir le droit de regard sur les manuels utilisés par ces établissements privés, mais aussi de leur venir en aide en matériel didactique.
Kouladoum Mireille Modestine
Bienvenue sur la page de la Radio Ialtchad FM 99.5
Site web Radio Ialtchad en développement
Appel à candidature : journalistes Radio
En vue du lancement prochain de sa Radio IALTCHAD FM, le Groupe IALTCHAD MÉDIAS invite les journalistes à postuler pour faire partie d’une nouvelle expérience Radiodiffusion. Les candidats intéressés doivent fournir les documents suivants avant le 1er janvier 2022 :
- Une lettre de motivation ;
- Un CV ;
- Une copie de la CIN ;
- Une copie du dernier diplôme.
Sous la supervision du Directeur Média, les candidats retenus après le test bénéficieront d’une formation.
Courriel : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Responsable : 66 28 04 42
La coordination des actions citoyennes Wakit Tama a réussi l’acte 4 de ses marches pacifiques. L’itinéraire habituel a changé. Les marcheurs sont partis du point de rassemblement à l’espace Fest’Africa pour finir au Stade Idriss Mahamat Ouya (IMO), dans le 3e arrondissement. Wakit Tama à fait passer à travers cette marche 10 messages aux autorités de la transition. Reportage.
Plus de 4000 marcheurs ont pointé présents selon Wakit Tama ce samedi matin 11 décembre. Avant leur départ, ils ont campé à l’espace Fest’Africa au quartier Moursal, dans le 6e arrondissement de N’Djamena. Ils chantaient à tue-tête, brandissaient les pancartes avec différentes mentions.
8h 30 min. La foule des marcheurs se met en ordre de marche, après l’hymne national. L’itinéraire recommandé par l’administration sécuritaire est respecté. Les manifestants s’arrêtent quatre fois. D’abord, tous genoux à terre en face du building de Moursal. Même acte devant le rond-point du centenaire et devant l’ancien local de la Radio nationale tchadienne (RNT). Le dernier arrêt était devant l’Institut français au Tchad (IFT). Après une heure et demie de marche, les marcheurs sont arrivés au stade IMO bruyant sous un regard bienveillant des forces de sécurités, fortement mobilisées.
10 messages sont clamés par Wakit Tama : « non à la guerre, non à la manipulation nord-sud, non à la dictature, non à la succession monarchique, non à la France, non à la charte du Conseil Militaire de la Transition (CMT) dans son format actuel, non à l’exclusion de quelques sensibilités politiques, non au Conseil National de Transition (CNT) avant le dialogue national inclusif (DNI), non au traitement exagéré des membres du CMT, oui au dialogue national inclusif ».
Wakit Tama affirme que la contestation par cette 4e marche est justifiée. Et fustige la discrimination, l’inégalité, l’injustice, la pauvreté imposée aux Tchadiens avec l’aide politique et militaire de la France. Pour illustrer leur propos, les leaders citent le poète Tunisien Alchaabi Abulqasim qui dit, « si un peuple décide un jour de se prendre en main, il n’a pas d’autres choix que de forcer le destin. » La coordination des actions citoyennes insiste sur l’illégalité du CMT. Elle soutient que sa mise en place n’a pas respecté les recommandations constitutionnelles et les textes internationaux ratifiés par le Tchad. Les leaders de la plateforme disent qu’ils marchent parce que la constitution les autorise.
Les marcheurs se sont dispersés dans la discipline, sans aucun incident.
Moyalbaye Nadjasna
- Arts & Culture
- Musique
- Mode-Beauté
- Divertissement
- Sports
- Mon Pays