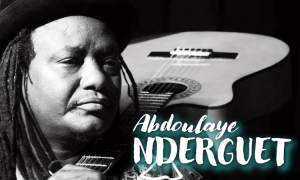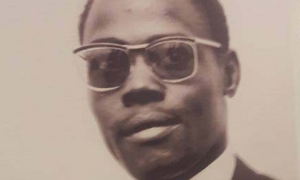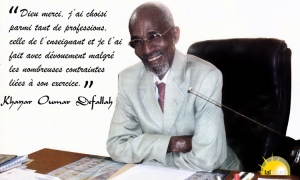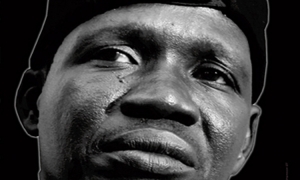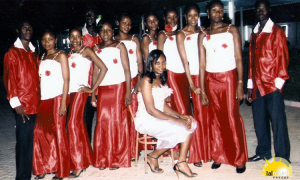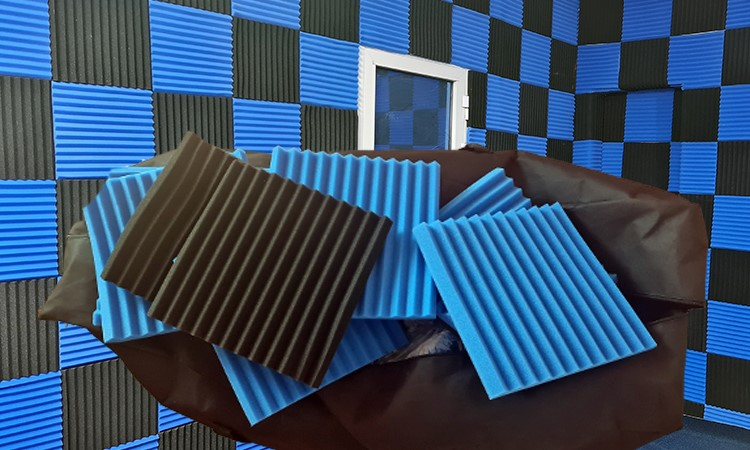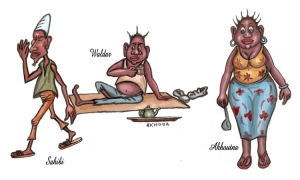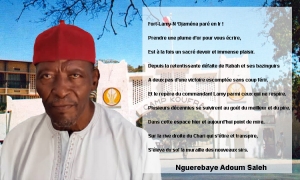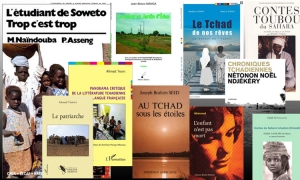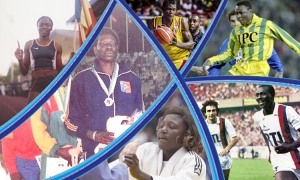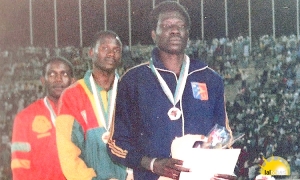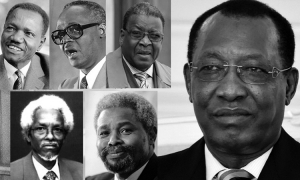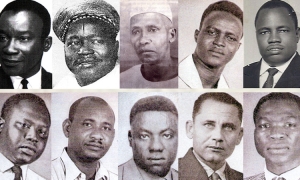A la Une
- Amdjarass, source d’inspiration présidentielle
- AES-OIF : les enjeux d'une rupture géopolitique
- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…
- Départ de l’armée française, merci président Mahamat
- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?
- Cérémonie de désengagement des troupes françaises
- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…
- Succès Masra, au bout de l’inconstance
- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…
- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?
37 sur 65 enseignants chercheurs de l’université de N’Djamena ont été gradés par le conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES). Selon les résultats de la 43e session des comités consultatifs interafricains (CCI), les 37 sont issus de toutes les spécialités. Ce résultat va galvaniser davantage la recherche scientifique et aider les universités tchadiennes à mieux s’organiser. Reportage.
L’université de N’Djamena vient d’avoir de nouveaux gradés dans son corps professoral. 37 enseignants chercheurs de différentes disciplines : maîtres assistants, et maîtres de conférences, lors de la 43e session des comités consultatifs interafricains (CCI). Pour le Professeur Madjindaye Yambaïdjé, maître de conférences, secrétaire général de l’université de N’Djamena, spécialiste de la littérature africaine francophone, 65 candidats sont présentés et parmi les 65 candidats, il y a une candidature pour le grade de professeur titulaire, quelques candidatures pour la maîtrise de conférences, et de candidats pour la maîtrise d’assistanat, c’est-à-dire le grade de maître-assistant.
Au résultat, il y a eu échec du seul candidat tchadien pour le grade de professeur titulaire. Pour le chercheur, les résultats sont bons. En ce qui concerne le maître de conférences, le Tchad a totalisé 13 maîtres de conférences. « Par rapport aux années passées, c’est encourageant. Il y’a également les maîtres assistants, et là encore, l’université de N’Djamena, compte 24, c’est intéressant », se réjouit-il du résultat encourageant. Il estime que les comités techniques spécialisés (CTS), CTS lettres sciences humaines ont de la nouveauté. C’est encourageant. Il déclare qu’il y a un tout premier maître de conférences en philosophie au Tchad, un tout premier maître de conférences en lettres, et c’est lui-même, et enfin un tout premier maître de conférences en histoire. « Comme ce sont les tout premiers maîtres de conférences dans leurs domaines, cela peut donner un espoir. Cela peut conduire à l’ouverture des unités de formations doctorales dans ces domaines et permettrait d’éviter que les étudiants que nous formons, auxquels nous délivrons des masters, puissent aller se chercher à l’extérieur. », dit le professeur.
Il faudra un engagement politique
Parlant de l’impact d’avoir les enseignants chercheurs, il ajoute qu’il faut regarder chaque année le nombre des étudiants tchadiens qui partent à l’extérieur à la cherche du savoir. À son avis, c’est parce qu’il y a un problème de ressources humaines au pays. « Le problème n’est pas seulement financier », dit-il. Pour lui, à l’enseignement supérieur, il y a le capital humain, le capital financier et le capital matériel. Pour l’homme de lettres, les finances, il y en a, même si c’est insuffisant. Il reconnaît aussi que le matériel, l’enseignement supérieur en possède, mais que c’est insuffisant. Le professeur affirme que tant que l’on n’a pas le capital humain en place, on ne pourra rien faire à l’enseignement supérieur. « Beaucoup de nos institutions fonctionnent justement sans des enseignants chercheurs qualifiés. Cela fait déjà 3 ans que des résultats sont encourageants, parce que chaque année, il y a des gens qui passent maîtres-conférences, des professeurs titulaires », note le SG de l’université de N’Djamena.
Pour édifier ses propos, il a pris l’exemple de la faculté de médecine de l’université de N’Djamena. Pour lui, il y a quelques années, la faculté a toujours eu recours aux pays étrangers pour pouvoir organiser des soutenances des doctorants en médecine. Aujourd’hui on peut compter 9 enseignants de rend A, c’est-à-dire, les maîtres de conférences et les professeurs titulaires. Il y a aussi 3 professeurs titulaires à la Faculté de Médecine. Le professeur Madjindaye Yambaïdjé estime qu’avec ces résultats, au bout de 4 ou 5 ans, les autres facultés pourraient être autonomes et former des docteurs sur place. « À ce rythme, il faut être optimiste pour le pays ».
La recherche scientifique a de l’avenir
À la question du retard du Tchad en matière de ressources humaines, surtout dans l’enseignement supérieur, l’enseignant chercheur précise que le pays a connu des moments de guerres. Cette période des guerres a perturbé l’appareil académique. Il a évoqué aussi les grèves des enseignants chercheurs et des étudiants qui empêchaient l’enseignement supérieur de s’épanouir. Toutefois, il ajoute qu’il y’a un changement. « Il y’a quelques années, beaucoup d’enseignants chercheurs pensaient que quand on a le doctorat, on est arrivé, mais aujourd’hui, les titulaires de doctorats pensent qu’en ce moment qu’ils commencent et ce réveil est un stimulus qui commence à remodeler la mémoire de chercheurs », souligne le littéraire. Il assure que la relève est en voie d’être assurée et qu’avec ce réveil, l’on peut oser croire que le Tchad a de l’avenir. Concernant les critiques à l’endroit des chercheurs tchadiens qui ne produiraient pas, le chercheur affirme que les preuves sont là. Selon lui, les résultats du CAMES sont là pour justifier le travail des enseignants chercheurs du Tchad. Pour l’enseignant chercheur, on ne peut être évalué par le CAMES sans avoir produit des résultats de recherches, et que ce sont ces résultats qui sont évalués. Le SG de l’université de N’Djamena précise que le CAMES regroupe 19 pays et qu’une telle évaluation est crédible, objective et incontestable. Pour lui beaucoup de gens ne comprennent pas le système de recherche scientifique, mais osent critiquer ce qu’ils ne comprennent pas. « Ce n’est pas une bonne évaluation, les enseignants chercheurs produisent. Parce qu’ils produisent qu’ils obtiennent de grades » dit-il.
Au sujet de grèves dans les universités tchadiennes le chercheur soutient qu’il faut une politique de l’enseignement supérieur. Selon lui, la politique de l’enseignement supérieur ne peut venir que des gouvernants et des décideurs. « Il faut accorder une priorité à l’enseignement supérieur ». À son avis les universités tchadiennes ont de problèmes. Il ne faut pas les contourner. Il note qu’il y a des universités qui fonctionnent péniblement « il va falloir régler ces problèmes. » Il a révélé que le pays a 10 universités publiques et plusieurs universités privées, et qu’il faut développer une politique pour maintenir ces étudiants dans nos universités.
Jules Doukoundjé
La ministre tchadienne du Développement Agricole a suspendu les ventes subventionnées des vivres par les sections provinciales de la zone soudanienne de l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA). Causes : des irrégularités constatées dans certaines localités. Reportage.
Les ventes subventionnées des vivres par l’ONASA dans la zone méridionale ont été suspendues par la mission du 24 août au 2 septembre dernier de Mme Kamougué Deneassoum ministre du Développement Agricole. Les raisons de la suspension sont liées à des irrégularités constatées dans certaines localités selon le rapport de terrain. Il s’agit uniquement des stocks de l’ONASA dont les données sont disponibles. Selon le document, les stocks paysans et commerçants sont faibles, voire nuls. Le rapport précise que les entrepôts de la province du Logone Occidental sont vides. L’ONASA a autorisé la vente sans l’avis de la ministre de tutelle. Ces ventes vont être relancées après l’état des lieux de la situation, a déclaré Mme Kamougué.
7 entrepôts provinciaux ont été visités par Mme la ministre et sa délégation indique le rapport. Il s’agit des entrepôts du Logone Occidental, du Logone Oriental 209 tonnes de stocks 98,3 tonnes vendues et 110,7 tonnes restantes. Au Mandoul, 649,7 tonnes stockées, 28,8 tonnes vendues et 620,9 tonnes restantes. Au Mayo-kebbi Est, 422,1 tonnes stockées, 0000 vendues, 422,1 tonnes restantes. Au Mayo kebbi Ouest, 470,9 tonnes dans l’entrepôt, 0000 vendues, 470,9 restantes. Dans le Moyen-Chari, 749,3 tonnes emmagasinées, 77,3 tonnes vendues, 672 tonnes restantes et, dans la Tandjilé, 77,35 tonnes stockées, 0000 tonnes vendues, 77,35 tonnes stockées. Le stock total de ces provinces est de 2578,35 tonnes, 204,4 tonnes vendues et 2373,95 tonnes restantes. Une situation provisoire qui permet déjà au ministère de tutelle de prévenir une éventuelle crise alimentaire dit le ministère.
Selon M. Mahamat Djimet Dreni-Mi, Directeur des études, de la planification et du suivi (DEPS), « quand on dit crise alimentaire, c’est l’incapacité de certaines personnes d’acheter sur les marchés ». C’est un classement consensuel lorsqu’on croise les données. À la question de savoir à quel niveau se situe l’effort du gouvernement du Tchad à propos de la politique de l’autosuffisance alimentaire, M. Mahamat Djimé répond que c’est un effort sur plusieurs aspects. Il soutient qu’ils sont sur plusieurs projets. Actuellement dit-il, avec le changement climatique, le Tchad subit comme les autres pays africains les effets néfastes des grands pollueurs, les grandes puissances. D’après lui, le taux de pollution de l’Afrique est seulement à 1%. Il faut prendre des dispositions pour s’adapter et atténuer les conséquences des gaz à effets de serre, explique le technicien.
« Face à ce défi, il faut renforcer la résilience, développer des stratégies pour faire face aux chocs du changement climatique. Il faut aussi mobiliser les eaux souterraines, ce qui n’est pas moins significatif au Tchad qui dispose 100 milliards de millimètres cubes », soutient M. Mahamat Djimé Dreni-Mi. Pour lui, la mobilisation d’eaux souterraines va favoriser le développement des cultures de contre-saisons pouvant résoudre d’éventuelle crise alimentaire. Plus de 17 projets sont en étude dans le cadre du développement agricole au Tchad, dit le Directeur.
Moyalbaye Nadjasna
Une semaine après la reprise des cours le 15 septembre dernier, le syndicat des Enseignants et Chercheurs du Supérieur SYNECS lance pour la 2e fois une grève d’avertissement. Cette cessation d’activités prend effet dès ce mercredi 22 septembre, sur toute l’étendue du territoire national. À la faculté d’Ardep-djoumal de N’Djamena, capitale du Tchad, visitée par la rédaction, les amphithéâtres sont vides. Reportage.
Tout est aux arrêts ce matin à la Faculté d’Ardep-djoumal, dans le 3e arrondissement de la ville de N’Djamena. Les bus de transport des étudiants garés, les portes des amphithéâtres et les bureaux des enseignants sont restés hermétiquement fermés. La cour ressemble à un village fantôme. Qu’est-ce qui se passe ? Les Enseignants chercheurs du supérieur sont en grève. Cette séquence de grèves dite « perlée » désespère les étudiants.
Bembaye Jacob est en 2e année des Sciences de l’Éducation, il se dit désolé des grèves répétitives des enseignants. « L’enseignement supérieur au Tchad est très déplorable. Une semaine seulement après la reprise des cours de l’année qui est inachevée, les enseignants observent une grève. Ça fait très mal », dit-il. Certains étudiants affirment qu’ils sont fatigués de subir les conséquences d’incompréhensions répétitives entre le gouvernement et les enseignants du supérieur. Selon eux, l’espoir d’avoir un avenir meilleur a disparu.
D’autres étudiants estiment pour leur part que le gouvernement et le SYNECS doivent s’asseoir pour trouver une solution définitive à ces grèves. Mbaïramadji Didier étudiant en Sciences humaines et sociales est confus. « Je m’interroge si le problème vient du gouvernement ou des enseignants. À quel niveau se situe exactement l’incompréhension ? À mon avis, le gouvernement doit respecter ses promesses », dit-il. Bembaye Jacob trouve logique que les enseignants réclament ce qui leur revient de droit. « J’encourage les enseignants à tenir bon malgré les conditions de vie et de travail très défavorable. Toutefois qu’ils pensent aussi à nous, car nous constituons la relève de demain. Il faut bien nous former. Quelquefois on fait seulement 2 à 3 mois de cours pour une année académique. Cela devient ridicule pour l’avenir de l’enseignement supérieur au Tchad », regrette-t-il.
En attendant le 29 septembre prochain, jour de fin de grève, les étudiants attendront à la maison.
Kouladoum Mireille Modestine
Le suivi de la campagne agricole de tradition se fait chaque année par le ministère du Développement Agricole. Cette fréquence permet aux techniciens de faire la situation sur les difficultés des producteurs sur le terrain et prévenir les crises alimentaires. Dans la zone soudanienne parcourue par une mission du ministère, il ressort de cela que la campagne pourrait être moyennement bonne. Reportage.
Du 24 août au 2 septembre 2021, les techniciens du ministère du Développement Agricole avec leur ministre de tutelle ont entamé une mission sur le terrain dans la zone soudanienne afin de faire le suivi de la campagne agricole lancée le 5 juin 2021 à Mara. Selon Mahamat Djimé Dreni-Mi, Directeur des études, de la planification et du suivi (DEPS), « la campagne agricole en cours se déroule normalement. Elle a certes connu un léger retard de pluies qui a perturbé le calendrier cultural. Mais les ressemés pour rattraper la campagne se sont traduits par des cultures contrastées et variées selon les endroits. »
M. Mahamat Djimé soutient que les phénomènes climatiques a un impact sur le secteur agricole tchadien. Le technicien affirme que ces changements climatiques jouent au yoyo. Tantôt, c’est la sècheresses dues au manque de pluviométrie, tantôt ce sont des inondations. Il affirme aussi que les menaces acridiennes affectent les récoltes.
Le rapport produit par la mission des techniciens ce mois en cours, annonce qu’avec la montée des cours d’eau permanents et temporaires, il est possible que certaines provinces soient inondées. Dans le document on peut lire que la situation phytosanitaire est relativement calme malgré quelques attaques des chenilles légionnaires d’automne et sautereaux sur le maïs, le sorgho, les pénicillines et le sésame précoce. Pour la situation globale, elle reste à préciser, indique le rapport. Mais la situation provisoire donne, 211 257 hectares de coton, 1 468 505 hectares des vivriers soit un total de 1 691 356 hectares.
Aussi, le document révèle que la situation est relativement calme malgré la hausse généralisée des prix sur les marchés. Cette hausse de prix est due au manque de stocks. Les récoltes de contre-saison abondent sur le marché. Dans les semaines à venir, la tendance de prix devrait baisser voire se stabiliser à cause de nouvelles récoltes, dit le rapport.
Enfin, le document souligne les difficultés comme l’insuffisance du personnel technique sur le terrain dans les différentes délégations, l’insuffisance des produits de traitement, insuffisance de stocks dans le dépôt de l’Office national de sécurité alimentaire ONASA, les conflits agriculteurs-éleveurs, insuffisance des moyens roulants, etc. affectent le bon déroulement de la saison agricole.
« Si la tendance actuelle est maintenue et que les pluies continuent jusqu’au mois d’octobre, la campagne serait moyenne », conclut le rapport.
Moyalbaye Nadjasna
La campagne pour la distribution des Moustiquaires imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA) a été lancée, ce lundi 20 septembre dans la commune du 9e arrondissement à N’Djamena, capitale du Tchad. Sur le terrain, les centres de santé et district sanitaires ont reçu chacun une quantité de moustiquaire à distribuer dans les ménages. La rédaction est allée dans quelques centres de santé. Reportage.
Le paludisme fait beaucoup de victimes surtout en cette période. Les plus touchées sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Pour réduire le taux de mortalité lié au paludisme, le gouvernement lance la campagne de distribution des moustiquaires après celle de démoustication de la ville de N’Djamena. Ce sont des moustiquaires imprégnées à Longue Durée d’Action (MILDA). Elles sont mises à la disposition des centres de santé et districts sanitaires par le ministère de la Santé publique. Mme Souvenir Pauline est responsable du centre de santé AKS. Son centre couvre les quartiers, Ardep-djoumal, Kabalaye et Sabangali. Elle déclare que les moustiquaires sont remises conformément au nombre de la population dans la zone de couverture. Mme Souvenir Pauline informe qu’elle a reçu 460 ballots, dont 50 moustiquaires par balles, soit 23.000 moustiquaires à distribuer aux ménages. Dans sa zone, elle a mis à contribution les chefs de carré dans la chaîne de distribution.
Avant l’opération de distribution sur terrain, elle s’est entretenue avec les distributeurs sur la conduite à tenir. Il s’agit du nombre de moustiquaires à donner aux ménages et les conditions d’utilisation. Elle conseille aux bénéficiaires d’étaler les moustiquaires sous l’ombre à l’air libre au moins 4 heures du temps avant de l’utiliser. « Ne pas laver la moustiquaire au détergent ou à l’eau de javel. Utiliser simplement le savon pour laver la moustiquaire quand elle est sale », explique Mme Souvenir Pauline.
Au centre de santé Place Nord situé au quartier Blabline dans le 4e arrondissement, la distribution est effective ce 21 septembre. Le centre a reçu 125 ballots contenant chacune 50 moustiquaires, soit 6250 moustiquaires pour ce quartier. « Douze relais communautaires vont distribuer les moustiquaires dans 13 carrés durant 5 jours », affirme M. Hamit Mackaye, superviseur de la campagne de distribution de Blabline. Selon lui, les distributeurs passent de porte en porte et enregistrent les ménages dans la fiche de dénombrement et la fiche de pointage avant de donner les moustiquaires. Cela, dit-il, pour éviter que certaines personnes ne reçoivent à plusieurs reprises les moustiquaires.
Dans le quartier Blabline, les chefs de carré ne sont pas impliqués dans la distribution indique le superviseur. « Ils ont été mis à contribution dans les précédentes distributions des moustiquaires et beaucoup d’irrégularités ont été relevées », dit M. Hamit Mackaye. La présente campagne de distribution concerne seulement la ville de N’Djamena.
Kouladoum Mireille Modestine
Les épreuves écrites du concours d’entrée à l’École Nationale d’Administration ENA au titre de l’année 2021-2022 viennent d’être lancées. C’est l’Amphithéâtre de cette École qui a accueilli, ce mardi 21 septembre le cérémonial. Environ 7500 candidats composent sur toute l’étendue du territoire national, a annoncé la secrétaire générale adjointe du gouvernement (SGAG) Mme Walmi Bairra Assane. N’Djamena, la capitale tchadienne, compte près de 5000 candidats. Reportage.
Les épreuves écrites du concours d’entrée à l’École Nationale d’Administration ont eu bel et bien lieu ce 21 septembre comme prévu. Près de 7500 candidats composent dans 9 centres, d’Abéché, Bol, Bongor, Mao, Mongo, Moundou, N’Djamena Pala et Faya. Ce concours est ouvert aux candidats du 1er et 2d cycle en interne comme en externe. Les candidats internes sont ceux qui travaillent déjà dans l’administration publique. Les candidats externes sont des jeunes bacheliers et licenciés.
Le déroulement des épreuves était effectif juste après l’adresse de la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Mme Walmi Bairra Assane. « Notre ambition en organisant ce concours est de doter nos administrations publiques des cadres de qualité. L’exigence de qualité commence avec la transparence dans l’organisation des épreuves, puis dans la délibération des résultats du concours. La transparence et la crédibilité s’imposent à juste titre dans la rigueur des principes d’égalité de chance pour tous », a déclaré la SGAG. Elle instruit les candidats à ne pas laisser de faille s’incruster dans tout le reste du processus. Mme Walmi Bairra Assane a rassuré les candidats des dispositions fermes prises pour la transparence et le mérite, avant de préciser que, c’est le seul critère retenu pour l’admission à ce concours.
Dans la capitale N’Djamena, 400 sont retenus pour la composition. Il s’agit de l’École Nationale Supérieure (ENS), le complexe scolaire Ibnou Cina, le lycée féminin et l’École Nationale d’Administration (ENA). À signaler que 6 candidats malvoyants sont aussi candidats au concours. Actuellement un est malade et sur les cinq qui composent au centre de N’Djamena il y’a donc une fille. L’École Nationale d’Administration est créée depuis 1963, les admis compteront pour la 19e promotion.
Kouladoum Mireille Modestine
Un conflit intercommunautaire entre les villages de Kidji-Mira et de Tiyo, dans le Ouaddaï a fait environ 27 morts le 19 septembre dernier. Pour empêcher que la situation s’envenime, le président du CMT mobilise plusieurs membres du gouvernement et les sages de la province pour trouver des solutions idoines.
La convention tchadienne de défense des droits de l’homme (CTDDH) interpelle les autorités à trouver une solution définitive aux conflits communautaires qui sévit dans le Ouaddaï. Le 19 septembre dernier, un conflit foncier a opposé les villages de Kidji-Mira et de Tiyo, dans le Ouaddaï a fait plus de 27 morts. Le secrétaire général adjoint (SGA) de la CTDDH, Ibrahim Mahamat Ibrahim, affirme que la responsabilité de cette tragédie incombe les autorités centrales et locales.
Pour le SGA, les nominations complaisantes des agents médiocres et sans formation dans l’administration locale seraient à l’origine de ces gestions scabreuses aux conséquences dramatiques des affaires provinciales. Brahim Mahamat Brahim estime que c’est le laxisme et l’irresponsabilité des responsables administratifs et sécuritaires qui a causé des pertes en vies humaines. Il affirme que son organisation est indignée en rajoutant que cette tragédie aurait pu être évitée. La CTDDH exige que les instigateurs de ces massacres soient arrêtés et punis conformément à la loi.
Pour éclairer la lanterne des lecteurs, la rédaction a contacté le sultan d’Abéché, mais il affirme qu’ils sont en conclave avec les autorités locales et quelques membres du gouvernement de la transition pour trouver une solution idoine à ces conflits qui ont tant ensanglanté le Ouaddaï.
Dans un tweet, le président du CMT, le général Mahamat Idriss Deby Itno a condamné ce conflit. Il a aussi présenté ses condoléances aux familles éplorées tout en appelant la Justice à faire son travail. « Face à cette barbarie, le gouvernement a dépêché sur place plusieurs ministres pour prendre toutes les mesures qui s’imposent afin que les criminels à l’origine de ce bain de sang soient sévèrement punis conformément à la loi », écrit le président du CMT. Selon le ministère de la Justice, les deux villages se disputent une superficie d’environ 25 km2. La province du Ouaddaï a connu plusieurs conflits intercommunautaires de ce genre qui se sont toujours soldés par des pertes de vies humaines. Pour permettre aux communautés de vivre côte à côte en paix, les autorités locales et gouvernementales devraient s’atteler davantage à trouver des solutions définitives.
Jules Doukoundjé
Les cadres et ressortissants du Borkou ont réagi au sujet de l’ordonnance du 31 août 2021 qui rattache une partie de leur province au Tibesti. Ils ont au cours d’un point de presse ce 20 septembre 2021, tenu à informer l’opinion nationale de leur désaccord à propos de cette ordonnance. Ils estiment que celle-ci est prise pour satisfaire l’exigence de certaines personnes du Tibesti. Reportage
Au cours d’une Assemblée générale (AG) organisée le 12 septembre dernier à Faya, la population de Borkou, les chefs de cantons, les associations de la société civile ont tenu à exprimer leur désaccord par rapport à l’ordonnance rattachant une partie de leur province au Tibesti. C’est aussi dans ce contexte que certains cadres et ressortissants ont organisé un point de presse ce lundi 20 septembre à N’Djamena pour informer l’opinion nationale. Pour le porte-parole des cadres et ressortissants du Borkou à N’Djamena, Hassan Eli Tidei, les dirigeants de certaines instances du Dialogue Nationale Inclusif (DNI) en cours ont conditionné leur participation à ce forum à cette ordonnance. Selon lui, cet acte ne se soucie pas de la cohabitation pacifique des populations depuis 1918 et reconduite lors du découpage administratif colonial de 1952. Il souligne que la Constitution et la charte de la transition ne prévoient aucun recours aux citoyens par exemple à la pétition pour exprimer leurs préoccupations. Toutefois, un recours gracieux en annulation a été adressé au Président du Conseil Militaire de Transition (CMT), au Premier ministre de la Transition, au Président de l’Assemblée nationale (PAN), aux présidents des groupes parlementaires, aux chefs de différents partis politiques et aux sages et sans aucun clivage.
« Devant cette situation grave, les ressortissants du Borkou ont été surpris par la mesure prise à un moment où les Tchadiens désirent vivres ensemble en rejetant les risques de la dislocation du tissu social et de la désolation », déclare, Hassan Eli Tidei. Il ajoute que les ressortissants du Borkou considèrent cette ordonnance comme un facteur aggravant la situation. Elle est susceptible de replonger la province et le Tibesti dans la haine, les déchirures tribales et ethniques.
A son avis, bien que le Tchad soit un État unitaire, il y a une exception Tibesti qui se manifeste par une administration territoriale dirigée uniquement et à tous les niveaux par les locaux. Aussi, il note que ce tête-à-tête ethnique dans la province permet à ceux-ci de détourner les moyens et les missions régaliennes de l’État qui leur sont confiés au profit d’un pseudo « État du Tibesti dans l’État du Tchad ». Le porte-parole a en outre révélé que pendant les 30 dernières années, le Borkou est la cible principale des découpages et morcèlements, comme en témoigne la configuration de sa carte réduite de presque 60% au profit du Tibesti et de l’Ennedi.
Pour les cadres du Borkou, le plus grand défi du pays dans les provinces du Nord n’est pas dans les découpages territoriaux, mais dans les moyens nécessaires à leur développement. Et à l’unité des Tchadiens, quelle que soit la forme de l’État qui sera acceptée lors du prochain DNI.
Jules Doukoundjé
- Arts & Culture
- Musique
- Mode-Beauté
- Divertissement
- Sports
- Mon Pays