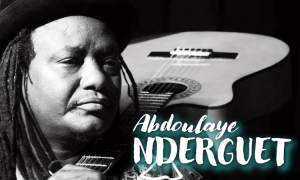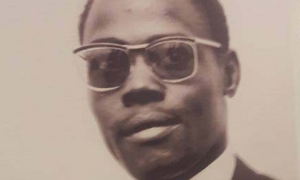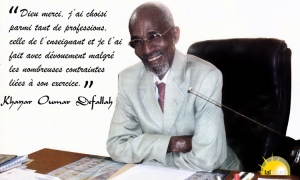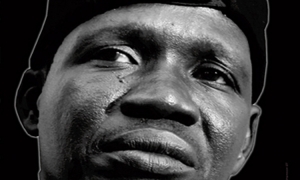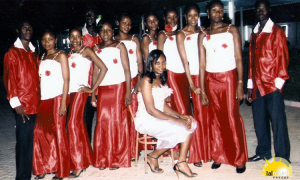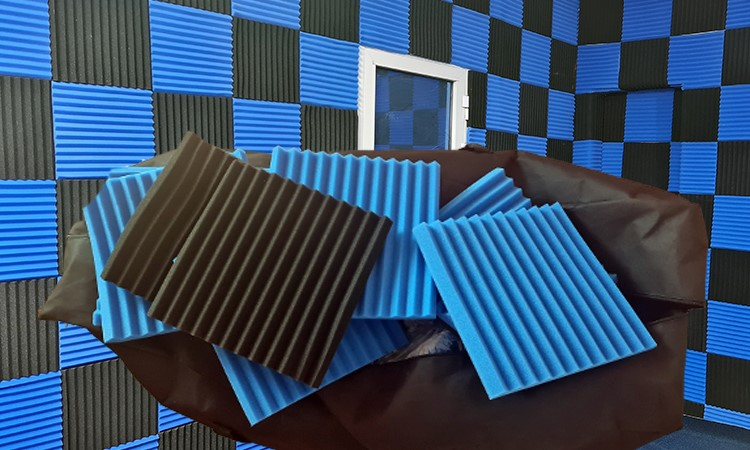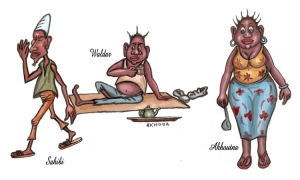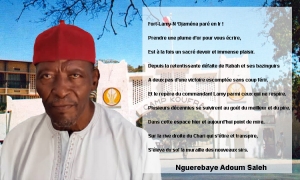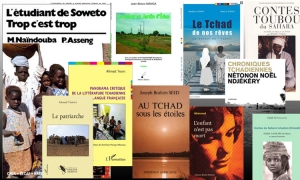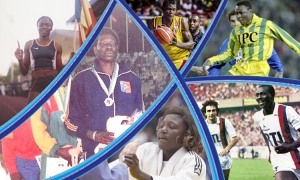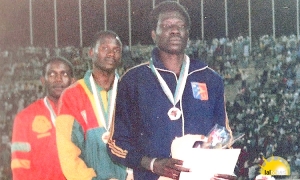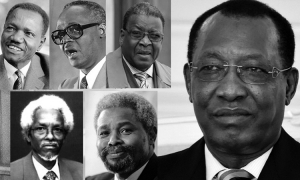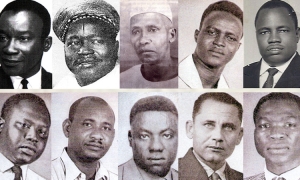A la Une
- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…
- Départ de l’armée française, merci président Mahamat
- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?
- Cérémonie de désengagement des troupes françaises
- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…
- Succès Masra, au bout de l’inconstance
- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…
- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?
- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024
- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection

Ialtchad (1563)
Une décision de justice c'est lorsqu'il y a un conflit qu'il soit correctionnel, social, civil ou commercial entre deux parties pour lesquelles le juge a prononcé son verdict. Elle n'est exécutoire définitivement que si les voies de recours judiciaires sont épuisées. Sauf pour les mesures conservatoires ou les jugements avant dire droit. Au Tchad, assez d'obstacle sapent l'exécution de la décision judiciaire. Me Hisseine Ngaro, huissier commissaire-priseur explique le mécanisme. Reportage.
Le juge du Tribunal de Grande Instance (TGI) prend ses décisions, mais si l'une des parties n'est pas d'accord, elle va faire appel, dit Me Hisseine Ngaro, huissier et commissaire-priseur. En appel, dit-il, si les parties sont toujours insatisfaites, elles peuvent se pourvoir en cassation. C'est alors toute une procédure lorsqu'on parle de décision judiciaire ou décision de la justice, assure l’huissier. Il précise que c'est une décision qui revêt l'autorité de la chose jugée, ou exécutoire.
Selon Me Ngaro, aujourd'hui les décisions de justice n'arrivent pas à être exécutées à cause de la déliquescence judiciaire que nous vivons. Pourtant, soutient-il, la loi est claire sur la question d'exécution de la décision de justice. « Vous allez trouver un huissier-commissaire de justice qui rencontre toutes les difficultés pour l'exécuter. Or cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée. L'huissier de justice ne peut pas exécuter la décision qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée. Sauf pour les mesures conservatoires ou les jugements avant dire le droit, l'huissier est tenu de rester dans le cadre de ce dispositif », dit-il.
Pour illustrer son propos, Me Ngaro, affirme que le juge peut par une décision conservatoire suspendre des travaux de construction. L'huissier qui va vers le propriétaire de ce terrain litigieux lui signifie cette mesure conservatoire de suspension des travaux. « Mais s'il refuse d'obtempérer, on établit un procès-verbal de constat notifiant la poursuite de la construction. Ensuite, on dresse un procès-verbal de revenant pour déposer auprès du Procureur de la République. Et la plupart des cas, ces gens ne sont pas poursuivis. Si d'aventure le juge rend une décision pour ordonner la destruction, il revient toujours à l'huissier de l'exécuter ». Dans un tel cas d'espèce, dit-il, le Procureur de la République demande la poursuite de la personne incriminée pour rébellion à la loi. D'après Me Ngaro, maintenant de manière globale, tout le monde fait obstacle à la décision de justice. « Par exemple le juge rend une décision et lorsqu'un huissier va pour son exécution il l'appelle pour surseoir. Ce sont des cas que nous avons vécus. Mais moi je continue l'exécution parce que demain, c'est la crédibilité de l'huissier qui est mise en cause », soutient l'huissier. À son avis, le plus souvent, les juges et les procureurs reçoivent des appels du politique.
« Quand nous étions arrivés à la justice dans les années 88-89, la justice était respectée et non celle d'aujourd'hui. Je faisais partie de ceux qui ont composé la justice et nous avions condamné Chedeille Soukoudou qui était la sœur du défunt président tchadien Hissène Habré. Il nous l'a livrée lui-même pour qu’elle soit jugée. il n’y a pas cela depuis 32 ans », rappelle Me Ngaro. La justice doit se démarquer du politique. C'est dommage, on apprend que certains magistrats détiennent les cartes des partis politiques, dit cet huissier qui a 35 ans dans le métier. Pour lui, la magistrature c'est un pouvoir, si les magistrats continuent à plaire à l'exécutif, ils n'auront jamais la main libre pour prendre des décisions. Le magistrat doit être un homme indépendant qui rend la décision au nom du peuple tchadien, insiste-t-il.
Le judiciaire doit arriver à dire stop et dire qu'il n'a pas des ordres à recevoir de l'exécutif ou du législatif. « Nous sommes tous des esclaves de la loi et non au-dessus de la loi tant que cela n'est pas résolu, on va nous traîner toujours par le nez. Ce n'est pas une question d'huissier seulement au cours de l'exécution des décisions de justice, on a des camarades qui ont été tués et blessés », affirme Me Ngo Hisseine. Aux jeunes huissiers, il leur conseille le respect de la déontologie et l'éthique de la profession. D'après lui, le gain facile est nuisible, il faut faire le travail avec plus de professionnalisme. Il déplore surtout la division au sein de leur corps. C’est un obstacle pour l'avenir de ce métier qui dépend surtout des anciens huissiers, affirme Me Ngaro.
Moyalbaye Nadjasna
La série de la conférence-débat publique organisée par le comité technique d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) prend fin. Le dernier thème est « les conflits intercommunautaires au Tchad : état des lieux et solutions ». 5 panélistes composés de chefs traditionnels, des chefs religieux, mais aussi des enseignants chercheurs et experts ont mis à nu le nœud du problème et ont suggéré quelques pistes de solutions. Reportage.
Les conflits intercommunautaires ont endeuillé plusieurs familles au Tchad. Chaque année le pays enregistre plusieurs de conflits intercommunautaires et les autorités en charge de la sécurité publique et de l’administration du territoire peinent à mettre fin à ces conflits qui désolent les citoyens, surtout ceux du monde rural, éleveurs et agriculteurs. Pour mettre fin à cette situation malheureuse, le CODNI, dans le cadre du prochain dialogue organise une série de conférence-débats publiques. Le dernier thème de cette série de conférences-débats est « les conflits intercommunautaires : états des lieus et solutions ».
Pour sa majesté Tamita Djideingar, président de l’association des chefs traditionnels au Tchad, qui expose sur les conflits liés aux chefferies, souligne que la recrudescence de ce phénomène posent problème pour un Tchad en construction. Selon lui, les chefs traditionnels sont avec la population à la base et vivent au quotidien avec les populations et connaissent aussi bien comment cela se passe. Le chef de canton de Donomangua, soutient que les autorités traditionnelles sont les détentrices et garantes de valeurs traditionnels de ces communautés et exercent de pouvoir profond et en cas de trouble, ils sont impliqués dans la recherche de solution. Il ajoute que les conflits méritent d’être traiter avec une grande attention. Il estime que ces conflits sont liés à l’accès aux ressources naturelles telles que les terres, les forêts, les cours d’eau et leurs répartitions. Sa majesté Tamita Djideingar suggère le rétablissement de l’harmonie au sein de la communauté.
Pour le Pr Djérareou Abel, qui expose sur le conflit interreligieux, et comment les religieux contribuent à trouver de solution, les religieux ont contribué à atténuer la tension dans les conflits interreligieux et interethnique pour pouvoir vivre ensemble. Selon lui, les conflits ont pour cause la manière de vivre sa foi qui amène les conflits interreligieux. Il affirme que la principale cause de division est la méconnaissance de l’autre. Le pasteur souligne que pour promouvoir le vivre ensemble, les religieux proposent l’enseignement de valeurs humaines partagées. Il ajoute que le tchadien utilise souvent le nom de Dieu, et que ce sentiment religieux peut faciliter le dialogue.
L’expert du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, Kabadi, estime que le ministère éprouve beaucoup de difficultés pour résoudre les conflits intercommunautaires dans notre pays. Il énumère l’absence et l’insuffisance de moyens de travail. Il révèle que le pays compte 420 sous-préfectures et les chefs des unités administratives travaillent dans de conditions difficiles et cela ne favorisent pas la gestion des conflits. L’expert évoque aussi la multiplication des unités administratives et les chefferies traditionnelles sans assises territoriales précises qui seraient aussi une des causes du problème. Pour résoudre, M. Kabadi propose qu’on revalorise le salaire des agents de commandement et leur allouer les moyens conséquents pour faire correctement leur travail. Il propose qu’on renforce les mécanismes traditionnels et communautaires de règlement de conflits. Selon lui, les communautés ont leurs moyens de régler les conflits.
Tirant la conclusion de la série de conférences-débats organisées durant la semaine, le président du comité technique du CODNI, Djégoltar Gambaye Armand se réjouit des panels et du niveau de débats qui sont francs et ouverts. Il appelle les médias à organiser les débats contradictoires sur les sujets d’actualité.
Jules Doukoundjé
L’Union des Syndicats du Tchad (UST) a tenu sa deuxième Assemblée générale (AG) évaluative ce samedi 4 juin à la Bourse du Travail. Des travailleurs des secteurs publics et privés se sont présentés et ont évalué à tour de rôle la grève au niveau sectoriel. Il a été décidé de tenir une autre Assemblée au cours de laquelle le service minimum dans les hôpitaux sera suspendu si les leaders arrêtés ne sont pas libérés le lundi. Reportage.
La grève est évaluée de temps à autre pour voir ou est-ce les syndicalistes vont. L’UST se réjouit du fait que les travailleurs des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de l’administration du territoire, du pétrole ont pris part à l’AG de ce samedi. Chaque représentant des cellules syndicales a pris la parole pour évaluer la grève au niveau de son secteur respectif. Pour le président de L’UST Barka Michel, son organisation syndicale est satisfaite du fait que la grève continue à être suivie. Il poursuit en disant que des décisions allant dans le sens de leurs camarades en prison ont été prises. « Il a été décidé que jusqu’au 06 juin si nos camarades ne sont pas libérés, une autre AG sera conviée le mardi et probablement le service minimum sera suspendu. Les syndicalistes du secteur de l’élevage disent que les heures d’battage seront fermées. Le secteur privé décide de faire une grève de solidarité non pour soutenir, mais l’observer normalement comme il le faut. Alors nous sommes contents que les gens comprennent le sens de la lutte que nous menons », affirme-t-il.
L’occasion est toute indiquée pour l’UST de faire le point sur le soutien international qu’ils ont. Pour lui, toutes les organisations syndicales internationales leur ont apporté leur soutien. Elles ont en même temps pris de dispositions pour se faire entendre au niveau de Genève. « On ne peut pas négocier avec des gens qui ne respectent pas leurs propres lois. On va plutôt durcir les actions pour montrer au gouvernement que la solidarité des travailleurs ne va pas s’arrêter. Nous avons le soutien de la population face aux agissements du gouvernement. La seule chose qui reste au gouvernement c’est mettre les gens en prison et nous nous sommes fatigués de leur prison », a affirmé Barka Michel.
Il ajoute également que les autorités les insultent au téléphone, les suivent partout, mais tout cela ne veut rien dire pour les syndicalistes. L’UST a elle aussi engagé des procédures judiciaires contre l’État tchadien en déposant une plainte au niveau du Bureau international du travail (BIT). Me De La Rochelle suit le dossier et il a saisi la cour de Justice des droits de l’Homme et des peuples de l’Union africaine (UA). Le président de l’UST demande à tous les syndicalistes et militants de Wakit Tamma de converger tous au Tribunal de Grande Instance de N’Djamena pour dire qu’ils ne sont pas contents du déroulement du procès à Moussoro.
Kouladoum Mireille Modestine
Josiane Djikoloum Darwatoye a présenté ce jour 4 juin au Centre d’Études pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE) deux (2) articles de recherche. L’un intitulé « Une analyse conceptuelle du sentiment anti-français au Sahel » composé de cinquante (50) et l’autre « Action des femmes en matière de prévention de l’Extrémisme violent en quoi est-ce pertinent ? » composé de vingt-sept (27) pages. Reportage.
Le premier article intitulé « Une analyse conceptuelle du sentiment anti-français au Sahel » parut au Centre d’Études pour le Développement et la Prévention de l’Extrémisme (CEDPE). Pour la chercheuse, cette étude intervient à un moment où les relations entre la France et les pays du sahel sont remises en cause par les populations locales. Selon l’auteur, la remise en cause de ses relations s’explique par la montée en puissance de sentiment anti-français. Elle ajoute que cette question ne doit être prise au sérieux, sinon les conséquences seront désastreuses dans la lutte contre le terrorisme d’une part et sur le plan politique et diplomatique, d’autre part.
Pour elle, quelques conséquences sont déjà visibles, le départ de l’armée française du Mali et les manifestations anti-françaises un peu partout sont des parfaites illustrations, dit-elle. L’auteur affirme aussi que les populations locales sont frustrées par la présence militaire française et le résultat mitigé dans la lutte contre le terrorisme. Josiane Djikoloum Darwatoye présente trois (3) pistes de solution.
Tout d’abord, mettre la population au cœur de toute action de partenariat et prendre en compte le besoin de la population et respecter son choix. Ensuite, ouvrir un débat franc avec les universitaires, les chercheurs, les acteurs de la société civile afin de réajuster le partenariat Nord-Sud, rétablir le lien de confiance qui s’est brisé entre la France et les pays de l’Afrique dans le respect et la non-ingérence dans les affaires internes des États.
Le second article intitulé « Action des femmes en matière de prévention de l’Extrémisme violent en quoi est-ce pertinent ? ». Selon l’auteur, la croyance populaire veut que les femmes ne soient que victimes de l’extrémisme violent, pourtant les récentes tendances terroristes dans la région du sahel indiquent que les femmes sont à la fois victimes et auteurs des conflits. Pour Josiane Djikoloum Darwatoye, ces femmes peuvent à l’inverse être des auteurs clés dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent à tous les niveaux. Pour l’auteur, l’élaboration des politiques seules ne peuvent pas changer leurs communautés, mais plutôt la sensibilisation globale au Genre pourra être encore plus bénéfique afin de détecter les changements et les influences néfastes dans la société. Elle invite par cet article, l’opinion publique a porté un regard sérieux sur cette thématique. Si les femmes sont instrumentalisées dans l’extrémisme violent, elles peuvent aussi être vitales dans cette lutte et doivent à cet effet être impliquées.
Abderamane Moussa Amadaye
Ousmane Bello Daoudou
Le jugement des organisateurs de la marche autorisée du 14 mai dernier prévue pour le 6 juin va se dérouler en audience foraine à Moussoro. Pour éclairer nos lecteurs sur certains termes juridiques et l'appréciation de la procédure pénale enclenchée, Ialtchad Presse s'est entretenu avec Me Mouné Koudanbé et le prof Ahamat Mahamat Hassane, ex-ministre de la Justice, analyste politique et enseignant-chercheur. Explications.
Pour éclairer la lanterne des lecteurs, Me Mouné Koudanbé précise qu'une audience foraine est une audience qui se tient hors de son tribunal de juridiction ou d'un bâtiment juridique officiel, dans une autre localité que celle où siège la juridiction. Il explique que dans le cadre de l'audience foraine, l'administration juridique se rend directement au-devant des justiciables. l'avocat souligne que la procédure engagée pour cette audience qui vise les leaders de la manifestation du 14 mai dernier est illégale parce que le tribunal de Grande Instance ne peut pas aller siéger dans le ressort d'un autre tribunal de même degré que lui.
Selon professeur Ahmat Mahamat Hassane, toute la procédure est nulle et les avocats des prévenus l'ont soulevée d'une manière assez explicite et exhaustive. « Le tribunal compétent dans cette affaire quel que soit la qualification qu'on puisse donner, c'est le Tribunal de N'Djamena. D'abord la procédure de leur arrestation est illégale même si certains ont refusé de répondre aux convocations, le Code de procédure pénale prévoit le mandat d'amener et le mandat d'arrêt. On aurait dû fait usage de toutes les procédures prévues par le Code de procédure pénale tchadien », dit prof Ahmat. À son avis, l’arrestation du porte-parole de Wakit Tamma Me Max est un enlèvement. Par conséquent ils ont commis une autre infraction, dit-il. Il rajoute que, c'est une déportation sans qu'il ne soit reconnu coupable d'une infraction, ou condamné. « Ils sont des prévenus et en droit tchadien ils sont dans la présomption d'innocence. C'est dommage, le droit tchadien a été violé dans tous les sens », martèle le professeur.
Autre précision : l'analyste Ahmat déclare qu'il ne faut pas oublier également que le procureur de la République de N'Djamena a fait une déclaration, soi-disant qu'il a reçu des instructions, ont signifié les avocats des prévenus. Le procureur quel qu’est son rang, qu'il soit procureur de la République près d'un tribunal de Grande instance ou procureur général, près la Cour d'Appel et leurs substituts, ils sont dans une situation de subordination vis-à-vis de l'exécutif. Il s'agit notamment du ministre de la Justice et de sa hiérarchie. « Ces parquetistes ne sont pas comme le juge de siège qui jouit de son intimité et guidé par son intime conviction. En ce moment, nous voyons que la Justice est dans une situation de violation de ses propres règles de procédure. C'est dommage pour la République du Tchad », lance-t-il.
Pour compléter son analyse, le spécialiste en Droit public affirme que les gens se sont rendu compte des multiples violations de la loi pénale et de la procédure pénale, ils ont déporté l'audience qui devrait se tenir à N'Djamena en audience foraine à Moussoro. Les raisons soutient prof. Ahamat, les magistrats de Mossoro ne sont pas compétents, car les infractions n'ont pas été commises sur leur ressort territorial, mais sur celui de N'Djamena. Pour couvrir leurs fautes de procédures et toutes les violations, ils ont contourné la loi pour organiser une audience foraine, poursuit l'analyste. Professeur Ahamat indique que les conditions de la tenue d'une audience foraine en dehors du tribunal sont claires. Et dit-il, il n'y a aucun impératif pour ouvrir une procédure d'une audience foraine. « C'est de la gymnastique intellectuelle pour couvrir le manquement de la procédure et les violations », assure l'enseignant-chercheur.
Moyalbaye Nadjasna
La série de conférences-débats publiques organisées par le comité technique pour l’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), continue. Le thème de ce vendredi est « pardon, réconciliation et dialogue ». Cette avant-dernière conférence-débat qui a lieu dans l’auditorium de l’office national des médias audiovisuels (ONAMA) a mobilisé plusieurs leaders des associations féminines et de la société civile. Reportage.
Les dialogues nationaux sont des processus politiques nationaux visant à générer les consensus parmi un large éventail d’acteurs nationaux en temps de crises politiques profondes, dans les situations d’après-guerre ou lors des transitions politiques profondes, définissent un auteur. Ces cas de figure sont expérimentés par notre pays. C’est dans ce sens que le CODNI organise depuis le 30 mai dernier une série de conférences-débats publiques pour informer et sensibiliser les citoyens sur les enjeux du dialogue national inclusif (DNI). Ce vendredi, le débat est accès sur le thème « pardon, réconciliation et dialogue ». 5 panélistes ont tour à tour expliqué l’importance d’organiser le dialogue avant d’ouvrir le débat qui a suscité la réaction de certains des jeunes, des responsables politiques, mais aussi des leaders de la société civile et des associations féminines.
Pour Abdéraman Djasnabaille, président du sous-comité thématique cohésion sociale, les facteurs qui divisent les Tchadiens sont multiples. Il énumère le problème de manque de la justice et le problème de la gouvernance. Selon lui, le pays a un déficit de bonne gouvernance. Abdéraman Djasnabaille souligne que les membres du gouvernement ne respectent pas les textes votés à l’hémicycle.
Dans la même logique, la directrice générale de la maison de la femme de N’Djamena Mme Dékoubou Mbaitoloum c’est urgent de trouver les voies et moyens pour une réconciliation. La directrice qui débat sur le thème « les conditions de pardon et de réconciliation » souligne que c’est un thème pertinent et vaste, qu’il faut avoir une expertise avérée. Selon elle, la réconciliation est un cheminement qui passe par la révélation de la vérité. Elle ajoute que pour se réconcilier, il faut se parler vrai et que l’autre reconnaît sa faute. Et c’est à ce niveau qu’il peut y avoir la réconciliation. Au sujet du pardon, elle a cité quelques versets du coran et de la bible pour démontrer l’importance de la réconciliation et du pardon pour les Tchadiens.
Djimta Martial est revenu sur les différents points de vue de la directrice de la maison de la femme. Il soutient que pour qu’il ait dialogue et réconciliation, il faut tenir compte de la vérité, il faudrait que les langues soient déliées, et que la vérité devrait être dite dans le respect de l’autre. Le juriste affirme qu’après le pardon, il tenir compte de la justice qui est un élément fondamental. Selon lui, sans la justice il est impossible de se faire la paix. « La réconciliation, c’est l’acte de mettre deux personnes en rapport ou un comportement d’unir deux communautés en état de conflit. Lorsque vous arrivez à les concilier vous être en train de développer le processus de réconciliation », explique-t-il. Il a pendant longtemps mis l’accent sur la justice transitionnelle. M. Djimta précise que dans un pays qu’on l’accent sur la justice transitionnelle, c’est une nation qui a traversé des périodes difficiles, autoritaires, totalitaires ou la dictature. Dans ce pays, dit-il, le peuple est opprimé et subit un mauvais traitement. Dance ce cas de figure, il propose la justice transitionnelle. Il soutient que le pays sort d’une situation difficile et il est raisonnable de rechercher la démocratie. Le juriste propose aussi que l’on établisse la vérité, offrir une tribune aux victimes en mettant sur pied les tribunaux. Il ajoute qu’après avoir offert une tribune aux victimes, il faut faire apparaître la responsabilité des auteurs de violations. Il suggère aussi que ceux qui ont commis de crimes soient poursuivis et renforcer l’État de droit et promouvoir le débat public.
Jules Doukoundjé
Rien ne va depuis quelques jours entre la direction administrative, la direction des études, la surveillance générale et les enseignants chargés de cours du Collège d’Enseignement général (CEG) N°2 d’Abena. Tout est parti d’un arrêté d’affectation sorti depuis le 22 avril dernier qui mute 4 enseignants de leur poste pour la province de Wadi-Fira et dans la même école. Les enseignants ont prévu organiser un sit-in ce 03 juin pour exiger le départ du directeur administratif, mais la Direction des Ressources humaines a calmé la tension. Reportage
La Direction des Ressources humaines DRH a convoqué ce matin les quatre enseignants mutés pour jouer la médiation suite au conflit qui les oppose avec le directeur administratif de l’établissement scolaire Abdel-bassid Mahamat Yacoub Dabio. De l’avis des enseignants, le directeur administratif a adressé une correspondance à la direction des ressources humaines pour affecter quatre des enseignants pour motif de perturbation. Informés, ces derniers boudent l’arrêté et comptent organiser un sit-in afin d’exiger le départ de leur directeur Abdel-bassid Mahamat Yacoub Dabio. Rencontrés, la direction des ressources a demandé aux éducateurs de sursoir au sit-in et penser plutôt à l’organisation du Brevet de l’Enseignement Fondamental (BEF) qui est à la porte. La DRH a également reproché aux enseignants de ne pas la saisir au préalable pour résoudre le problème, mais qu’ils ont écouté sur les ondes de la radio qu’un sit-in est prévu. Il ressort de cette médiation que les enseignants mutés ne seront plus au CEG d’Abena, mais seront réaffectés dans un établissement dans la commune du 7e arrondissement pour le compte de l’année 2022-2023. Le directeur administratif Abdel-bassid Mahamat Yacoub Dabio sera lui aussi affecté ailleurs.
Bembatem Victor est l’un des mutés, il fait la genèse du problème. Pour lui, la goutte d’eau qui a débordé le vase est la demande que les enseignants ont émise à propos de la clôture de l’établissement. « Lors d’une réunion avec le directeur, les enseignants lui ont demandé de faire un budget annuel et introduire le chapitre clôture de l’école. Depuis ce jour, le directeur a ciblé ceux qui ont pris la parole pour aborder cet aspect et c’est cela qui est à l’origine de notre affectation sanction », explique-t-il. Il ajoute que le directeur Dabio a tout confisqué et s’est refermé sur lui-même. Il ne collabore pas avec ses collègues et ne rend pas compte de la gestion financière de l’école. Pour les enseignants, le directeur est un ex-combattant qui ne fait pas partie du corps enseignant, mais mange dans la même assiette qu’eux. Au final les éducateurs ont décidés que si jamais les noms des quatre mutés ne figurent pas sur la liste de l’organisation du BEF, ils vont boycotter cet examen. Jusque-là, la liste des élèves devant composer le BEF et les enseignants qui doivent surveiller le déroulement des épreuves ne sont pas encore affichés.
Contacter pour sa version de fait, le directeur administratif contesté Abdel-bassid Mahamat Yacoub Dabio, affirme que c’était une incompréhension entre ses collègues et lui. Et que la hiérarchie a déjà résolu le problème.
Kouladoum Mireille Modestine
La capitale tchadienne N’Djamena est ceinturée à moitié par le fleuve Chari à sa sortie sud. Généralement vers les mois d’août et septembre voire octobre, c’est la période de crue ou montée des eaux. Les lits du fleuve sont occupés dans leur totalité. En période de décrue, les riverains mettent en valeur la berge. Diverses cultures sont entreprises. Mais la culture du manioc semble la plus répandue. Reportage.
Maxime, 16 ans travaille chaque matin et soir sur-le-champ de manioc de sa grande sœur. Ce matin, il chasse les cabris qui viennent souvent manger leurs pépinières. Il est maintenant en vacances et opte porter secours à sa grande sœur. « Je fais ce travail depuis cinq ans déjà. C’est un job pénible, mais on ne gagne rien sans sacrifice. Je me pointe ici à 5heure du matin. J’introduis la motopompe dans le fleuve pour drainer l’eau au pied des jeunes plants de maniocs. Je m’occupe également du désherbage. Seulement depuis 2 jours, ma motopompe est en panne », se lamente-t-il. Maxime s’inquiète pour ses plants, car, dit-il, s’il n’arrive pas à faire réparer vite sa motopompe, tous ses plants de maniocs vont se sécher. Ce serait une peine perdue à ce stade où tout est encore bon, assure-t-il.
Son voisin s’appelle Michel Weinembé, âgé d’une vingtaine d’années, il travaille pour le compte de M. Ousmane Abakar. Il est père d’une petite famille. « Je fais ce travail pour aider ma maisonnée. Rien n’est facile dans la vie. Ce que ta main sait faire il ne faut pas hésiter. Telle est ma vision de la vie », confie le jeune homme. Le manioc lorsqu’on la cultive, il faut six (6) à sept (7) mois pour récolter les tubercules. Michel relate qu’ils vendent aussi les feuilles fraîches avec les femmes vendeuses de légumes du marché de Dembé. Il soutient que le revenu leur permet de s’alimenter en carburant pour leur motopompe.
Son Chef M. Ousmane Abakar assure que ce n’est pas facile. Selon lui, ils font une culture de contre saison et par irrigation. L’eau, dit-il, est loin des terres fertiles de la berge. « Nous nous servons des motopompes et le carburant nous revient cher. La terre est fertile, il suffit que les plants soient bien irrigués et ça va bien produire. Une chose que nous déplorons ce sont les cabris des gens qui divaguent. Ils nous détruisent beaucoup de choses », signifie-t-il. L’horticulteur se plaint du fait que les propriétaires de ces animaux répondent que c’est un espace de l’État. Les autorités municipales sont aussi muettes lorsqu’ils leur présentent ces cabris, insiste-t-il. « C’est difficile, en plus de cela, les hippopotames constituent aussi pour nous un grand danger. Il n’y a pas un mois, ils ont tué un horticulteur qui gardait ses plants. On s’est plaint, mais comme le gouvernement les protège, on n’y peut rien », exprime Ousmane Abakar. Il martèle que le gouvernement pourrait bien les effrayer avec de bruit de fusils pour les éloigner de leurs champs.
Ce cultivateur âgé d’environ 60 ans estime que ce n’est tout le monde qui travaille au bureau. Il affirme que les gens négligent les pauvres qui se lancent dans le travail de la terre pour assurer leur quotidien. M. Ousmane Abakar ne demande que de matériels de travail à l’État ou à toute bonne volonté. « La berge est vraiment fertile et je crois que si moyens accompagne les efforts, il y aura des résultats surprenants. Il y a de la variété, ce n’est pas seulement du manioc », se résume-t-il.
Moyalbaye Nadjasna
Le mot d’ordre de grève lancé par l’Union des Syndicats du Tchad (UST) il y a plus de deux semaines a eu des répercussions sur le service hospitalier de la capitale. La rédaction d’Ialtchad a fait un tour de quelques hôpitaux pour faire le constat. Reportage.
De l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine en passant par l’hôpital de l’Union et en chutant par l’hôpital Kachallah Kasser, le constant est le même, les hôpitaux sont vidés.
10h. Hôpital de l’amitié Tchad-Chine situé dans le 8e arrondissement au quartier Diguel. À l’entrée de la salle de réception en passant par le bloc de consultation, les lieux sont déserts et calmes. L’ambiance n’était pas comme par le passé. Aux services des urgences, du bloc de laboratoire et de la maternité, l’engouement est passable. Le service minimum est assuré de 7h à 12h. Les portes-urgences sont ouvertes 24 sur 24. Au laboratoire, les services d’analyse de NFS (Formule de numération sanguine), le GE (goûte épaisse du test de paludisme), GS (Groupe sanguin) sont suivis régulièrement par les laborantins accompagnés de quelques stagiaires. Pour Moussa Adoum, Secrétaire général de la Cellule syndicale de l’Hôpital de l’amitié Tchad-Chine « le mot d’ordre de grève lancé par l’UST est effectif, mais le service minimum est fonctionnel. Les urgences sont disponibles à toute heure. Malgré cela les patients brillent par leur absence», dit-il. Un stagiaire rencontré surplace affirme que la grève impacte négativement sa formation.
12h. Hôpital de l’Union, à Chagoua dans le 7e arrondissement non loin de l’ambassade des États unis au Tchad. Au service des blocs opératoires et aux services des urgences ainsi qu’à la petite chirurgie tout est calme, les va-et-vient se font à compte-gouttes. Quelques infirmiers accompagnés par deux stagiaires assurent le service minimum. Dans la salle des urgences et d’hospitalisation, il y a quelques patients. Les malades méditent sur leur triste sort. Et ce calme inhabituel les inquiète.
Il est 13h passé au centre de la ville, précisément à l’hôpital polyclinique Sultan Kasser dans le 3e arrondissement à côté du marché central communément appelé « Souk Kabir » les allées de l’hôpital sont fantomatiques. Les deux entrées, Est et sud, ressemblent aux entrées d’un village fantôme. Il n’y a que quelques infirmiers qui assurent le service minimum et le service d’urgence. Une seule salle héberge un patient, le reste des salles est quasiment vide. Une sage-femme nous confie que le service minimum de la maternité au laboratoire jusqu’aux urgences est opérationnel. Elle ajoute que la grève a des conséquences graves. « A la consultation prénatale, le manque d’un suivi régulier des femmes enceintes peut causer facilement des avortements ou des fausses couches. Si un malade est refoulé à cause de cette grève, il risque la rechute et mort s’en suivra » argument-elle.
La grève déclenchée par l’Union des Syndicats du Tchad (UST) le 25 mai dernier a été suivie par le Syndicat national des Travailleurs (ses) des Affaires sociales et de la Santé du Tchad (SYNTASST). Elle a pour objectif d’exiger la libération du Secrétaire général de la plus grande centrale syndicale du pays (UST), Gounoug Vaima Gafare et cinq (5) autres leaders de la société civile arrêtée il y a deux semaines suite à la marche pacifique autorisée par le gouvernement à l’initiative de la coalition citoyenne Wakit-Tama le 14 mai dernier.
Abderamane Moussa Amadaye
Ousmane Bello Daoudou
Dans le cadre de l’organisation, du prochain dialogue national inclusif (DNI), le comité technique pour l’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), organise depuis le 30 mai dernier, une série de conférences-débats publics. Ce jeudi à l’université Roi Fayçal de N’Djamena, le débat a eu lieu sous le thème « le bilinguisme au Tchad : contraintes et défis ». Reportage.
La salle de conférence de l’université Roi Fayçal est bondée de monde. Plusieurs jeunes composés majoritairement des élèves, étudiants et autres cadres arabophones, mais aussi des francophones sont venus assister à la conférence-débat publique organisée par le CODNI. C’est depuis le 30 mai dernier que cette institution chargée d’organisation du prochain dialogue national inclusif a décidé d’organiser les débats publics pour mieux éclairer la lanterne des citoyens tchadiens sur l’importance du dialogue. Ce jeudi, le débat est accès sur le thème « le bilinguisme au Tchad : contraintes et défis ».
Les 4 panélistes composés des enseignants chercheurs francophones et arabophones ont tour à tour exposé de manière claire et nette ce qu’est le bilinguisme et son intérêt pour un pays comme le nôtre.
Pour l’honorable Bassa Djideingar, le Tchad est bilingue, mais les Tchadiens ne sont pas bilingues. Il souligne que c’est dans l’optique de réorganiser le bilinguisme que l’État a créé le centre national de curricula qui a pour mission de développer les programmes scolaires en français et en arabe. Selon lui, pour réussir il faut repartir au point zéro, c’est-à-dire depuis l’école primaire. Il ajoute qu’il est prévu d’enseigner l’arabe comme langue dans les écoles francophones et le français comme langue dans les écoles arabophones. Il suggère aussi qu’on mette en place un programme de recyclage des cadres tchadiens du privé comme du public, l’apprentissage du français pour les arabophones et de l’arabe pour les francophones. Le député et ancien directeur de planification au ministère de l’Éducation nationale constate que le système mis en place par l’État n’a pas bien fonctionné pour manque de volonté politique. Il estime que les Tchadiens assistent à deux systèmes éducatifs. Pour résoudre le problème de bilinguisme au Tchad, ce dernier souhaite un forum national pour éplucher de manière profonde le problème. Selon lui, il faut dépouiller le bilinguisme dans tous les aspects confessionnels.
Pour Dr Ramatou Houtoin qui expose sur le bilinguisme et l’inclusion sociale, souligne que la langue est un vecteur d’inclusion et cohésion sociale. Elle estime que le pays a choisi le français et l’arabe comme langues officielles parce qu’on a plusieurs dialectes. Sur le plan institutionnel, la chercheuse ajoute que la langue est un facteur d’inclusion et quand elle est mal gérée, elle peut créer des frustrations. Selon elle, le bilinguisme est perçu par un grand nombre des Tchadiens comme une juxtaposition de deux langues. Elle explique que cette façon de faire crée un sentiment de frustration chez les arabophones qui estiment que c’est une mauvaise volonté de l’État d’appliquer et de mettre en œuvre le bilinguisme. Au sujet de l’intégration à la fonction publique, elle ajoute qu’à un moment donné les choses sont faites de telle sorte que la géopolitique a agi et certaines personnes sont intégrées au nom de l’arabe. Pour le Dr Hassabala Mahadi, il y a une confusion entre la langue arabe et la religion. Pour lui beaucoup des jeunes sudistes pensent qu’apprendre l'arabe à l’école, c’est devenir musulman. Pour mettre fin à ce préjugé, le chercheur arabophone suggère qu’il faut faire un travail de fond et de sensibilisation et que l’État devrait chercher des voies et moyens pour la réussite du bilinguisme dans notre pays.
Après l’exposition des 4 panélistes, une série de questions lancent le débat qui a suscité la réaction de plusieurs jeunes arabophones qui pensent que l’État n’a pas assez donné de la place aux arabophones. Durant les échanges, certains arabophones s’exprimaient avec beaucoup de sentiments d’amertume et de frustration.
Jules Doukoundjé
- Arts & Culture
- Musique
- Mode-Beauté
- Divertissement
- Sports
- Mon Pays