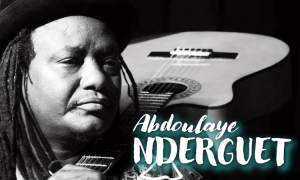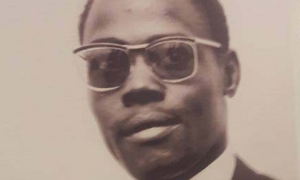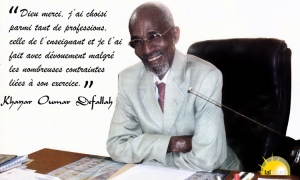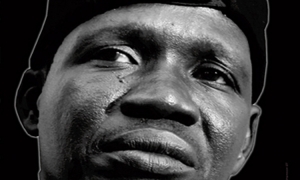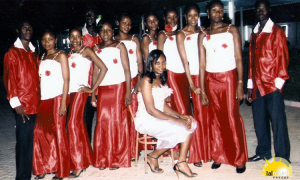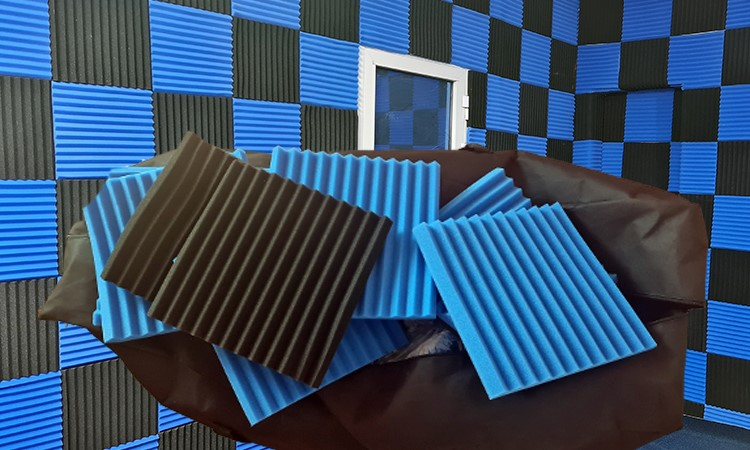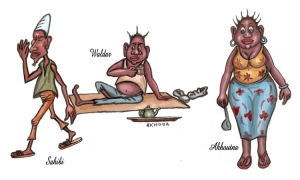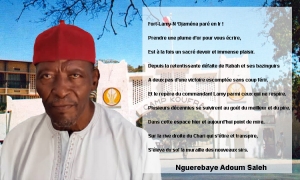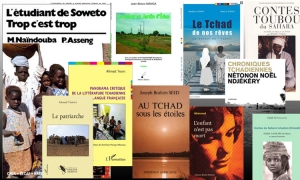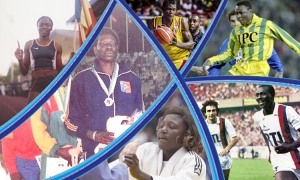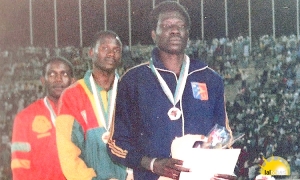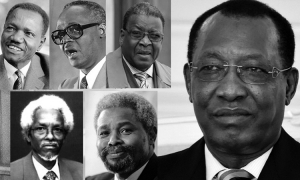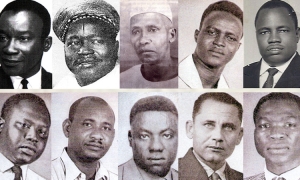A la Une
- Burkina Faso: Ibrahim Traoré, de l'exaltation révolutionnaire à l'impasse…
- Départ de l’armée française, merci président Mahamat
- AES-Cedeao : rupture ou fuite en avant?
- Cérémonie de désengagement des troupes françaises
- Congrès du MPS : Mahamat Idriss Deby passe de…
- Succès Masra, au bout de l’inconstance
- Élection Sénatoriale : l’ANGE annonce la liste des…
- Résultats législatifs : Quelle Assemblée ? Quel Sénat ?
- Les tendances de sécurité en Afrique en 2024
- Le Parti Alwihda conteste les résultats de l'élection
L’homme est par essence un animal politique disait Aristote. Il est impliqué d’une manière ou d’une autre dans le système politique de son pays. Vu qu’il ne peut en aucun cas se soustraire de la vie politique de son pays il subit directement ou indirectement ses conséquences.
Mais posons-nous la question quels sont les impacts de ce conflit qui a perpétué tant de massacres dans notre pays ?
Le conflit fratricide qui mine le Tchad depuis 1965 a entraîné une distorsion entre la théorie et la pratique politique. Partant de ce conflit, la politique est devenue au Tchad l’instance suprême du déploiement de la violence, de la genèse, d’une crise sociale presque institionnalisée. Cela a complétement faussé la base de cette activité. L’aversion de certains acteurs politiques à l’égard des autres fait que les activités politiques ne sont pas destinées aux ayant droits mais à des élites claniques tribales, régionales, ou militaires qui ne ménagent aucun effort pour la destruction de l’autre. C’est pourquoi depuis 1960 tous nos gouvernements ont échoué dans leur mission. Il semble que le sens même de détenteur de pouvoir échappe à nos dirigeants. Pour tous nos gouvernements, la détention du pouvoir ou d’une fraction du pouvoir signifie: l’enrichessement et la liberté d’en jouir, le plaisir de commander et de se faire obéir sans retenue. Le pouvoir devient le moyen de tuer ou de tirer vengeance. Le pouvoir est aussi un patrimoine pour certains. Les crières de nomination à des postes de responsabilités sont souvent: le clientélisme, le tribalisme, et le militantisme de base. Cela fait que l’administration publique devient de plus en plus une médiocrité où règnent l’incompétence, l’irresponsabilité et le népotisme. Bien que toutes activités politiques se traduisent par une lutte pour le pouvoir, les hommes politiques tchadiens ont à l’idée: qu’en matière de lutte politique, ” c’est la fin qui justifie les moyens ” et ” tous les moyens sont bons pourvu qu’ils soient efficaces .”
Beaucoup ne savent pas que la fin de toute activité politique est la dignité de l’homme et, les moyens qu’ils utilisent, sont des entorses qu’ils donnent à la cohésion sociale en dressant les tchadiens les uns contre les autres par la manipulation de la population. Dans un pays comme le Tchad, les manipulations politiques sont suicidaires. Il n’est pas bon que les mensonges, les tricheries, les fourberies et les réprimandes sont souvent l’arme du politique pour le regime. Tout cela, peut se comprendre du simple fait qu’il n’y a jamais eu une élite politique préparée pour gouverner notre pays le Tchad. Mise à part le premier président Tombalbaye qui a accédé au pouvoir par la voie des urnes ( semi-démocratie ), tous les autres chefs d’Etat et leur suite se sont imposés au peuple tchadien par les armes. Or dès qu’une ethnie ou une élite prend en otage un pays par les armes, l’hégémonie s’installe, les biens sociaux commencent par circulent de manière irrégulière. Des soulèvements s’ensuivent. La violence devient le moyen de communication de l’élite au pouvoir pour la protection des ses acquis. Alors on débouche sur des drames. C’est pourquoi, la souffrance du peuple tchadien dans cet imbroglio des hommes politiques reste une constance dans le temps. Vu les manoeuvres, les blessures morales et physiques que se donnent ces politiciens, la politique devient de plus en plus une des activités immorales et les plus cruelles au Tchad. De tout temps, les rêves des dirigeants comme nous l’avons décrit n’ont été de tuer des intellectuels ou des innocents gênant par l’intermédiaire d’une police politique qui utilise des méthodes et des moyens que la morale sociale désapprouve. Alors, des technocrates, pour leur survie sont obligés de céder la place à une élite des politiciens immatures. Ces politiciens et ces guérilleros perétuent des répressions de plus en plus sauvage qui endeuillent le pays et ce faisant affaiblit les forces du progrès. Cette pratique politique aberrante comprime le peuple tchadien dans les méandres d’une misère physique, morale, matérielle et surtout intellectuelle de plus en plus révoltante. C’est pourquoi désormais, le devenir politique du Tchad dépend de ce climat de révolte. Cependant, on ne peut construire un pays par les armes. Le comportement perfide de ces politiciens et la loi de la jungle qui règnent sur la scène politique ont perpétué depuis 1960 à ce jour une ”politicaillerie” notoire au Tchad.
La masse populaire, lasse des duperies, des spoliations et surtout de la versatilité incurable de ces politiciens se désintérressent davantage des affaires publiques tchadiennes est toujours trouble, la France a transformé en maintenant parallèlement au pouvoir central une rébellion qui peut à tout moment renverser la situation si le pouvoir central ne défend pas ses intérêts.
Avec les quarante ans de domination du monopartisme au Tchad, les acteurs politiques ont actuellement assez de problèmes pour mener à bien le jeu politique dans le contexte de véritable multipartisme pour diriger ce grand pays. Certains partis politiques ne ressembles qu’à de simple clubs électoraux et les autres sont souvent au palais pour critiquer l’autre.
I – Sur le plan économie:
Sur le plan économique, l´échec du politique a eu aussi de répercussions sur l’économie du Tchad. Mise à part la gabegie et l’ostracisme intitionnalisés, partant de ce conflit, les dirigeants du Tchad ont eu du mal à comprendre que l’Etat est une continuité en ce qui concerne les projets de développement. Souvent, il est remarqué que: dès qu’il y a changement de régime, presque tous les projets en cours s’arrêrent. Ensuite, une bonne partie de financement ou de revenus de ces projets disparaît. Enfin, tout ce qui arrive dans les prochains jours change de direction s’il n’est pas destiné à la région privilégiée par le régime ou a du mal à s’implanter puisqu’il ne profite pas aux siens. Sans pré-enquête, ou étude du milieu des projets et usines ont détournés de région destinées pour certaines régions privilégiées par le régime. Aujourd’hui, nous assistons à la faillite de tous ces projets et usines. La conséquence directe de cette manière de faire est que l’argent qu’on a mal investi dans le développement économique du pays coûte à la communauté nationale une sévère régression. De plus, depuis 1975, les changements de régimes se font toujours par les armes donc par la violence. Chaque changement détruit une bonne partie du potentiel économique. Par ce fait les bailleurs de fonds ont peur d’investir au Tchad et même les nationaux préferent investir à étranger que dans leur propre pays.
En somme, cette situation de guerre qu’a connu le Tchad, a été négatrice de son essor économique.
Beaucoup de projets de développement ont été détournés de leur but. Elle a réduit considérablement le nombre des travailleurs au Tchad et a généralisé l’incompétence et la médiocrité dans l’administration publique. Cette guerre a aussi détruit les richesses et les moyens de production de ces richesses ou a longtemps bloqué ou empêché exploitation de sa richesse naturelle.
2- Sur le plan culturel:
Sur le plan culturel, ce conflit armé qui a conduit collectivement les tchadiens à des massacres ignoble a eu des répercussions néfastes sur le plan culturel. La guerre de 1979 s’est préparée lentement et longuement car les rebelles ont mis au moins treize ans au maquis avant d’arriver au pouvoir. Dans la masse paysanne de la zone par exemple septentrionale il s’est développé à partir de 1965 une culture de violence qui a atteint son paroxysme en 1975 avant de dégénérer en 1979. Depuis cette date, la population tchadienne est dominée par une culture de violence. Cette situation de trouble qui a très tôt poussé la population du nord à s’attacher aux pays arabes fait que celle-ci est dominée par la culture arabe alors que celle du sud est imprégnée de la culture franco-chrétienne.
3- Sur le plan intellectuel:
Sur le plan intellectuel, ce manque de nationalisme et l’aversion de certains commis de l’administration à l’égard de la masse juvénile ont fait plusieurs bourses d’études ont été gêlées. Leur mauvaise volonté de ne jamais se faire suppléer par une élite bien instruite a été très tôt affichée. C’est pourquoi les structure de formation des jeunes n’ont pas été développées et les quelques rares qu’on a pu instaurer sur le territoire sont laissée-pour-compte et connaissent en ce moment d’énorme difficultés. Par exemple l’université du Tchad actuelle université de N’Djaména a été créée qu’en 1971. Les anciens bâtiments de l’institut des sciences humaines qui ont abrité ce haut lieu de savoir font aujourd’hui une grande honte au pays et surtout à la jeunesse tchadienne, qui ont découvert les autres universités dans le reste du monde. Conçus pour mille place à l’époque, les infrastructure sont aujourd’hui dépassées. A l’instar des autres universités créées à la même époque que celle du Tchad qui accueillent aujourd’hui plus de treize mille étudiants et forment jusqu’au troisième cycle, celle du Tchad n’accueille que quatre mille étudiants et ne forme jusqu’en licence et maîtrise.
Comment expliquer cette situation à la jeunesse tchadienne ?
Depuis 1971, n'accède à l'université du Tchad ( actuelle université de N'Djamena) que des bacheliers des parents pauvres. Car les bourses d'études à l'étranger sont disponibles pour les bacheliers privilégiés par le régime. La masse estudiantine est aussi à dominante sudiste à l'époque. En octobre 1979 la première tranche de financement de la construction de l'université du Tchad aurait été bouclé. Parvenue à N'Djamena sous le fameux GUNT, cette somme a été dilapidée. parce que la construction d'une université francophone avantagerait que les sudiste. Depuis lors on ne parle même plus de la nouvelle construction d'une université au Tchad. Actuellement l'accès à cette université est devenu très sélectif y compris dans les instituts.
Avec le repli de chacun dans sa zone, certaines régions du nord ont été défavorisées dans le domaine de l'éducation en langue française. Pour pallier ce manque du personnel enseignant, les instruits en arabe ont été obligés de dispenser des cours en arabe. Ainsi il s'est encore accentué le dévoloppement des écoles coraniques par conséquent de la culture arabophone. Au sud, des écoles francophones laïques se sont proliférées. Ainsi, deux tendances culturelles à vision hégémonistes se disputent âprement le terrain au Tchad. C'est pourquoi en ce moment on a des difficultés pour parvenir à un mixage culturel. Or, la possibilité d’une vie sociale pacifique résulte d’une acculturation réussie. Voilà également l’un des facteur qui exacerbe ce conflit car l’homme se comporte tout à fait naturellement souvent selon sa culture.
4- Sur le plan Morale:
Sur le plan morale, le Tchad a connu deux phases de développement moral: la morale de paix ( 1960-1965 ). Bien que la cohésion sociale ne fut jamais parvenu à un degré satisfaisant, la population tchadienne ignorait la guerre pendant cette époque.
Ensuite, de 1966 à nos jours il s’est développé une morale de guerre qui, aujourd’hui fait des ravages parmi les populations civiles du simple fait que ”quand une société entre en guerre, elle change de code moral”. Ce changement n’est pas sans conséquences. La situation de guerre que le Tchad a connu dès 1965 a laissé des conséquences morales telles que, l’abandon d’un code moral de paix au profit de celui de la guerre fondé sur une solidarité de violence. Par exemple en 1979, les relations de confiance, d’amitié, de voisinage ou de toute autre affinité sociale ont été systématiquement brisées par des assassinats dans certaines régions. Les débridement sont devenus une sorte de distraction collective chez certains peuples. ”On est passé du sentiment de haine à un délire hallucinatoire de perpécusion. Or ” un homme qui abuse de son prochain se place dans un état de perpétuelle inquiétude et de malaise général. Il se comporte sans se rendre compte comme un accusé et est constamment en position d’attaquer”. C’est pourquoi les crimes sont devenus des choses banales pendant et après la guerre. De ce fait, certains citoyens qui ont vécu ces atrocités ou qui ont été des tortionnaires ont actuellement du mal à s’insérer dans la société correctement comme il le faut. Ce qui, dans cette situation afflige est que: ce sont des jeunes enfants volontairement ou par la force des choses dans l’armée ont été constamment drogués. Les démobilisés actuellement de l’armée, ceux-ci sont devenus un danger public.
En poussant les paisibles citoyens à ces massacres irreversibles, les hommes politiques ont contribué à saboter pour longtemps tout espoir de coexistence nationale et à détruire l’âme de certains citoyens ou leur avenir. D’autres qui, après ces événement douloureux de 1979,1980,1982,1990 et jusqu’aujourd’hui ont pris le chemin de l’exil sont devenus des exilés perpétuels partout à travers le monde.
A l’instar d’Auguste Comte qui compare l’organisme social à l’organisme humain, il parait évident que ce conflit a complétement saboté la personnalité morale de l’Etat tchadien en construction, car Jean Piaget qui a étudié la psychologie de l’enfant nous fait comprendre qu’il y a des étapes très importants dans la vie de l’enfant qu’il ne faut jamais perturber à savoir la vie: la vie utérine de l’enfant, l’âge de trois ans qui correspond à la crise d’opposition, l’âge de onze à treize ans chez la fille, treize à quinze ans chez le garçon qui est l’âge du narcissisme, et enfin l’âge de six sept à dix neuf qui est celui de la crise d’originalité juvénile. Or, tous ces moments importants de la vie de l’Etat tchadien ont été secoués par des crises de guerre. C’est pourquoi la population tchadienne devient de plus en plus violente, violence imposée par une élite qui a imposé sa morale clanique à toute la population tchadienne. Or, la morale qui est une des composantes de toute société. Elle se révèle comme la force vitale de l’organisation sociale.
5- Sur le plan Psychosocial:
Conséquences sur le plan psychosociales, depuis 1965, les chroniqueurs se sont simplement contentés d’évaluer les dégâts humains et matériels de ce conflit. Nul jusqu’ici ne s’est préoccupé de ses conséquences psychosociales. Ce n’est pas un secret, notons que de 1965 à 1979, homme sudiste est perçu en milieu septentrional comme un conquérant. Les propagandes anti-sudistes du FROLINAT, n’ont fait que dresser les citoyens contre les autorités centrales.
La faiblesse de la représentativité de l’Etat au nord a occasionnée l’attachement de certaines régions soit à la Libye soit au Soudan soit au Nigeria comme le témoigne d’ailleurs, beaucoup de documents. C’est pourquoi, aujourd’hui on traite d’”étrangers” certains tchadiens parce qu’ils ont été instruits en arabe ou en anglais. Pendant la période rébellion au nord une partie des hommes était occupés au maquis. Cetains enfants ont reçu une éducation mono-parentale. D’autres ont été élevés en milieu extra-familial. Quelques autres ont assisté à des drames (incendie des villages, fusillade des parents, exposition des corps des rebelles tués au village ou dans le quartier d’une ville ont appris aussi que leurs parents seraient tués au maquis par des sudistes ou par des nordistes.
Alors ces enfants nés dans la guerre ont grandi dans un climat de frustration, de haine ou de violence. Comment s’étonner aujourd’hui de la violence ou de la revanche de cette génération une fois parvenue à conquérir ce pouvoir qui les a tant réprimé?
Avec la désagrégation de l’armée nationale et les recrutements anarchiques des soldats par des protagonistes tous les cambrioleurs des grandes villes sont devenus des combattants. Ayant raté leur éducation de base et n’ayant reçu aucune formation militaire, cette catégorie qui est venue renforcer la première n’a ni de respect pour les personnes âgées, ni de sentiments pour autrui, ni de crainte pour ce qui appartient à l’Etat. L’Etat c’est d’abord eux parce qu’ils ont combattu ou parce qu’ils ont vaincu l’autre. Donc, il faut le traiter comme tels. C’est pourquoi au lendemain de la guerre civile, une dictature de fer s’est instaurée sur la population tchadienne. Elle a complétement broyé tous les germes d’une cohésion sociale par une politique austère à l’égard de certaines ethnies dans le pays.
Dans les campagnes, la belle époque ou l’éleveur gardait ses effets chez l’agriculteur et celui-ci lui confiait aussi son bétail est révolue.
Dans l’administration publique, des bras valides, enrôlés dans l’armée causent en ce moment assez de problèmes. Pendant la guerre ils ont été de tout temps drogués. Dans les grandes villes, la méfiance des uns à l’égard des autres tient la population en haleine. Cette méfiance amène les agents au niveau des services et les élèves et étudiants au sein des établissement à se regrouper par affinité régionale ou confessionnelle.
Partant de ce conflit qui pousse les leaders à conquérir le pouvoir par les armes, on parle des régimes politiques au Tchad en terme d’ethnie. Ainsi chaque groupe ethnique qui parvient au pouvoir se croit supérieure aux autres et tent d’établir sa domination par la violence. C’est pourquoi, actuellement, beaucoup de tchadiens ne sont pas fiers les uns des autres.
En somme, cette guerre a fait assez de dégâts sur le plan psychosocial. Beaucoup des leaders ne se rendent pas compte que le rétablissement de ces dégâts psychosiaux accasionnés par la guerre est aussi une bataille que l’Etat doit nécessairement remporter. Car 40 ans après cette jacquerie, les gouvernements ont à gérer la vie d’une génération née dans la guerre, grandi dans la guerre donc habituée à la violence.
Cette triste réalité qui a amené les tchadiens à utiliser toutes les tactiques les plus inhumaines peut nous amener à penser à l’impossibilité de solutions à ce conflit et nous laisser gagner par le désespoir. Mais tout désespoir doit-être écarté car l’oblitération d’un conflit fratricide est une simple question d’organisation politique intelligente entre les acteurs sociaux et surtout de la bonne volonté des détenteurs du pouvoir. Même si nul ne peut prétendre solutionner une fois pour toute ce conflit, nous envisageons trois catégories de solutions à savoir:
- solution d’ordre purement politique et morale;
- solution d’ordre administratif;
- et enfin solution d’ordre socio-économique.
Hier comme aujourd’hui, toujours les violations des droits de l’homme et la terreur comme méthodes de gestion de l’Etat tchadien.
Les auteurs de toutes les exactions commises sont, dans leur grande majorité des cas connus ou susceptibles d’être identifiés grâces aux nombreux indices fournis par les victimes, les parents des victimes ou des témoins; mais, ils continuent de jouir d’une totale impunité.
Ou va le Tchad au 21ème siècle ?
Le Tchad ! Encore le Tchad ! Toujours le Tchad !
Gaya – Ple Seïd
Le Général de corps d’armée et Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des armées IDI, vient d’annoncer officiellement l’ouverture politique. Des rencontres sont quotidiennement organisées avec les partis politiques, les sociétés civiles, les forces religieuses et le secteur privé. Personne, pour le moment, n’a dit non ! à cette initiative du président. C’est que deux facteurs principaux pourraient expliquer cette attitude conciliante des acteurs publics. D’une part, la psychose des derniers affrontements intercommunautaires à l’Est et inter fractions armées à Abéché et Biltine et leurs cortèges de pillage et de destructions massives, probabilité qui inquiète les N’Djaménois. D’autre part, la visite éclair et significative du Premier Ministre français et sa déclaration de soutien sans ambages au régime en place face aux adversités. Autrement dit, au vu du travail efficace des mirages français en Centrafrique, il est clair que le grand chef de terre n’a pas donné sa bénédiction urbi et torbi pour les offensives militaires sur la capitale. Dans ces conditions, les acteurs tchadiens savent, par expérience que c’est l’heure de la récréation, des pourparlers. Personne n’a osé poser de préalable à la rencontre avec IDI, en supposant la patte blanche du chat hexagonal.
Alors, les avant-goûts sont annoncés, avec beaucoup de mystère, par le stratège de Djambal Ngato. Rassemblement républicain face à l’agression extérieure soudanaise dont notre pays est l’objet. Décodage : si vous voulez participer à la gestion des affaires et de la manne pétrolière, oubliez vos velléités putschistes avouées ou déguisées et acceptez l’offre minima qui vous sera faite ! Les velléités putschistes, selon le pouvoir, ce seraient à la fois le soutien aux groupes rebelles et la proposition d’un dialogue inclusif qui devrait, de toutes les manières, aboutir au même résultat de révocation de la gouvernance actuelle. Par contre, hormis le fauteuil présidentiel – qui ne se partage pas – et ses appuis, le reste peu faire l’objet d’un partage équitable. C’est pourquoi l’ouverture politique actuelle (du moins jusqu’au moment où nous écrivons) pose comme base idéologique l’union sacrée contre l’agression extérieure soudanaise.
Comment interpréter ce langage ? 1) Comme l’avait repris au compte de la France son Premier Ministre Mr De Villepin, l’ouverture concerne ceux qui sont pour la paix avec le général IDI (« les autorités légitimes ») ; les autres devraient méditer sur le sort des mécontents centrafricains ; 2) Peut-être que cette fois, le morceau à offrir pourrait être plus gros pour l’opposition légale « radicale », à savoir la Primature en sus de quelques portefeuilles ? Le mystère demeure sur l’ampleur de l’ouverture prônée par le général IDI.
Reste des zones d’ombre que les jours à venir vont clarifier : jusqu’où le général IDI sera-t-il prêt à faire des concessions à la CPDC et au FAR de Yorongar par rapport à leurs mémorandums ? Si certains parmi ceux-là changeaient leur lecture des évènements et entraient dans le jeu, de nouveaux rapports de force s’établiront automatiquement entre les acteurs politiques tchadiens. Il n’est pas exclu que des chefs rebelles, ayant demandé le dialogue, se rapprochent par ce biais du pouvoir actuel. Il n’y aura pas trahison dans ce cas, dans leur entendement, d’autant qu’ils étaient pour la plupart des proches privilégiés dudit pouvoir. Chacun a une cagnotte propre à défendre à l’heure des pourparlers et il n’y a pas de cause commune irrévocable, après la désignation d’un ennemi commun, le pouvoir actuel. Dès lors qu’un groupe estimerait avoir eu gain de cause sur l’essentiel de ses revendications spécifiques (et souvent secrètes), il arrêtera la belligérance, n’en déplaise à ses alliés du moment. Nous l’avions vu avec une rébellion puissante du calibre du MDJT qui s’est démembrée et défend maintenant ses intérêts groupe après groupe (pour ne pas dire clan). Pour me contredire, il faudrait relire tous les articles de la presse tchadienne consacrés à cette rébellion à son apogée et faire la comparaison avec son état actuel : on constatera que les efforts d’habillage de la presse ont manifestement passé à côté de la vraie réalité. De même, la presse avait tendance à exprimer à la place des leaders politiques leurs avis et se trouvait souvent déçu par les revirements inattendus de ces derniers. Par contre, les leaders politiques étaient particulièrement absents et quasi-indifférents durant les épreuves que subirent les communicateurs engagés, en 2005, les ayant conduits en prison. Nos amis communicateurs et collaborateurs de presse s’étaient retrouvés bien seuls au prétoire et à défiler entre le palais de justice et la maison d’arrêt. A la seule exception notable et énigmatique du président du groupe « étoile bronze » qui s’asseyait toute la matinée à même le sol du prétoire, en soutien aux communicateurs, lui agent de propagande officiel du pouvoir en place ! Si seulement, en ces moments-là, les forces politiques s’étaient massivement mobilisées, la liberté d’opinion ne serait pas problématique à l’heure actuelle. Ne parlons même pas de l’isolement de nos camarades défenseurs des droits humains qui paient quotidiennement un prix lourd, surtout en province, pour leur audace ! (J’en profite pour féliciter les organisations tchadiennes qui viennent de sillonner les zones de massacres intercommunautaires, à la recherche de la vérité et d’une véritable sortie de crise et du cauchemar pour ces populations). Tous ces constats révoltent et font comprendre pourquoi la sincérité et la confiance sont devenues des denrées rares dans la vie publique. L’on devrait bien chercher à clarifier cette énigme avant de récidiver dans les mêmes erreurs ! Au moins pour que les écrits présents aient valeur de documents d’archives crédibles ?
Ce sont ces probabilités et contradictions persistantes, entre autres, qui font douter de l’efficience d’un dialogue inclusif dans la cacophonie tchadienne. En l’absence d’une disponibilité sincère vérifiable de tous les acteurs à crever les vrais abcès, tactiquement la solution des coulisses arrangerait mieux les affaires de certains groupes. Pourquoi ? Parce que, plus on voudra entrer en profondeur dans l’autopsie du mal tchadien, plus on risquerait de reconstituer sur certains sujets les clivages habituels de la société tchadienne. Ce n’est pas tout le monde qui pourrait supporter les contrevérités historiques sans préparation préalable. Pour résister à la pression du rouleau compresseur de la vérité et de la justice (si les gens sont vraiment tous sincères et décidés à tourner la page sinistre), ceux qu’on présente aujourd’hui comme des ennemis jurés pourraient subitement retrouver leur solidarité d’antan. Cela, les partis politiques en sont-ils conscients ? Ou la naïveté et les calculs courts habituels ? Même certaines sociétés civiles n’auraient pas l’air de bien maîtriser la nature réelle de la belligérance entre les groupes armés (et populations en arrière-plan) qui faisaient partie de la même réalité de pouvoir. Car, jusqu’ici et ce depuis l’ancien régime, il n’y a jamais eu d’examen public transparent et concomitant des phénomènes de rébellion armée (réservé à des colloques restreints). On s’est toujours contenté de plaindre les effets fâcheux de l’existence de ce phénomène pour les populations et considérer que les accords de paix laconiques étaient des solutions, alors que ce n’étaient que des moyens indiqués ou non. Si les sociétés civiles se donnaient de la méthode dans leur approche du drame tchadien, sans avoir besoin absolument d’une table ronde inclusive, elles disposent d’assez d’éléments pour faire une autopsie efficace du cycle de la rébellion armée et proposer des thérapies durables et incontestables pour enrayer ce phénomène anachronique récurrent, au lieu de se contenter d’accompagner le phénomène et même inconsciemment le justifier. Cela rendrait alors possible et efficace un « vrai dialogue inclusif » tel que nous l’aurions tous souhaité, pour tourner la page, sans amuser la galerie, comme à la CNS en 1993 et après. La démarche du groupe des associations sur le terrain brûlant et brûlé de l’Est est un pas significatif à encourager.
Pour que l’ouverture prônée par le président IDI soit une chance pour la paix et la réconciliation, il aurait fallu supprimer au moins la censure préalable restauré à la faveur de l’Etat d’urgence. En effet, s’il y a ce froid de réactions populaires, même de soutien dans les cercles proches du pouvoir, c’est que le bâillonnement de la presse est plutôt perçu comme un mauvais signe par les élites. La presse est actuellement la seule fenêtre à travers laquelle les divers courants sociaux s’expriment. Elle est donc plutôt un décompresseur de tensions et non le contraire. Les responsables gouvernementaux partisans d’une liberté d’expression verrouillée, comme au temps de la pensée unique, ne devraient pas se rattraper avec l’Etat d’urgence, après avoir vainement tenté de faire modifier la loi 029 sur le régime de la presse dans le mauvais sens. Ils privent ainsi le président IDI de la visibilité et de l’écoute nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Ils offrent des occasions prolongées sur six mois aux chauffards à la tête des instituions sensibles de multiplier les gaffes, en confondant l’Etat d’urgence avec le retour de la pensée unique et du griotisme. Ils risqueraient de faire échouer la gestion de cette période exceptionnelle et surtout, de faire douter de la bonne volonté d’ouverture du président IDI. Il est vrai que le fait de prêter ses colonnes ou l’antenne à des acteurs opposés à la légalité actuelle pourrait être une maladresse dans un contexte explosif, par une presse nationale. Cependant, la sensibilisation et le dialogue direct avec les presses, en utilisant les canaux du HCC et de l’ODEMET, conjureraient mieux les excès possibles, sans affecter le pluralisme démocratique, au lieu de la censure préalable. Pour sa part, la presse privée devrait aussi comprendre que les acteurs publics ne sont ni mineurs ni handicapés pour que les journalistes signent et paient tout le temps à leur place. Partis politiques ou rébellions armées, ces gens ont beaucoup de possibilités pour exprimer et défendre eux-mêmes leurs idées et suggestions (s’ils en ont). Si l’on voudrait une démocratie saine, inclusive de tous, respectueuse de la dignité et de la particularité de chacun et portée vers la construction de la paix et de la réconciliation, ces remarques ne sont pas à négliger. Sinon, en croyant beaucoup faire pour certains et en ne faisant rien pour d’autres, le résultat sera le même : du surplace et la chute dans le chaos !
Enfin, pour conclure notre commentaire marginal habituel, nous disons qu’il y a deux catégories d’oppositions contre IDI. En réalité, non pas la classification par genre (rebelles et partis politiques + certains acteurs assimilés) mais par objectifs : d’une part ceux qui sont prêts à limiter leur opposition à la satisfaction de revendications corporatistes ou globales avouées ou non, et ceux qui ne s’arrêteront que quand le pouvoir auraient changé de mains ou de régions. Dans toute groupe actuel, on aurait pourrait apparemment avoir un mélange des deux. Cependant, la proportion catégorielle variera selon le niveau du prix à payer par option : « les moutons se promènent ensemble mais ils n’ont pas le même prix » (dixit Magic Système). C’est pourquoi nous verrons plus clair en fonction des circonstances et des cartes que le maître des lieux, le général IDI abattra. Moi, tout ce que je demande pour moi, c’est le grade de « colonel de paix », pas de guerre car je n’en ai ni l’envergure ni la motivation.
Enoch DJONDANG
La question qui se pose est celle de la justification de cette guerre : d’après les groupes armés, le postulat posé est le suivant : il n’y a pas d’autre manière de faire partir le président Deby que l’usage de la force. Mais ils oublient que cette logique peut être reproduite à l’infini. C’est pourquoi, la raison militaire prônée par ces belliqueux est une absurdité et comme telle, doit être refusée. Il s’agit d’un jeu à somme nulle. Car il y aura toujours un gagnant et un perdant. Pour moi, tout candidat au trône tchadien doit être inspiré par le bien- être des Tchadiens ; or ceux-ci ont déjà assez payé pour cette grosse bêtise de laquelle ils croyaient être délivrés. Désormais, ils souhaitent participer démocratiquement à la gestion de la République et tirer profit eux aussi de notre pétrole. Les aspirations de tout Tchadien ne pourraient être satisfaites qu’à la faveur d’un pouvoir élu pour mettre en œuvre une politique basée sur la satisfaction de l’intérêt général.
Essayons de développer cette notion de l’intérêt général.
Nous savons que tous les gouvernements qui se sont succédé au Tchad depuis le coup d’état du 13 avril 1975 ont progressivement délaissé cette notion, au point de la confondre avec l’enrichissement personnel dans la gestion du bien public. Cette tendance s’est aggravée dès lors que, des individus, par centaines, habitant de surcroît les quartiers huppés de la capitale tchadienne, ont commencé tout bonnement à « fêter leurs millions, voire milliards ». Comme par hasard ces individus, sous prétexte qu’ils appartiennent à au groupe ethnique au pouvoir ou assimilé à celui-ci, pouvaient s’enrichir au détriment de l’Etat. Après tout, (disent-ils) n’ont-ils pas amené au trône tel ou tel président ? Aussi, l’esprit revanchard qui habitait ces maquisards ne devait-il pas les conduire au pillage du denier public ? Ils pensent que la chose publique « chokol ana hakouma » appartient à tout le monde. Oui c’est vrai. Mais seulement, le tout le monde dont il s’agit s’appelle le peuple tchadien en tant qu’entité nationale et non pas un groupe d’individus véreux et parvenus, sans scrupule et sans respect et ne sachant parler que le langage de la violence.
Les membres de l’actuelle rébellion, de loin ou de près sont ces individus qui se sont servis sans vergogne des biens publics pour s’enrichir. Et, comme si le pouvoir économique ne suffisait pas, ils essayent à présent de conquérir son volant politique de façon violente. De qui se moque-t-on ? Qui est donc le dindon de cette farce ? Je vous le donne en mille : le peuple tchadien, cette entité abstraite et muette, au nom de laquelle ils justifient leur guerre !
Comme le disait Tonton David, ce jeune chanteur Réunionnais dans une de ses chansons, « je suis sûr qu’on nous prend pour des cons, j’en suis certain ». Que les Tchadiens ne se laissent pas duper par ces opportunistes, au discours fallacieux et qui, pas plus tard qu’hier, ont largement bercé dans le système politique actuel, en connaissent la culture les contours qu’ils ont eux-mêmes largement dessinés.
S’ils veulent le pouvoir, qu’ils apprennent déjà à respecter cette notion qu’est l’intérêt général, sans lequel la gestion de la chose publique (le pouvoir politique) devient une absurdité.
Il ne suffit pas d’être un gradé de l’armée pour prétendre gouverner un pays. Il ne suffit pas non plus d’avoir tel ou tel diplôme, d’avoir fréquenté les coulisses de la présidence pour être un bon dirigeant politique. Encore faut-il que l’on fasse ses preuves en se présentant devant le peuple pour avoir une légitimité.
Inutile de rajouter que la présidence de la République tchadienne n’est pas une chasse gardée. Il appartient au peuple tchadien qui, lui seul doit décider qui est susceptible de le gouverner harmonieusement et paisiblement.
Pour que le peuple cesse d’être le dindon de la farce, il doit dire non aux opportunistes de tout bord, armés ou non, dont l’unique préoccupation se limite à la satisfaction de leurs intérêts personnels en pillant les biens publics, détruisent et tuent des parents à Adré et à Biltine, allant jusqu’à s’allier avec les diables du Darfour soudanais pour parvenir à leur fin.
Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus que le Président Deby limite sa politique à répondre ponctuellement au problème posé par la rébellion. Le statu quo ne suffit plus. Loin s’en faut.
Il doit se dire que le pouvoir n’est pas une fin en soi mais juste une mission, un cadre permettant à l’homme politique de poursuivre des objectifs d’intérêt général, c’est-à-dire la satisfaction collective, non exclusive des besoins du peuple, en lui fournissant divers services publics. L’efficacité de l’homme politique se mesure à l’aune de la satisfaction de l’intérêt général.
Pour satisfaire cet intérêt général, il faut assurer la bonne gouvernance économique et politique. Cela passe forcément par une large ouverture politique et une transparence dans les élections démocratiques. Or les ces éléments semblent connaître un balbutiement notoire depuis décembre 90, où le président Deby a affirmé avoir « apporté la démocratie aux Tchadiens ».
Il est bien vrai que le peuple tchadien qui a tant souffert des guerres avait dans les années 90, besoin de la stabilité politique. De ce point de vue, le premier mandat de président Deby fut salvateur.
En revanche, le deuxième mandat, fut sans doute un de trop, même s’il pouvait être encore perçu comme nécessaire, tant les ténors politiques sudistes dussent s’imprégner de la culture démocratique eux aussi, eu égard au règne du régime précédent. Par ailleurs, la démocratie étant un processus autant qu’un apprentissage, il fallait un certain temps : un brassage multiethnique et multiconfessionnel était nécessaire aux partis politiques pour asseoir leur notoriété nationale et internationale. En outre, il fallait cultiver un certain charisme à défaut de l’avoir de façon innée, prédéterminée pour l’exercice du pouvoir, même si ce n’est pas le seul critère.
Aujourd’hui, la plupart des leaders politiques du Sud comme du Nord ont acquis sans conteste cette dimension, en plus de leurs compétences et savoir-faire politiques. Il est donc grand temps qu’ils aspirent légitimement et démocratiquement au pouvoir, celui que seul, leur peuple tchadien leur confie pour la défense de l’intérêt national. Cette analyse exclut catégoriquement toute autre forme de conquête du pouvoir politique au Tchad, car coûteuse à tous égards.
C’est l’on pousse l’analyse à son terme, la constitution du Tchad ne devait pas être relookée.
C’est la raison pour laquelle sa modification a soulevé un tollé général et fut condamnée par l’opposition dans son ensemble.
Pour elle, ainsi que pour la plupart des observateurs, il s’agissait d’une manœuvre de bas étage destinée maintenir au pouvoir le régime actuel. C’est un mauvais coup porté par le MPS à la démocratie.
C’est sans doute la raison du mécontentement de la classe politique qui s’estime à juste titre lésée dans sa course pour la conquête du pouvoir suprême. Quoi de normal, car après tout l’objectif de l’homme politique n’est-il pas d’être élu ?
Pour les frères armés, la solution est tout simplement militaire : par les armes le Président est rentré dans N’Djaména, par les armes il doit N’Djaména ! Quelle triste et tragique équation ?
Pauvre Tchad. C’est à croire tu ne dois ton existence, voire ta survie qu’à des combats fratricides violents.
Mais alors à quoi tu peux bien servir sans ta population ? Qui donc peut te mettre en valeur si ce ne sont tous tes enfants ?
Ces questions si simples dans leur conception m’amène comme l’a fait mon frère Gaya PLE Seïd à souligner in fine les points suivants :
- associer toutes les parties en présence au débat démocratique, seul à même de dégager un consensus politique dans l’intérêt national ;
- le Président Deby peut être amené, au nom de l’intérêt supérieur de la Nation, à redistribuer de nouvelles cartes en prenant des initiatives fortes sans pour autant compromettre sa légitimité de chef de l’Etat. Une des solutions de sortie de crise ne serait-elle pas de revenir sur la réhabilitation de la constitution ? Si telle est la volonté du peuple, et si cela peut amener les rebelles à déposer les armes, alors, pourquoi pas ?
- Les Tchadiens doivent montrer une certaine maturité politique pour faire une autre publicité qui vante les mérites du Tchad, plutôt que celle qui décourage l’investissement direct étranger au Tchad (IDE).
- Il n’y a aucune revanche des uns à prendre sur les autres de manière à éviter les jeux à somme nulle (gagnants-perdants). Ces genres de jeu ont à maintes reprises, conduit le Tchad à des situations inefficaces, dans la mesure où les acteurs (les protagonistes ici) n’arrivaient pas à se coordonner autour d’un idéal commun : l’intérêt général du peuple tchadien notamment.
Aujourd’hui le pays essaie de se frayer un chemin lui permettant de défendre sa respectabilité au plan international. Nous devons tous être mobilisés pour y contribuer de façon constructive et non le contraire. C’est la raison pour laquelle je rejette la solution guerrière qui est pour moi, la pire des sottises. Nous devons rompre avec ce modèle trop coûteux à tous points de vue, pour nous tourner vers le modèle alternatif incarné par les urnes.
Abia Maal
Combien de survivants du régime Hissein Habré pourront assister au procès si l'ancien Président tchadien n'est jugé que dans trois ans ?
Cette question taraude les victimes au lendemain de l'annonce faite par le Ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio. Près de dix-sept années se sont écoulées depuis que Hissein Habré a fui le Tchad et est venu se cacher au Sénégal, où il vit un exil doré, grâce aux millions de dollars qu'il a volés au Trésor public tchadien.
Les huit années de son règne ont été marquées par une pratique systématique de la torture, par des détentions arbitraires et une répression aveugle et sanglante dans le sud du Tchad, ainsi qu'à l'encontre des ethnies arabes, hadjerai et zaghawa, toutes musulmanes. Une commission d'enquête a estimé à 40,000 le nombre des exécutions sous le régime Habré
À la chute de ce dernier, les victimes ont pris la ferme résolution d'obtenir justice. Renonçant à un procès au Tchad, dont les gouvernements successifs n'ont jamais présenté de demande d'extradition au Sénégal – lesquels n'offriraient de toute façon pas les garanties d'un procès équitable -, elles se sont tournées vers la justice de son pays d'exil, le Sénégal.
En 2000, après dix ans d'attente, elles sont parvenues à le faire inculper au Sénégal pour complicité de crimes contre l'humanité, d'actes de torture et de barbarie. Malheureusement, des ingérences politiques ont amené la justice sénégalaise à se déclarer incompétente. Ce revers n'a toutefois pas affaibli l'opiniâtreté des victimes qui ont, dans la foulée, déposé des plaintes en Belgique en vertu de la loi de compétence universelle. En effet, le 27 septembre 2001, le Président Abdoulaye Wade avait déclaré que « si un pays, capable d'organiser un procès équitable - on parle de la Belgique - le veut, [il] n'y verrai[t] aucun obstacle ».
Après quatre années d'enquête menée par une équipe policière judiciaire spécialisée dans les crimes internationaux, la justice belge a donc délivré un mandat d'arrêt international contre Habré et a demandé son extradition. Arrêté en novembre 2005, il ne sera toutefois pas extradé, un tribunal sénégalais refusant de statuer sur la requête. Sous la pression des Nations Unies, dont le Comité contre la torture avait condamné le Sénégal pour manquement à son obligation de juger ou d'extrader Hissein Habré, le gouvernement sénégalais a annoncé qu'il demanderait à l'Union africaine (UA) de se prononcer sur une «juridiction compétente ». En juillet 2006, l'UA a demandé au Sénégal de juger l’ancien président tchadien « au nom de l'Afrique », ce que Wade a accepté. Une décision qui a fait renaître l’espoir. Certes, l'adoption fin janvier d'une loi par l'Assemblée nationale permettant de juger au Sénégal les pires crimes commis même en dehors de son territoire, représente une avancée importante. Mais rien de concret n'a été mené jusqu'a maintenant, et notre espoir s’est envolé de nouveau, cette fois-ci à cause des déclarations de M. Gadio, qui a considéré que l'instruction prendrait au moins trois ans encore. M. Gadio a critiqué notre « empressement » alors que c'est le Sénégal qui pendant seize ans a refusé de traduire Habré, et ce en dépit de ses obligations internationales !
Combien encore de mes clients mourront d'ici à trois ans, comme Samuel Togoto et Sabadet Totodet qui ont été parmi les premiers à porter plainte à Dakar en 2000 ?
Du côté de la justice, il semble difficile de parler d’empressement pour une affaire qui a débuté il y a sept ans. Si le Sénégal avait respecté ses obligations internationales en 2000, lorsque Habré fut pour la première fois arrêté, ce dernier aurait été jugé depuis longtemps. Si le Sénégal avait extradé Habré vers la Belgique en 2005, il serait aujourd'hui devant la cour d'assises de Bruxelles.
Si le Sénégal projette d'ouvrir rapidement l'instruction et de reprendre le travail mené par la Belgique des années durant, nous sommes convaincus que, tout en respectant les droits de la défense, le procès pourrait avoir lieu bien avant trois ans.
Il est certain qu’enquêter et poursuivre des crimes commis massivement il y a plusieurs années dans un autre pays se révélera complexe et coûteux. De plus, nous avons pu constater, en 2001 et en 2005, que Habré a utilisé notre argent à bon escient et que ses partisans, y compris religieux, forment un groupe de pression puissant au Sénégal. La communauté internationale doit donc proposer son aide au Sénégal. D’autant que Dakar a fait des efforts - comme l'adoption récente de la loi permettant de juger Habré sur son sol - qui attestent de sa bonne volonté.
Le Sénégal est aujourd’hui en mesure d’offrir un procès exemplaire en matière de lutte contre l’impunité, encore faut-il que les principaux acteurs - victimes, témoins et accusé - soient encore vivants. Une justice qui tarde à être prononcée est un déni de justice.
Jacqueline Moudeina (Présidente de l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme et avocate des victimes de Hissein Habré)
Au Tchad sous le régime actuel du président Idriss Deby Itno, la classe politique au pouvoir semble n’avoir pas de volonté politique sérieuse pour restaurer la paix et la stabilité dans le pays. Les Tchadiens le savent bien car, toutes les élections organisées n’ont pas été libres et transparentes, moins encore démocratiques. Les institutions étatiques mises en place et souvent présentées à l’opinion publique nationale et internationale, ne servent que le Chef de l’Etat, son cercle politique immédiat et ses proches. L’absence d’une démocratie acceptable, le non-respect des droits et libertés, la militarisation excessive, la mauvaise gestion et la corruption, entraînent de facto l’inégalité et la misère sociale dans le pays, et plongent les populations à vivre constamment dans l’insécurité générale, la terreur et la désolation. Le recours de certains Opposants politiques à la force armée, est la conséquence immédiate résultant du refus de l’instauration d’un environnement politique normal basé sur des confrontations politiques et pacifiques, conditions nécessaires pour une paix réelle et un développement durable au Tchad.
Les activités des partis politiques devenues inutiles ou du moins tombées en désuétude, laissent la place à la prolifération de la rébellion armée. Toute négociation politique pour une réconciliation nationale véritable est transformée en théâtre de folklores médiatisés. Les Accords de paix n’aboutissent pas à un consensus national fiable. La réconciliation est perçue par le pouvoir comme une récupération des opposants ou une allégeance au régime en place, parfois en échange des sommes importantes, abusivement soutirés du Trésor public, alors que les fonctionnaires et Agents de l’Etat ne perçoivent pas à temps leur salaire. Dès qu’un Accord de paix est conclu, les signataires et anciens opposants sont négligés, oubliés et parfois même humiliés. S’ils contestent et exigent l’application desdits Accords conclus, soit ils sont arrêtés, soit ils disparaissent dans des conditions parfois mystérieuses. Et aucune investigation ou instruction des autorités judiciaires sur leur disparition n’est faite.
Le principal Accord important obtenu était lors de la Conférence Nationale Souveraine. Mais son application a été torpillée par les dirigeants au pouvoir, leurs partisans politiques et autres partis alliés de la mouvance présidentielle. Ainsi, les Accords politiques à caractère global obtenus à la CNS, ou dans un cadre restreint et séparé, avec certaines Organisations politico-militaires ou des partis politiques légaux, n’ont jamais été respectés, ni appliqués. Malgré cela, des Tchadiens de la Diaspora retournent au pays pour participer à son développement économique et social. Mais grandement déçus de nos réalités anachroniques, ils quittent aussitôt le pays pour vivre à l’extérieur, même s’ils ne sont pas des opposants politiques. D’autres, choqués des pratiques arbitraires quotidiennes, optent pour la lutte armée et rejoignent le maquis. Ces derniers temps, des affrontements armés se succèdent d’une région à une autre, des blessés graves et des morts tragiques se multiplient. Et le président Deby persiste à vouloir anéantir la rébellion armée par la force. Cela pourrait être possible mais pas sûre, car depuis les années 1965 la rébellion armée n’a jamais été éradiquée par la force, même avec l’appui des forces étrangères.
Nous avons toujours proposé le dialogue et la négociation pour le règlement de nos conflits, car au Tchad personne ne peut éteindre le feu par le feu. Pour le pouvoir ou la rébellion, le recours aux armes peut être une dissuasion, mais pas une solution à un différend politique. Les conséquences des affrontements armées sont énormes et destructives pour le Tchad. Dépassé par l’ampleur de la rébellion armée et du conflit avec le Soudan, le président Deby cherche la médiation des pays amis et de la Communauté internationale. Tout en persistant dans son refus de négocier avec ses Opposants armés, il lance des appels à la réconciliation nationale, mais aussi pour l’envoi des Casques bleus de l’ONU dans la sous-région, afin d’éviter que ces conflits et affrontements se généralisent et emportent son régime.
Malgré ses déclarations contradictoires par rapport à ses actes, certains politiques Tchadiens avertis lui proposent une rencontre globale, pour trouver un consensus réel, pouvant épargner les populations civiles de souffrances perpétuelles. D’autres nouveaux amateurs et arrivistes qui persistent à faire leur entrée dans le giron des politicards, se tiraillent naïvement et proposent aussi des Conférences de paix, sans savoir réellement comment le préparer et y parvenir. Inconscients de leur inexpérience politique, ils perdent de vue qu’on ne résout pas les conflits du Tchad par la dialectique théorique et surréaliste. Qu’elle soit <inclusive ou exclusive>, l’essentiel n’est pas là, mais plutôt dans l’acceptation même du principe de la tenue de cette rencontre par les principaux acteurs concernés. L’adoption d’un consensus conduisant à un Accord crédible, l’application et le respect des décisions à prendre viendront en seconde phase. Le président Deby a lancé le 29 Décembre 2006 à Kyabé, un appel de paix et de réconciliation nationale. Cet appel est-il sincère ou c’est pour la propagande politique. Et où en est-on dans l’Opposition ? Présentement, aucun consensus clair n’apparaît au sein des organisations politico militaires, ni entre les partis politiques de l’intérieur ou de l’extérieur, moins encore au sein des membres du COPORT, et pas non plus au sein de la Diaspora tchadienne des États-Unis, du Canada ou de l’Afrique de l’Ouest, et dans d’autres régions du monde…
L’accord politique global si accord il y a, ne sera viable que si les dirigeants au pouvoir et de l’Opposition armée, écartent leur vision traditionnelle et clanique de l’Etat, se retrouvent, se décident d’associer des formations politiques sérieuses et des personnes ressources, pour réfléchir sereinement ensemble sur des questions politiques de fonds liées à la survie même de la nation tchadienne et enfin de proposer des solutions consensuelles acceptables pour tous, et dans l’intérêt de nos populations meurtries. Et pour sa crédibilité personnelle et celle du pays, le président Deby doit nommer des cadres de grande envergure pour assumer des hautes fonctions dans l’Administration tchadienne. L’amateurisme et le tourisme administratif de ses parents, alliés ou protégés politiques, ne sert pas son régime, ni notre Administration, et ne fait que ternir l’image du Tchad par rapport aux autres Etats du continent qui avancent positivement.
Les conflits et affrontements armés, tout comme la mauvaise gouvernance ont toujours bloqué le Tchad à se développer. Ainsi, un cessez le feu est certes nécessaire, mais cela arrangerait-il le gouvernement au pouvoir qui profite de la guerre pour piller le trésor public et certaines Organisations politico-militaires, qui persistent à s’accrocher aussi longtemps sur leur logique de guerre, pour satisfaire leurs intérêts occultes sur le dos du peuple tchadien.
Il serait donc utile de s’entendre pour décider d’un Cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire, suivi d’une Amnistie générale. Aussi, les pourparlers doivent déboucher sur l’adoption d’une période réaliste de Transition, pouvant permettre une préparation sérieuse des prochaines élections. Or, avec l’absence d’une réelle Armée nationale tchadienne, qui doit assurer le respect de l’ordre public et garantir à chaque citoyen la sécurité et le droit de voter librement, il n’est pas possible d’organiser des élections sereines et crédibles dans l’immédiat. Des élections sont certes nécessaires pour déterminer l’audience politique du pouvoir et de l’Opposition, mais l’insécurité générale dans le pays ne le permet pas. Il n’est donc pas réaliste politiquement d’envisager des élections avant la fin du mandat actuel du président Deby Itno, même si cela est obtenu de manière contestée. Mais les élections législatives doivent précédées les présidentielles.
En attendant de réfléchir et voir comment ces élections devraient se tenir, certains pensent déjà au recours à des Forces extérieures. Mais au Tchad, les dirigeants au pouvoir, l’Opposition politique et même la rébellion armée, tous subissent les pratiques néocoloniales des Forces étrangères stationnées dans notre pays. Il n’est donc pas question de soumettre encore aujourd’hui le Tchad à un système qui se rapprocherait du Protectorat. Notre salut viendrait peut-être des Forces multinationales des Nations Unies, avec des contingents provenant effectivement de plusieurs Etats. Encore faut-il bien négocier et préparer l’arrivée de ces Forces onusiennes au Tchad, afin de faire bénéficier à notre pays, des retombées non seulement politiques et sécuritaires, mais aussi économiques et financières.
Le président Hassan El Béchir refuse le déploiement des forces de l’ONU au Darfour, alors que le président Idriss Deby Itno le réclame depuis un certain temps. L’assistance sécuritaire des milliers de réfugiés soudanais et des civiles tchadiens déplacés est certes louable pour sauver des vies humaines, mais à quel prix et dans quelles conditions, le Tchad doit accepter cela et pour quel nombre des Casques bleus ? Le Secrétaire Général de l’ONU Monsieur Ban Ki Moon propose de déployer un effectif de six à onze mille hommes au Tchad et en République Centrafricaine. Notre pays accepte certes de coopérer avec les Nations Unies, mais les Conseillers politiques du Secrétaire Général, doivent être au moins objectifs, car le Darfour est au Soudan mais pas au Tchad. Même s’il y a réticence des autorités soudanaises, ce n’est pas au Tchad et à la Centrafrique d’absorber le maximum des Casques bleu de l’ONU au Darfour.
Bien que plongé dans ses stratégies militaires, nous conseillons au président Deby beaucoup de réserve et de suggérer plus tôt l’envoi des Forces de sécurité civile pour la protection des camps des réfugiés. Les Nations Unies payent très bien et il y a toujours des Etats qui veulent trouver du boulot à leurs contingents, mais cela ne doit pas se faire sur le dos du Tchad. C’est aussi une forme de protection de nos intérêts.
Si le Chef de l’Etat tchadien avait démontré dès son arrivée au pouvoir en 1990, sa volonté politique de restaurer la paix, par la négociation et le dialogue, la bonne gouvernance et la restructuration de notre Armée nationale, aujourd’hui il y aurait la stabilité au Tchad et nos forces de sécurité seront en mesure de faire face aux incursions des milices Djan-Djaouites. Mais tel n’est pas le cas, c’est pourquoi les rebellions tchadiennes se prolifèrent, les milices soudanaises entrent aisément dans nos territoires, et l’insécurité empêche nos populations civiles à vivre en paix. Alors dans ces conditions, quelle assistance humanitaire les réfugiés et les populations civiles déplacées pourront-ils en bénéficier ? Comment les Agences humanitaires peuvent-ils assumer leur mission ?
Si l’ONU déploie ses Casques bleus aux frontières Tchad-Soudan-Centrafrique, il serait indiqué de s’inspirer du récent exemple de la République Démocratique du Congo, et solliciter le moment venu, l’assistance des Forces onusiennes pour sécuriser le déroulement des élections au Tchad. Mais en attendant que des conditions acceptables soient réunies pour avoir une vie politique sereine, il est utile d’avoir une période de Transition, conduite par un Gouvernement de consensus, qui sera constitué après une large consultation politique. Dans ce gouvernement, seront représentés les principaux acteurs politiques ou leurs représentants, ainsi que des hautes personnalités indépendantes tchadiennes.
Ce gouvernement doit être dirigé par un Premier Ministre, issu d’un large consensus politique. De même, les opposants au régime de N’Djamena, doivent concéder au Président Deby de continuer son mandat en cours, quelque soient les conditions de tenue des dernières élections présidentielles de 2006. La participation au Gouvernement de consensus ne doit pas être un obstacle à tout Tchadien qui souhaiterait se présenter aux élections dans l’avenir. Notre démocratie serait encore de façade, si on exclut certains citoyens de participer aux prochaines compétitions électorales.
Quant au conflit du Darfour, bien que ses répercussions touchent directement le Tchad et ses populations civiles, cela est d’abord et reste un conflit interne relevant de la responsabilité des autorités du Soudan. Le règlement de cette crise devenue régionale, doit être laissé à l’Union Africaine et aux Nations Unies. Le Tchad doit régler ses problèmes internes indépendamment du conflit du Darfour, tout en respectant les droits et libertés de ses citoyens, mais aussi les principes universels du Droit international. Au cas où notre pays est agressé par des forces extérieures, aucun Tchadien n’accepterait que notre souveraineté soit bafouée.
Hassane Mayo Abakaka
L’interférence du Soudan dans les affaires intérieures du Tchad est très ancienne, multiple et sous diverses formes. Ainsi comme la Libye, le Soudan a toujours servi de base arrière et même de sanctuaire pour les Opposants politico-militaires en rébellion contre le pouvoir de N’Djamena.
Depuis 1959, les Tchadiens installés au Soudan se sont constitués en comité de dissidents dénommé :<Comité du Tchad Libre>, siégeant à Khartoum. Mais compte tenu de son hostilité à l’égard de ce Comité, l’ancien président Tombalbaye accusa plus tard les autorités soudanaises d’entretenir <un Gouvernement de la République Islamique du Tchad en exil>. En fait, il ne s’agissait que du Mouvement National de Libération du Tchad, MNLT transformé le 20 Avril 1965 en Front de Libération du Tchad, FLT de Ahmed Hassan Moussa, un ancien membre du Mouvement Socialiste Africain, MSA de Ahmed Khoulamallah, l’un des partis politiques interdits par le président Tombalbaye en 1962.
En 1965, des milliers des Tchadiens vivaient au Soudan et le FLT bénéficiait déjà à l’époque du soutien des fonds collectés par les travailleurs tchadiens du Gesirah. Organisé et bien structuré, le FLT s’engagea dans la lutte armée contre le régime de N’Djamena. En 1966, les dirigeants de l’UNT à savoir Issa Dana, Président et Mahamat Abba, Secrétaire Général, se sont concertés avec Ahmed Hassan Moussa du FLT, pour créer à Nyala au Soudan, le Front de Libération Nationale du Tchad, FROLINAT placé sous la direction d’Ibrahim Abatcha, Ce dernier, originaire et natif de la capitale tchadienne est membre de l’UNT, parti politique crée depuis le 16 Septembre 1958, mais interdit également en 1962.
En 1966, le Frolinat a mené plusieurs actions militaires dans les régions du Guerra, Ouaddaï et Salamat. Ces offensives localisées se sont étendues plus tard au Batha, au Chari Baguirmi, au Lac et à Bardaï. En 1972, la rébellion s’est généralisée dans les régions Est du pays et des groupes de combat du Frolinat se sont apparus même au Mayo Kébbi et à Léré. En 1974, la rébellion avait même attaqué la Garde nomade surveillant les installations pétrolières de la Continental Oil Company, CONOCO dans la région de Doba.
Aussi, les premiers dirigeants du Frolinat ont reçu le soutien des Tchadiens servant dans l’Armée Soudanaise, pour assurer la formation et l’entraînement de leurs combattants. De 1965 jusqu’au 1972, le Soudan a été pratiquement une base opérationnelle du Frolinat. Mais suite aux accrochages survenus en mai 1972, entre l’Armée soudanaise et les combattants du Front Populaire de Libération, le Frolinat fut réduit à la clandestinité. Ses activités sont interdites et son Bureau fermé. Heureusement qu’un autre sanctuaire s’est ouvert plus tard en Libye, du Colonel Kadhafi qui continue toujours lui aussi, ses interférences au Tchad, en soutenant tantôt le pouvoir de N’Djamena, tantôt la rébellion et parfois en essayant de les opposer ou les réconcilier comme ces derniers temps.
De même en Avril 1989, lorsque le Colonel Idriss Deby est entré en dissidence contre l’ancien président Hissein Habré, c’est au Soudan qu’il s’est refugé avant de conquérir les régions Est du Tchad. Le 1er décembre 1990, il prend le pouvoir à N’Djamena, grâce d’abord à un soutien actif de la France, avec l’appui des combattants du MPS, de Tchadiens résidant au Darfour, mais aussi des Soudanais. Et durant ses premières années de pouvoir, la présence massive des nouveaux Soudanais au Tchad avait suscité l’hostilité générale de l’ensemble des populations tchadiennes. Pour les Soudanais, surtout originaires du Darfour, le Tchad était leur nouveau El Dorado….
Aujourd’hui encore, avec la détérioration de la situation politique au Tchad, beaucoup de Tchadiens opposants politiques et officiers militaires en dissidence, ont trouvé refuge au Soudan. Suivant les traces de leurs aînés du Frolinat, et surtout décidés à défendre leurs droits de revenir un jour participer librement à la gouvernance de leur pays, ces frères de l’Opposition se sont organisés dans différentes formations politico-militaires. Ces organisations se fixent toutes comme objectif de renverser le pouvoir de N’Djamena, mais n’arrivent pas à constituer une seule Coordination de lutte pour atteindre leurs objectifs.
Avec l’éclatement du conflit du Darfour, d’autres Mouvements soudanais de lutte armée sont créés, et leurs leaders réfugiés au Tchad, bénéficient du soutien des autorités de N’Djamena. Alors, en réaction au soutien ouvert du président Idriss Deby Itno au Mouvement pour la Justice et l’Egalité, MJE, du Dr. Khalil Ibrahim, le président Hassan El Béchir qui avait déjà donné de larges facilités au Front Uni du Changement, FUC du Capitaine Mahamat Nour Abdelkerim, autorise le rassemblement au Soudan, d’autres Mouvements politico-militaires tchadiens, tels, l’UFDD du Général Civil Mahamat Nouri, la Coalition CNT-RaFD de Timan Erdemi, et même le CPR de Mahamat Amine Ben Barka, récemment crée, mais bien constitué par des cadres très déterminés.
Le soutien discret mais très actif du pouvoir de N’Djamena au MJE, qui parfois participaient aux offensives des Forces Armées tchadiennes contre les forces de la rébellion, a conduit les dirigeants de Khartoum à s’engager fermement et ouvertement pour déstabiliser le Tchad. C’est ainsi que les milices armées Djan-Djaouites du gouvernement soudanais intervenaient à l’intérieur du territoire tchadien et souvent dans les camps de réfugiés du Darfour, troublant ainsi les activités et actions d’Assistance ou de Secours mené par les Organismes et Agences humanitaires. En appuyant la rébellion armée tchadienne du Front Unis pour le Changement, malgré « les tirs de semence » des Forces françaises de l’Opération Épervier, le soutien du Soudan a conduit le FUC le 13 Avril 2006, jusqu’aux abords du Palais présidentiel à N’Djamena.
Avec le retour au bercail du Capitaine Mahamat Nour Abdelkerim du FUC, suite à l’Accord signé avec le président Deby en Libye, c’est par l’Union des Forces Démocratiques pour le Développement, UFDD du Général Mahamat Nouri, que le Soudan persiste encore à déstabiliser le Tchad. En appuyant la rébellion armée de l’UFDD et la coalition CNT-RaFD de Timan Erdimi, le président El Béchir réplique ainsi aux interférences du président Deby Itno dans les affaires intérieures soudanaises.
Ainsi ayant constaté l’ampleur des attaques de la rébellion du FUC en Avril 2006 et surpris par les récentes offensives militaires de l’UFDD et de la coalition de CNT/RaFD, le Chef de l’Etat tchadien monta la surenchère pour qualifier la rébellion tchadienne, des Mercenaires puis des Terroristes à la solde du Soudan, de l’Arabie Saoudite et d’Al-Quaida. Khartoum a été certes un point de transit de Ossama Ben Laden, mais le FROLINAT crée depuis 1966 au Soudan, avait certes des combattants arabophones et musulmans, mais pas des Islamistes fondamentalistes. De Goz-Beida en passant par Abéché, Adré, Ounianga Kébir et Fada, l’actuelle rébellion tchadienne continue non seulement de troubler le pouvoir de N’Djamena, mais de menacer sérieusement la stabilité du Tchad. Malgré le ralliement de l’ancien rebelle, le Capitaine Mahamat Nour Abdelkerim du FUC, devenu aujourd‘hui Ministre de la Défense, l’accalmie n’est pas encore garantie. Sa présence au Gouvernement est certes un atout pour le pouvoir de N’Djamena, mais aussi un signe de provocation de certains membres de l’entourage du Chef de l’Etat. Bref, le Conflit du Darfour tout comme les récents affrontements armés ont entraîné des centaines de morts et le déplacement des milliers des civils tchadiens et soudanais.
Malgré les multiples Accords signés suite aux efforts du Guide de la révolution libyenne, Mouammar Kadhafi et du président français Jacques Chirac, ou encore des autorités iraniennes, les relations bilatérales entre le Tchad et le Soudan restent troublées et marquées par la méfiance réciproque. Les Mouvements de rébellion contre les pouvoirs de N’Djamena et de Khartoum continuent d’exister et se renforcent. L’ONU cherche à envoyer ses Casques bleus pour servir de Forces internationales d’interposition. Le Soudan est ferme et réticent et le Tchad embarrassé, hésite. Que faire pour sortir de cette crise ? Tout dépendra des efforts concrets de paix à consentir par les Généraux Idriss DEBY ITNO et Hassan EL BECHIR en acceptant de négocier avec leurs rebellions armées en vue de trouver de solutions pacifiques acceptables pour tous et dans l’intérêt de leur pays. Cet engagement honorable dépendrait non seulement de leur volonté politique, mais aussi de leur maturité d’Homme d’Etat, capable de faire la paix pour l’avenir des générations futures.
Hassane Mayo-Abakaka
Dès la prise du pouvoir par le MPS en 1990, le domaine où le président Idriss Deby Itno a vraiment réussi et brillé, était la politique Étrangère. En 1991, l’Honorable Soungui Ahmed Kotoko et le Général Mahamat-Ali Abballah Nassour ont su brisé la gérontocratie du régime dictatorial de l’ancien président Habré, qui servait de blocage à la Diplomatie tchadienne, au profit de l’affairisme de certains barons et leurs Agents, placés dans nos Ambassades à l’Extérieur.
Au début du règne du président Deby, et indépendamment des contingences politiques et tribales subjectives, des cadres qualifiés et dynamiques, tous issus des sensibilités politiques variées, ont été nommés dans les structures du Ministère des Affaires Etrangères. Cette élite compétente et diversifiée dans sa composante sociale que politique, se donnait corps et âme pour servir l’Etat tchadien et défendre sa souveraineté et ses intérêts sur le plan international. A cette époque, les Cadres et Agents du Département, même n’étant pas membre du Parti au pouvoir ou appartenant à des formations politiques de leur choix, ont la confiance de leurs Ministres qui leur confiaient des responsabilités au sein du Département des Affaires Etrangères, sans aucune susceptibilité. Oui, ils ont compris que l’importance de la Diplomatie est loin, au-dessus des calculs d’un parti politique.
Cela a créé donc un stimulus au sein du Département et donné un souffle nouveau et dynamique à la diplomatie tchadienne. La crédibilité du Tchad sur le plan international est ainsi constatée et reconnue au niveau des Etats et des Organisations internationales. Bien qu’avec des moyens humains et financiers limités les Cadres du Département des Affaires Étrangères et les Diplomates tchadiens, encouragés par l’engagement sérieux de leur hiérarchie, étaient motivés dans leur travail pour faire rayonner l’image de marque du Tchad sur le plan international. Cette période était presque l’apogée de la Diplomatie tchadienne. Le Tchad était respecté par tous ses voisins et partenaires internationaux, au niveau bilatéral que multilatéral. Il n’y avait pas de discrimination, pas d’intimidation, ni d’hostilité même verbale à l’égard des Agents et Cadres du Département. Il n’y a pas non plus de belligérance à l’égard de nos voisins et nos partenaires étatiques, moins encore à l’égard d’un parti politique ou d’une composante ethnique du pays.
La courtoisie comme dans notre jargon diplomatique existait entre tous et les uns les autres se respectaient au Département. Au niveau de la hiérarchie, il n’y avait aucune intimidation politique, pas de menace voilée, ni de diatribes primaires à l’égard des agents et de leur Communauté, quel que soit leurs origines. Le respect et la dignité des hommes étaient de rigueur.
Les Ministres Soungui Ahmed Kotoko et Mahamat-Ali Abdallah Nassour ont toujours associé dans leur mission extérieure des Cadres du Département, même s’ils ne sont pas de leur ethnie ou de leur connivence. La grandeur d’esprit de ces Hommes d’Etat, est certes un signe de respect pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs collaborateurs au Ministère. La course aux frais de Mission et aux Caisses d’Avance n’existait pas et chaque Fonctionnaire ou Agent qui traite un dossier est d’office désigné pour prendre part à la mission qui en résulte. Les Agents et Cadres du Ministère se perfectionnent dans leur domaine et zone d’activités. C’était réellement la transparence dans la gestion efficace de la Diplomatie tchadienne.
Aujourd’hui à l’ère pétrolière, le Tchad a suffisamment des ressources financières que dans les années 90. Les potentialités et ressources humaines existent et se sont même spécialisées grâce à l’expérience internationale des uns et des autres au sein du Département, mais aussi à l’Union Africaine, ou encore à l’ONU et dans ses Opérations de Maintien de la paix. Mais depuis ces derniers temps, la méthode de gestion de notre diplomatie qui devrait tenir compte des potentialités disponibles du Département, semble se stagner aux pratiques s’inspirant toujours des vestiges hérités de l’ancien régime. Des hauts cadres qui avaient servi au Département depuis des décennies, sont systématiquement combattus et injustement abandonnés à eux-mêmes et on puise des parents et cousins sans réelle qualification et expérience sérieuse pour faire leur promotion ; ou encore on déterre dans les quartiers ou a l’extérieur des inconnus du Département dont certains n’ont jamais été fonctionnaires pour les affecter dans nos chancelleries, au détriment des Agents qui ont servi longtemps au Ministère. Et on ne cesse de nous parler des reformes, d’économie à faire comme si l’Etat tchadien était en faillite. Tout cela au détriment des Agents et Cadres du Ministère qui croupissent et attendent l’exploit d’un messie, qui passent tout son temps à l’extérieur pour rouler pour lui-même et parfois évitant de rester au pays au moment des tensions avec la rébellion armée. Les Tchadiens n’ont-ils pas droit à un bilan, ou doit-on constamment continuer à naviguer à vue, sans évaluer ce qu’on fait et savoir vers quelle direction on va ?
Bien que le Département soit piloté par un Homme d’expérience, formé à l’ancienne École d’Outre-Mer, sa méthode de gestion semble démontrer ses limites. Ce Département qui doit être la vitrine du pays se présente à l’intérieur comme un Musée abandonné. Quels efforts ont été faits pour améliorer le cadre du travail des Agents ? Le travail de fond se fait à la base par les Agents, alors ne méritent-ils un environnement digne de la grandeur de notre Ministère de Souveraineté ?
Dans le contexte actuel de la mondialisation, chaque Etat doit tenir compte de sa spécificité et de ses moyens, mais n’y a-t-il un minimum de conditions de travail à ne pas ignorer ou tout simplement à respecter.
Vigilant ces derniers temps et bien informé de ce qui se passe au niveau des Ministères, le président Idriss Deby Itno a compris et décidé de décentraliser le Ministère des Affaires Étrangères et de le renforcer par la Coopération internationale. Cette décentralisation salutaire du Département des Relations Extérieures avec la création de Secrétariats d’Etat, confiés des Cadres politiques connus au niveau national et débarrassés du complexe néocoloniale de domination, nous espérons bien, s’il n’y a pas encore des entraves occultes, que les choses pourront s’améliorer positivement. Les Hommes d’Expérience et les Cadres de haut niveau existent bel et bien, alors pourquoi doit-on tergiverser par complaisance ? La Diplomatie qui est un problème d’Etat et non d’individu, doit être traitée en fonction des intérêts du Tchad et indépendamment de nos humeurs. Alors au cas où des tentatives du maintien du statu quo persistent, le Chef de l’Etat serait dans l’obligation de penser à une nouvelle alternative pour réellement sauver la Diplomatie tchadienne et honorer la crédibilité de notre pays.
La politique étrangère reste toujours un domaine réservé du Président de la République, qui est libre d’acquérir des conseils utiles auprès de qui de Droit, pour préserver les intérêts supérieurs de la nation tchadienne. Il n’y a pas certes dans ce domaine de monopole exclusif, ni de chasse à l’Homme, mais les Tchadiens doivent observer avec vigilance la gestion et le suivi de notre Diplomatie qui doivent être conformes aux intérêts du pays mais pas de ceux des individus.
Ainsi, comme la Diplomatie, la Mondialisation peut servir aujourd’hui de facteur de développement d’un Etat. Au moment où notre pays entre dans l’ère pétrolière, les Entreprises et Hommes d’Affaires tchadiens doivent avoir la possibilité de communiquer aisément avec le reste du monde, pour promouvoir le développement économique et commercial de notre pays. Depuis plus d’une année, il est impossible d’atteindre le Tchad par Fax à partir des Etats-Unis. Les responsables du Ministère et des Services des Télécommunications du Tchad ont-ils tenté de débloquer cette situation d’asphyxie partielle du Tchad ou bien continuent-ils de s’enfermer dans leur mutisme….
Et compte tenu des difficultés de l’Internet qui n’est pas à la portée de tous et du coup élevé du Téléphone dans notre pays, comment nos Opérateurs économiques, nos Entreprises et Sociétés nationales pourront-ils communiquer de manière régulière et réciproque avec les Etats-Unis d’Amérique. Actuellement les Tchadiens peuvent envoyer des Fax mais ne pas en recevoir des Etats-Unis. Alors, jusqu'à quand cela pourrait-il continuer ainsi ?
Préoccupée par cette situation d’isolement indirecte de notre pays, la Communauté Tchadienne de New York, saisie par beaucoup des Tchadiens, est dans l’obligation d’interpeller nos autorités en de ce Dossier. S’agit-il d’un problème d’arrière de contributions financières que le Tchad doit payer ou bien des problèmes d’ordre techniques à régler ? C’est le black-out total, on ne dit rien et ce sont les Tchadiennes en subissent. Contrairement aux allégations destructrices et tendancieuses de certains de nos responsables politiques en quête de notoriété auprès du Chef de l’Etat, il faut rappeler que l’Association des Tchadiens de New York, n’est pas du tout un parti politique, moins encore une faction politico-militaire. Elle a entre autres, parmi ses objectifs : - de promouvoir et de développer les relations Culturelles, économiques, commerciales et de partenariat d’Affaires, entre le Tchad et les Etats-Unis, mais aussi entre la Diaspora Tchadienne des États-Unis et les Tchadiens de l’Intérieur, y compris les Sociétés ou Entreprises commerciales, les Associations de Développement Communautaires. Alors notre question fondamentale est : Pourquoi le Tchad ne peut être atteint ou saisi par Fax, à partir des États-Unis d’Amérique ?
Nous constatons ces derniers temps, un défilé régulier du Chef de la Diplomatie tchadienne au pays de l’Oncle SAM. Il a certes des missions politiques importantes qui justifient son interminable tourisme, mais nous espérons aussi, qu’en dehors du Darfour, il a d’autres dossiers spécifiques qui peuvent rapporter au Tchad. La diplomatie de nos jours doit être multi dimensionnelle, mais surtout rentable pour le pays. Même s’il a des questions politiques traditionnelles relatives à la paix et la sécurité dans notre sous-région, le volet économique et commercial ne doit pas être minimisé, ni laissé aux oubliettes, car l’objectif final c’est de promouvoir le développement du Tchad. Pourquoi alors ne pas se concerter avec son collègue des Postes et Télécommunications pour faire d’une pierre deux coups, afin de tenter de débloquer cette situation d’isolement du Tchad face aux États-Unis. Nos Diplomates à New York, tout comme à Washington sont souvent bloqués et embarrassés par cette situation, car ils n’arrivent pas à saisir N’Djamena par FAX, et envoyer des documents urgents au pays. A-t-il songé à consacrer une minute de son séjour à cette situation ou s’est-il limité à s’épanouir uniquement de son tourisme de luxe au frais du contribuable tchadiens ?
Le Tchad malgré notre boum pétrolier reste toujours limité dans ses possibilités et ressources financières. Il est donc important de rappeler à certains de nos responsables politiques leur manière de faire. Le développement du Tchad ne doit pas également se reposer seulement sur l’Etat et les Services publics, mais aussi sur les activités de nos Opérateurs privés et leurs Entreprises. Mais, nos responsables politiques doivent leur créer les conditions et un environnement favorable permettant de concourir au développement et à l’épanouissement économique et social de nos populations. Alors quel effort notre Chef de la Diplomatie a-t-il déployé pour mettre un terme à cet isolement indirect du Tchad vis avis des États-Unis ? Est-il conscient que cela bloque le pays et crée un manque à gagner énorme pour nos Opérateurs économiques ?
Certes, la France est notre partenaire traditionnel, mais cela n’exclut pas la diversification de nos relations économiques et commerciales avec d’autres puissances incontournables comme les États-Unis qui pourront offrir au Tchad de grandes possibilités de développement rapide, durable et crédible. La course et l’agitation à la politique politicienne, sans une réelle évaluation sérieuse, ne doivent pas nous faire oublier la recherche des débouchés économiques pour le développement de notre pays. Ce second volet est beaucoup plus intéressant et rentable pour notre pays et ses populations.
Notre réflexion va certes retenir l’attention de certains et troubler celle des autres. Mais c’est aussi une forme civilisée de confrontations pacifiques, qui pourrait améliorer notre méthode de gouvernance dans chaque secteur de l’Etat. Cela nous éviterait une généralisation globale couvrant des actes individuels toujours abusivement collés au dos du Chef de l’Etat, le Président Deby qui doit en supporter seul les carences ou les échecs de ses Ministres. Pour permettre au Tchad d’avancer, il est important de situer les responsabilités individuelles dans la gestion de chaque secteur de nos affaires publiques.
Les Tchadiens d’aujourd’hui ne veulent plus de discours vides, ni des diatribes primitives et discriminatoires sans lendemain, moins encore des déclarations belliqueuses qui divisent nos populations et entraînent des affrontements armés inutiles. C’est pourquoi les intimidations et campagnes des politiciens en mal d’assise sociale ne nous empêcheraient pas de continuer à réfléchir sur des questions politiques et économiques sensibles relatives au développement de notre pays, le Tchad. /-
Hassane Mayo-Abakaka
Dans notre observation et recherche sur les conflits du Tchad et la situation politique dans ce pays, nous avons identifié des centaines des formations politiques, des organisations politico-militaires et Associations de la Société civile. Toutes s’intéressent activement aux conflits qui déchirent le pays et opposent ses leaders politiques. De ce constat, nous nous posons la question de savoir : Pourquoi la question politique intéresse-t-elle si tant les Tchadiens ? La population du Tchad est inférieure à dix millions d’habitants. La Fonction publique tchadienne totalise moins d’un million de fonctionnaires. Depuis l’indépendance en 1960 à nos jours, le pays a connu plusieurs conflits sociaux, politiques et des affrontements armés, ayant entraîné des milliers de blessés et de morts.
Plusieurs tentatives de réconciliation nationale ont été amorcées selon chaque régime et de multiples Accords de paix sont adoptés et signés. Des élections législatives et présidentielles sont organisées, plusieurs Gouvernements d’ouverture ou de consensus sont formés, mais aucune solution définitive n’a été trouvée. Les dissensions entre les acteurs politiques, les défections au sein des partis politiques, dans les Organisations politico-militaires et les désertions au sein de l’Armée nationale, provoquent de vives tensions politiques et sociales dans le pays et entraînent souvent des affrontements armés avec leur cortège de malheurs sur des citoyens innocents.
Aujourd’hui les populations civiles tchadiennes en ont vraiment assez. Les militaires du gouvernement tout comme les combattants rebelles sont fatigués. Néanmoins, les leaders politiques du pouvoir ou de l’Opposition persistent dans leurs ambitions et tergiversent sur l’option à adopter pour aboutir à un compromis raisonnable. Vu la gravité et l’impasse de la situation, ces mêmes leaders politiques tentent de trouver une voie de sortie de crise. Des rencontres et concertations se multiplient, plusieurs émissaires dont l’ancien président tchadien Goukouni Weddeye, sont sollicités pour explorer la situation et rapprocher les positions. Certains des Opposants exigent un <dialogue inclusif> et le Gouvernement au pouvoir propose la <réconciliation nationale>. Bref, c’est déjà une bonne chose, car l’idée principale de négociation politique n’est pas écartée et il n’y a pas non plus de rupture totale. Mais comment avancer de manière concrète afin d’aboutir à des solutions acceptables pour tous et dans l’intérêt du Tchad ?
- Pour les partisans du <dialogue inclusif>, le débat sur les conflits du Tchad doit être soumis à une concertation générale, regroupant tous les acteurs de la crise tchadienne à savoir, les partis politiques, les politico-militaires, les Associations de la Société Civile, la Diaspora tchadienne, etc… sous la médiation de la Communauté internationale, pour aboutir à la mise en place d’un Gouvernement de Transition et organiser des élections libres et démocratiques. Cette position serait soutenue par les rebelles de l’UFDD de Mahamat Nouri et du RFC de Timan Erdimmi, mais aussi par les autres membres de la rébellion, tels le CPR du Dr Amine Ben Barka et la CNT de Dr Al Djineti Allazam, tout comme l'Opposition politique de l'intérieur, telle la CPDC et le parti FAR, mais aussi la Société civile.
Les enjeux de nos conflits sont importants et les stratégies à adopter semblent difficiles, mais est-il vraiment nécessaire de faire participer tout ce monde ? Cela ne nous ramènerait-il pas à une nouvelle forme de Conférence Nationale bis ? Le nombre des participants importe peu, mais c’est plutôt la qualité et la pertinence des propositions réalistes à présenter qui devraient mériter plus d’attention.
- Pour le Gouvernement tchadien, l’organisation d’une table ronde pourrait conduire à «la réconciliation nationale» et serait une opportunité de ramener au bercail les Opposants en exil. L’idée n’est pas mauvaise, si cela pourrait restaurer la paix et maintenir la stabilité dans notre pays. Mais cet appel lancé est-il général à tous, ou seulement aux politico-militaires de l’Est ? L’ancien président Goukouni Weddeye dans sa mission de bons offices a-t-il des propositions concrètes pour rassurer les frères de l’Opposition, non seulement de leur sécurité mais aussi pour un réel partage du pouvoir ? A-t-il de garanties pour l’amélioration de la méthode de gouvernance dans notre pays et dans l’intérêt national ? Son rôle à lui se limiterait-t-il à la médiation uniquement ou sera-t-il aussi impliqué avec son organisation, les FAP/CPR, comme partie prenante dans ces pourparlers ?
<Dialogue inclusif> ou <réconciliation nationale>, les belligérants ont-ils une réelle volonté de mettre fin aux conflits politiques et aux affrontements armés qui endeuillent les familles tchadiennes ? Les Tchadiens doivent-ils avancer vers l’essentiel ou perdre le temps sur des interminables querelles de procédure qui cachent d’autres intentions inavouées ? Cette <réconciliation nationale> ou ce <dialogue inclusif> doit-il être amorcé seulement avec les Groupes armés qui menacent la stabilité du pays ou également avec certains leaders politiques de Opposition de l’intérieur et de l’extérieur, afin de créer réellement une accalmie générale sur l’ensemble du pays ? L’objectif fondamental serait-il de restaurer la paix et la stabilité au Tchad ou bien de répéter les erreurs des années 79-80, en se limitant uniquement au partage des postes de responsabilité au Gouvernement et dans l’Administration ? Nos frères protagonistes cherchent-ils de vraie solution ou veulent-ils se reconstituer de nouvelles formes d’alliances stratégiques pour mieux gouverner et dominer la majorité silencieuse des Tchadiens généralement pacifiques ?
Les conflits en Afrique sont multiples, et quelle que soit leur ampleur, des solutions pacifiques sont trouvées, alors le Tchad ne fera pas l’exception. Les affrontements armés peuvent dissuader mais ne pas conduire à une solution définitive et durable. C’est pourquoi, le dialogue et la concertation sont toujours nécessaires, mais sur des bases objectives. La réconciliation nationale est certes bien possible, si les belligérants tchadiens font un effort pour ignorer leurs ambitions et intérêts personnels, penser à la souffrance des populations et trouver un compromis politique réaliste et viable pour restaurer la paix et la sécurité pour tous.
Tout leader politique Tchadien qui se respecte en tant qu’homme d’Etat, doit dépasser des visions clanique et régionale, pour accepter de gouverner le pays avec l’adversaire d’aujourd’hui qui pourrait être le partenaire sûr de demain. Et la mise en place d’un Etat démocratique et crédible fondé sur le respect des droits et libertés, sera un grand honneur pour le Tchad. Mais comment se présente aujourd’hui notre paysage politique de manière générale ?
Il y a d’un côté le Gouvernement, les politico-militaires et les partis politiques de l’Opposition. Et de l’autre côté, les Associations de la Société civile, les Syndicats, les Organisations de Droit de l’Homme et des personnalités indépendantes de la Diaspora. Bien que la chose politique intéresse tous les Tchadiens et chacun a ses ambitions, il faut faire preuve de retenue et aborder cette question de manière réaliste et objective, tout en situant chacun à sa place et devant ses responsabilités.
Les négociations politiques doivent se faire entre politiques, c’est-à-dire entre le Gouvernement au pouvoir, les Mouvements politico-militaires et les partis politiques de l’Opposition, légalement créés qui contestent le pouvoir et font des propositions réalistes. Les Associations de Droit de l’Homme, les Syndicats et les Organisations de la Diaspora, ne peuvent être que des témoins et observateurs, tout comme certains partis politiques alliés au pouvoir. Si certaines de ces Organisations ont des contributions importantes à faire, elles peuvent les présenter sous forme de propositions aux acteurs politiques en conflit. Mais de grâce, évitons des amalgames et le cafouillage, tirons les leçons des expériences passées pour avancer positivement et aboutir à de décisions historiques importantes pour enfin sauver le Tchad et l’avenir des générations futures. La paix et la stabilité dans notre pays mérite certes un effort de chacun et de tous, pour éviter la déstabilisation du Tchad et les ingérences intempestives d’autres Etats dans nos affaires intérieures.
Hassane Mayo-Abakaka
- Arts & Culture
- Musique
- Mode-Beauté
- Divertissement
- Sports
- Mon Pays